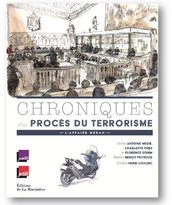Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Editorial
La 3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix a encore une fois rencontré un fort succès, malgré le contexte et l’important protocole sanitaire mis en place pour assurer la sécurité des visiteurs. Rendez-vous annuel ouvert à tous, ce Forum est un véritable laboratoire de réflexion et de médiation autour de la paix, de la liberté et des droits de l’Homme.
Acteurs de demain, les jeunes tiennent une place prépondérante dans la programmation de cet événement. Chaque année, la Région Normandie en partenariat avec les autorités académiques déploient de nombreux programmes pédagogiques et temps forts à destination des lycéens normands. C’est le cas notamment du projet « La Colombe » mené par des jeunes des lycées Guy-de-Maupassant de Fécamp et François Ier du Havre, qui tout au long de l’année s’exercent au métier de rédacteur à travers ce journal.
Leur participation au Forum leur a permis de retranscrire la parole d’une centaine d’experts internationaux venus échanger sur les grands enjeux de demain que sont les défis climatiques, sociaux et technologiques autour du thème « Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces ». A travers des reportages, des interviews et des témoignages, ce journal vous permettra de revivre les temps forts de cette 3e édition. Je tiens à féliciter le travail de ces jeunes et de leurs encadrants et vous donne rendez-vous les 3 et 4 juin 2021 pour la 4e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix sur le thème :« Paix mondiale, sécurité globale : comment gouverner la paix ? ». Bonne lecture !
Hervé MORIN.Président de la Région Normandie.
Loujain Al-Hathloul, militante saoudienne pour les droits de la femme, a reçu le Prix Liberté 2020, à l'occasion du Forum mondial Normandie pour la paix, les 1eret 2 octobre, à Caen. Emprisonnée, la lauréate n'a pu recevoir cette distinction. Deux de ses sœurs l'ont représentée. Le trophée, conçu et réalisé par les élèves du lycée Napoléon de L'Aigle, leur a été remis, en présence de la chanteuse Barbara Hendricks, Hervé Morin, président de la Région Normandie, Christine Gavini-Chevet, rectrice de l'académie de Normandie et Emmanuel Davidenkoff, président du jury Prix Liberté 2020.
Le suspense américain
À un mois de l'élection américaine, Gérard Araud, ex-ambassadeur de France à Washington, nous a livré son sentiment. L’affrontement des deux candidats représentait deux choix antagonistes, deux Amérique qui s’affrontent, qui ne se parlent et ne se comprennent pas. Ce qui ne sera pas sans conséquences.
Dans le cas où Donald Trump serait réélu, il se sentirait renforcé pour aller au bout de sa vision du monde, « America First », ce système sans alliance et basé sur des rapports de force brutaux. Selon lui, le multilatéralisme peut être touché par cette élection car Donald Trump y est très hostile et souhaite une guerre commerciale contre l’Union européenne.
Avec Joe Biden, le soulagement viendra rapidement grâce au retour de l’Amérique que nous aimons, à la différence qu'ils ne veulent plus être les gendarmes du monde. On connaît aujourd'hui le résultat même si le président sortant peine à l'admettre.
Léandre HUET
Milan ANDRIEUX.
L'Éthiopie, un nouveau souffle d'espoir
Transition démocratique ou retour du règne d'un « Big man » ?
L'Éthiopie se situe dans la Corne de l’Afrique et joue un rôle pivot. Ce pays a une diversité culturelle puisque les trois religions monothéistes cohabitent dans cette même zone. Même si l’Éthiopie a subi de plein fouet la crise sanitaire du coronavirus, elle est parvenue à augmenter son PIB.
En 2021, le pays n’importera plus de blé ; ce qui représente une véritable économie puisqu'en 2020 ces importations représentaient 1 milliard de dollars. Un attelage à la création d’une démocratie se met en place mais ceci reste un défi à cause des extrémistes qui tentent de relancer des révolutions populaires.
En Éthiopie, trois questions historiques restent en suspens : la répartition des terres, promouvoir sa culture et surtout comment instaurer une démocratie stable. Un mois après la tentative de mise en place d’une démocratie, la presse change son fusil d’épaule et déclare que le régime mis en place n’est pas une démocratie mais un retour à un régime avec des « dérives autoritaires ».
La justice corrompue libère des prisonniers qui sont repris quelques heures après. Le pouvoir diffère dans chaque village, il n’y a aucune ligne d’autorité. Le gouvernement abuse de son pouvoir pour régler les conflits.
Finalement, la question de la transition se pose toujours : la démocratie va-t-elle l'emporter ou le pays va-t-il rebasculer dans des dérives autoritaires ? Les tensions géopolitiques actuelles ne présagent rien de bon.
Claire DEHAENE,
Louis THAREL,
Tom DAVID-AVENEL,
Noah LERAY.
Protéger la nature c'est protéger l'humanité
Pour Nicolas Hulot, le souci de l'écologie va de pair avec la quête de la paix.
Nicolas Hulot a fait une intervention remarquée au Forum mondial Normandie pour la Paix. L'ancien ministre de la Transition écologique a répondu à nos questions.
Pourquoi le changement climatique engendre-t-il
des conflits ?
C’est un lien très documenté. Le changement climatique entraîne des submersions, donc des déplacements de centaines de millions de personnes, des engloutissements d’infrastructures industrielles et accroît le stress hydrique. Tous ces événements ne sont pas compatibles avec des relations apaisées.
Parlez-nous du terme
éco-humanisme évoqué
à votre conférence ?
Tout simplement, la nature est un tissu fragile et délicat. Si l’on veut protéger l’avenir de l’homme, on doit protéger l’avenir de l’ensemble des êtres vivants sur terre, car ils ont tous une raison d’être. On réalise à quoi sert une espèce que quand elle disparaît. Il faut protéger la nature pour protéger l’humanité et ne pas sacrifier l’avenir des générations d’aujourd’hui.
La crise sanitaire du Covid a-t-elle accéléré le processus de transition écologique ?
L’avenir nous le dira. Dans un premier temps, il y a eu un sursaut de conscience. On nous a expliqué que c’était sûrement la destruction d’un écosystème quelque part en Asie qui avait entraîné le déplacement d'un virus jusqu'à nous. On a pu constater que tout était lié. Quand on détruisait ou perturbait la nature, cela pouvait avoir des conséquences sur l’humanité.
On a été confrontés à notre vulnérabilité. On a pris une grande claque et une grande leçon d’humilité. Mais la question c’est de savoir si cette prise de conscience va durer, je n’en suis pas convaincu, mais je ne suis pas convaincu du contraire.
Pour l’enjeu écologique,
est-il trop tard ?
Il est trop tard pour se poser des questions donc il faut agir. Chacun doit faire ce qu'il peut avec ce qu’il a, car personne n’est détenteur de la vérité.
On a perdu beaucoup de temps, des temps précieux, on a perdu trente ans avant de réagir, ce qui rend la résolution des problèmes beaucoup plus complexe. Il faut éviter à l’avenir de se trouver dans des impasses, où on aura le choix qu’entre des mauvaises solutions.
Propos recueillis par
Hugo GRANCHER.
Le droit des enfants dans les conflits
Encore 400 millions de jeunes victimes en proie aux guerres à travers le monde.
Les droits des enfants sont systématiquement oubliés dans les conflits : réfugiés, apatrides, enlevés, utilisés comme enfants soldats, ils subissent aussi des violences physiques, des abus sexuels, et deviennent une marchandise illégale de trafics inhumains. Dans certains conflits, les forces armées vont même jusqu’à empêcher les aides humanitaires et les ONG de secourir les enfants, ou attaquent des écoles, sans se poser la question des victimes.
Les violences faites aux enfants sont des crimes de guerre, qui laissent des traumatismes parfois durs à gérer. Les réfugiés subissent encore des discriminations, des violences gratuites et du racisme dans les pays vers lesquels ils ont fui la guerre.
Retrouver son âme d'enfant après la guerre
Comment retrouver sa vie, et une place dans la société, après avoir vécu tant d’atrocités ? La question de leur statut de victime a aussi été évoquée, ils sont presque réduits à cela même s’ils restent des êtres humains. Les enfants sont capables d’une résilience sans nom, et de continuer à vivre malgré les horreurs qui les accablent.
La question de l’écoute est importante aussi, symptomatique d’une société où la parole des enfants n’a presque aucun poids. En effet, dans le processus de guérison, l'une des étapes les plus importantes est sûrement de partager son vécu et d’être sincèrement écouté.
Un engagement pour des jours meilleurs
Des intervenants ont aussi évoqué le besoin de laisser les enfants s’impliquer politiquement à leur niveau en leur donnant une place plus importante dans la gouvernance d'associations militant pour les droits des enfants, et les laisser trouver des solutions qui leur conviennent pour aller mieux. La place de la famille est aussi très importante. Lorsque celle-ci est encore en vie, il est important de laisser les enfants retourner vers elle, sans séparer les fratries, et surtout redonner aux parents leur rôle, pour qu’ils deviennent eux aussi de nouveaux acteurs de leur vie familiale.
Dans un monde en perpétuel changement, les droits des enfants sont bafoués en permanence, et malgré les efforts des ONG et de l’ONU, de nombreux états continuent à ne pas les respecter. La question qui se pose pour demain est : comment les protéger au mieux ?
Sarah DEYREM,
Isaë LECARPENTIER.
S. Rainsy, double exilé
Sam Rainsy, 71 ans, est originaire du Cambodge : sa famille s’exile en France avant la guerre civile de 1967. Son père, opposant au roi Sihanouk, est assassiné. Sa mère est emprisonnée quand il est petit.
Il décide de s'engager en politique après les accords de Paris sur le Cambodge de 1991. Il abandonne toute activité privée, rentre au Cambodge en 1992, devient député et ministre des Finances.
Sa lutte contre la corruption lui fait perdre son poste et il est de nouveau contraint à l'exil. Sa vie et sa liberté sont publiquement menacées par des déclarations répétées du Premier ministre Hun Sen.
Zoé MAISIERE.
Youssef, Yara, Shakiba, « livres humains »
Ils sont tunisien, kurde, afghane, jeunes et marqués.
On les qualifie de « livres humains ». Ils sont venus raconter leurs histoires et expliquer ce qu’un enfant ressent lorsqu’il est pris dans un conflit. Trois d’entre eux, provenant de Syrie, Tunisie, et Afghanistan, se sont confiés à nous.
Youssef, 15 ans, est le premier à conter son histoire. Il explique comment a débuté la révolution tunisienne de 2010 et comment elle s’est répercutée sur son quotidien d’enfant. À travers ses mots, nous vivons son incompréhension de l’époque. Il livre quelques anecdotes : pour son anniversaire, son père brave l’interdiction du couvre-feu afin de lui acheter un gâteau.
Youssef rappelle que, malgré la révolution, les attentats et le sentiment de peur dans le pays, il ne quitterait pour rien au monde la Tunisie. Il aime ses terres, sa nation et veut leur rendre honneur en les aidant. Dans son témoignage, il donne des solutions qui pourraient stabiliser le pays, comme une unité des partis politiques.
Cette histoire diffère de celle de Yara, une adolescente kurde-syrienne. Installée en France depuis cinq ans, elle attend sa future nationalité française. Une belle récompense pour elle après un parcours traumatisant, surtout lors de son passage de la Syrie à la Turquie afin d’échapper à la guerre civile syrienne de 2011. En Turquie, elle est victime de racisme et doit porter le hijab sous peine de représailles. Elle décide donc de retourner quelque temps en Syrie mais, sur les conseils de son oncle, sa famille et elle décident d’aller en France.
Une vie deux guerres
Shakiba Dawod est Afghane. Elle a vécu son enfance entre la guerre irano-irakienne et la guerre d’Afghanistan. Elle subit les conflits des deux pays, le racisme en Iran où ses origines l’excluent de la société.
Son retour en Afghanistan sous les bombes et les coups de feu est difficile. S’ajoute à cela l’éducation traditionnelle de son père qui la soumet à des tentatives de mariages arrangés.
Son passé éprouvant fait d’elle aujourd’hui une artiste-designer accomplie qui exerce son métier à Paris, la capitale des libertés et de la mode, où elle a pu mieux s’intégrer.
Jade BOULANGER,
Dylan DUMOULIN,
Laura-Line LOISEAU,
Candyce CHRÉTIEN.
Le viol comme arme de guerre
Savoir les écouter, première étape contre le traumatisme des femmes agressées.
De nos jours, entre 200 000 et 600 000 femmes sont violées en République démocratique du Congo. Le viol est une arme de destruction intime peu coûteuse, internationale, et sa seule preuve est la parole des victimes, même si très peu d'entre elles acceptent d'en parler. Cette pratique entraîne un état de stress post-traumatique ou une amnésie traumatique comme le montre le documentaire Woman de Yann Arthus-Bertrand. Ce reportage a été réalisé afin de sensibiliser le grand public.
Plus de 200 témoignages ont été recueillis. « Certaines femmes ont dit des choses qu'elles n'avaient jamais dites », affirme le réalisateur. Grâce à cela, « il y a une vraie libération de la parole ». Il donne la parole à des femmes tombées enceintes suite à des viols commis par des rebelles. Elles expliquent haïr cet enfant. Ces actes anéantissent la victime honteuse mais aussi des familles entières qui bien souvent sont forcées d'assister à la scène.
D'abord redonner
du courage
Une lutte contre l’impunité est effectuée pour réparer les victimes physiquement et juridiquement. La Maison des femmes, à Paris et en Seine-Saint-Denis, a été créée comme lieu pour les écouter, les soigner et les accompagner. D'autres peuvent s’aider du sport pour se réapproprier leurs corps et reprendre confiance en elles. C'est pourquoi la championne de karaté, Laurence Fischer, a fondé l'association « Fight for Dignity ». Grâce à ces moyens, des femmes ont pu surmonter les épreuves et continuer à vivre. Certaines d'entre elles sont même devenues actrices dans le combat contre les violences.
Inès BAILLEUL,
Louise DOUTRELEAU
Solène BESNARDEAU
Angèle HELLOUIN,
Eva LANCELEVEE.
Les femmes dans le processus de paix
Elles sont les grandes absentes des négociations. Et pourtant...
En partenariat avec le magazine Elle, une conférence portait sur les femmes dans la construction de la paix. Les femmes représentent la moitié de la société. Pourtant, seulement 5 % d'entre elles sont incluses dans les processus et signatures de paix alors que les chiffres nous démontrent que, lorsqu’elles sont prises en compte, il y a 30 % de plus de réussite.
Même si l'ONU a voté une résolution pour les inclure au processus décisionnel, les femmes sont encore trop absentes dans les sphères importantes et les hautes fonctions du pouvoir. Pourtant, elles devraient davantage être incluses dans la construction de la paix et avoir un pouvoir de décision. Les moments de transitions entre guerre et paix sont impactants, transformateurs, on ne peut pas exclure une partie de la société civile à ces discussions.
La place des femmes
dans la guerre
Selon l’ONU, 70 % des victimes dans les conflits sont les femmes et les enfants. Pourtant, elles jouent un rôle important dans la guerre. En effet, les femmes sont belligérantes, ce sont des actrices capitales car elles maintiennent la société, ce sont des actrices de la survie sur le plan civil et économique.
Pendant un conflit, les femmes sont au premier plan dans les mouvements pacifistes, ce qui devrait leur garantir une place dans le processus de paix.
Agir pour la paix
Des initiatives ont progressivement été adoptées afin d’intégrer les femmes dans la paix. C’est le cas de Hajer Sharief qui a créé l’ONG appelée « Together We Build » dans le but d'accroître les capacités des femmes à prendre la parole et d'occuper une place dans la construction de la paix mais aussi ensuite dans la transition politique et pacifiste.
C’est également le cas du mouvement « Extremely Good » qui permet à tout le monde d’agir et intervenir peu importe qui on est et si l’on fait ou non partie d’un mouvement ou d’une organisation.
Lou-Ann DEREIX,
Océane DUVAL.
Marche pour le climat
Le programme Walk The Global Walk favorise un modèle éducatif novateur afin de mieux comprendre les problématiques liées aux enjeux mondiaux actuels : le changement climatique, les migrations, et l’égalité entre les hommes et les femmes.
Soutenu par la Commission européenne et développé en partenariat avec 13 pays européens dont la France, ce programme pédagogique permet à des jeunes de s’engager en faveur des objectifs du développement durable de l’ONU.
Cette année encore, près de 400 élèves ont participé à cette marche pour le climat au départ de l’Abbaye aux Dames.
Tom LAINE,
Sarah LAMBERT.
Soutien au Dr Mukwege
Denis Mukwege, gynécologue et médecin, était l’invité d’honneur de la précédente édition du Forum. Prix Nobel de la paix en 2018 pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo, il est surnommé « L’homme qui répare les femmes ».
À la suite de son intervention après un massacre perpétré en juillet 2020 dans le village de Kipupu sur les plateaux du Sud-Kivu, il est actuellement menacé de mort dans son pays. C'est avec une grande émotion que les acteurs du Forum lui ont adressé une pensée et un large soutien.
Madeleine MARTIN,
Sarah LAMBERT.
Les dynamiques asiatiques face au virus
Le Covid-19 se révèle un catalyseur de tensions entre la Chine et les pays voisins.
Le terme de nouvelle guerre froide semble s'appliquer aujourd'hui aux relations entretenues par les pays asiatiques. De nombreux domaines sont impliqués : géopolitique, géostratégique et idéologique. Face à ces tensions, la crise du Covid-19 a eu un effet catalyseur et révélateur des conflits déjà présents.
Pour la Chine, trois tendances se précisent : une agressivité croissante de la communication chinoise, une coopération de plus en plus étroite entre la Chine et les États-Unis ainsi qu'une détérioration de l'image de la Chine avec la prise de conscience de notre dépendance à son égard.
Taïwan et la Corée du Sud face à la crise du Covid-19
Le traumatisme SRAS à Taïwan a entraîné la création d’un centre de commandement activé dès janvier pour diriger le système de santé. La culture du masque étant déjà présente, la quarantaine obligatoire, le civisme de la population et la confiance mutuelle entre le gouvernement et le peuple ont fait que le pire a été évité. De plus, l'alerte lancée par Taïwan au sujet du Covid-19 n'a pas été prise en compte du fait de son absence de l'OMS.
La Corée du Sud, quant à elle, fut tout comme Taïwan préparée à ce genre de crise puisqu'une petite pandémie en 2015 avait déjà eu lieu entraînant une avance sur la culture de distanciation, de masques, de tests massifs et de géolocalisation des malades. Les frontières de la Corée du Sud n'ont jamais été fermées car les autorités ont toujours été transparentes, ce qui a permis la confiance des habitants.
Le pays a également profité de la pandémie pour passer devant le Brésil et la Russie dans le classement des puissances économiques bien que la Corée du Sud, contrairement à Taïwan, n'ait toujours aucun plan de relance dans certains de ces secteurs économiques.
Les conséquences internationales
de cette crise
Le Covid-19 fut la première pandémie à déstabiliser et détériorer autant les relations internationales.
La Chine a des relations tendues avec ses voisins qui découlent de sa volonté de puissance. Les rapprochements entre Taïwan et Hong Kong ont entraîné des révoltes au sein du pays.
Cela fait peu de temps que l’UE prend part aux tensions en dénonçant certaines conditions de travail, le travail forcé, les questions autour des droits de l’homme et l’accès au marché chinois.
La Chine refuse toute concession, ce qui complexifie la création d'un accord. Il y a un domaine où la discussion avec la Chine est facile : les questions climatiques qui sont prises très au sérieux par Pékin. Ceci peut être vu comme un point d’amélioration dans les relations internationales.
Au final, dans ce contexte de tensions entre les différents États asiatiques, la question des moyens pour parvenir à une amélioration des relations interétatiques en Asie se pose. Elle concerne essentiellement la Chine et les États-Unis et met en lumière l’importance d’une politique multilatéraliste de la part de ces deux États. La Chine en acceptant certaines concessions et les États-Unis en cessant de diaboliser la politique chinoise sans preuves.
Dehbia BEKKOUCHA
Marius BEYNET,
Clément FREON,
Max LEMEE,
Luna OUF,
Théo BESNARD.
L'appel de Barbara Hendricks
Temps fort de ce Forum, l'intervention de la célèbre cantatrice. Barbara Hendricks a encouragé les femmes lors de la conférence qui leur était dédiée : « Vous aussi soyez sur le devant de la scène. » Aujourd'hui âgée de 72 ans, elle est née en Arkansas aux États-Unis pendant la ségrégation. Elle est engagée depuis de nombreuses années dans diverses causes humanitaires parmi lesquelles la cause des réfugiés ainsi que la lutte pour les droits civiques.
Après vingt ans de combat pour cette cause, elle a reçu le titre d’ambassadrice à vie du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies. Du fait de son parcours, elle a conscience des difficultés de la place des femmes dans le processus de paix. Celles-ci obtiennent de meilleurs résultats lors des négociations. Pourtant, les femmes en sont souvent écartées alors même qu’elles occupent une place centrale notamment en tant que victimes de guerre.
C’est en travaillant auprès de ces femmes qu’elle a acquis cette expérience et souhaite ainsi que la femme ait une place plus importante dans la construction de la paix et dans les organisations internationales, comme elle l’a expliqué lors du Forum mondial Normandie pour la Paix où elle était présente en tant qu'invitée d'honneur.
Ela GALLAIS,
Avril CHARRAS.
Les procès du terrorisme augmentent
Le système judiciaire français face à « l'exception du quotidien »
Antoine Mégie, chercheur à l’université de Rouen, parle des procès « historiques » du terrorisme, en particulier ceux qui concernent les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher en janvier 2015, commencés en novembre 2020. Ces procès sont filmés, un fait rarissime, et sans public à cause des conditions sanitaires. Seulement douze procès ont été filmés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme l’affaire Seznec en 1954. L’année prochaine, de septembre 2021 à février 2022, se déroulera celui des attentats du 13 novembre 2015, dit du Bataclan. Ce sont des procès inédits de par leurs spécificités. La violence terroriste fait dorénavant partie de nos quotidiens et marque la société française. Il se pose alors la question de la place de la justice dans le jugement de ces affaires. Les juges doivent-ils mener des mesures d’exception ?
« L'exception du quotidien »
Depuis 2015, ils portent sur 220 audiences et quatre à cinq dossiers sont consacrés à des faits terroristes contre seulement 2 à 3 procès par mois avant 2015. Par conséquent, il y a une augmentation des condamnations pour participation à des activités terroristes. Ces procès sont jugés dans les tribunaux correctionnels ou aux assises.
Qu'en est-il de l’impact médiatique ?
Les palais de justice sont plus sécurisés et les dessinateurs remplacent les caméras. Il n’y a pas de jury populaire, seulement des magistrats spécialisés dans les dossiers terroristes. Enfin, de plus en plus d’avocats se posent la question du « droit de défense de tous les justiciables ». Mais, sans défense, il n’y a plus d’État de droit. Les règles juridiques de la justice française ne seraient pas respectées car « Toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial et d'être défendue par un avocat » selon l’article 6 de la CEDH, la Convention européenne des Droits de l’homme.
Valentin BOUDOT, Julien LIOT, Théo REIGNIER.
Les jeunes de plus en plus engagés
En jeu, la place des femmes et la défiance à l'égard du politique, au profit des ONG.
Un engagement se qualifie par la volonté de se battre pour une lutte.
La question climatique
L'urgence climatique est un engagement majeur chez les jeunes car protéger l’environnement, c’est protéger la paix. De nos jours, on considère qu’un tiers des espèces auront disparu en 2050. Cette extinction massive révolte la jeunesse et accroît sa volonté de s’engager. La mobilisation écologique et la science sont des causes communes, moralement justes. Les activités individuelles écoresponsables sont indispensables pour s’engager mais il faudrait travailler sur des dynamiques collectives.
La paix et la question
des femmes
Progressivement, de nombreuses figures féminines émergent comme Greta Thunberg, jeune militante suédoise pour le climat. L'ONU, acteur de cette dynamique et plateforme multilatérale, devient féministe et essaie de légitimer les voies féminines face aux politiques. De nombreuses femmes comme Malala Yousafzai se battent publiquement pour leurs droits. Cette jeune militante reçoit à 17 ans le prix Nobel de la paix en 2014 et devient la plus jeune lauréate de ce prix. Nadia Murad, quant à elle, lutte contre le terrorisme et la traite des humains. Elle reçoit le prix Nobel en 2018 à 24 ans.
Le multilatéralisme et les limites de l’engagement
Le multilatéralisme est un système de relations internationales apparu sous une première forme à la suite de la Grande Guerre. Il privilégie les négociations, les coopérations et les accords dans le but d’instaurer des règles communes. Il se manifeste à travers plusieurs organisations internationales telles que l’ONU, l’OTAN, le G20... Ces organisations ont montré leur efficacité mais leur fonctionnement est parfois limité. Toutes essaient d’intégrer la jeunesse mais la fracture entre les 16-30 ans et les aînés est encore trop présente. Cela peut s’expliquer par un manque de confiance de ceux-ci. Beaucoup de jeunes décident donc de se tourner vers des ONG.
Agathe LACAILLE,
Cloé DEFERT,
Lucien RAULT.
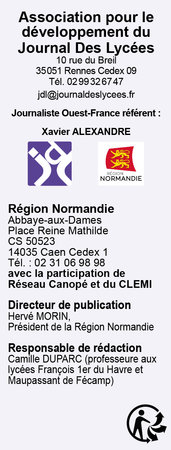
L'Amazonie, le « continent vert » à protéger
La mondialisation menace les forêts, en particulier le « poumon de la planète ».
Communément appelée « poumon de la planète Terre », l’Amazonie nous livre 20 % de l’oxygène que nous respirons. Elle s'étend sur 5,5 millions de km² répartis sur neuf pays. Or, cette ressource est amenée à fortement s’amenuiser au fil du temps de par l’activité humaine. Celle-ci représente seulement 0,01 % de la vie sur Terre, mais en ayant déjà détruit 83 % ils sont désormais les plus gros destructeurs de la biodiversité.
Les grands acteurs contemporains voient à travers l’Amazonie un enjeu économique et agricole, les poussant à agir aux dépens de l’environnement. En effet, le cas de la déforestation s’aggrave avec plus d’un milliard d’arbres déjà abattus. Leurs actions mènent à une forte pollution des fleuves, à de grands feux de forêts… menaçant fortement les autochtones et la biodiversité locale.
Une nouvelle voie d’expression pour les autochtones
Les autochtones sont en danger et cherchent à faire entendre leur détresse. Au cours du Forum, Cacique Ninawa, chef amazonien de la vallée de Javari, est intervenu via Skype afin de sensibiliser les Occidentaux à son territoire en voie de disparition. Sa voix a semblé être entendue et a touché les auditeurs. Céline Cousteau, petite-fille du célèbre commandant Cousteau, était présente. Elle a choisi de dénoncer et d’écouter ces populations coupées du monde. Proche de l’Amazonie comme son grand-père, elle a réalisé le documentaire Tribes on the Edge. Le président de Planète Amazone, Gert-Peter Bruch, également présent en tant que modérateur, a quant à lui réalisé un long-métrage nommé Terra Libre où il retrace trente ans de lutte concernant principalement le climat, les forêts et la biodiversité. L'Amazonie, ainsi que les autres forêts du monde comme celle du Congo par exemple, présente une problématique planétaire qu'il faut régler au plus vite afin de ne pas mettre en péril la survie de tous les êtres vivants.
Éléonore BOQUET-BELLET,
Jade GOMIS,
Victoire MOLLET.
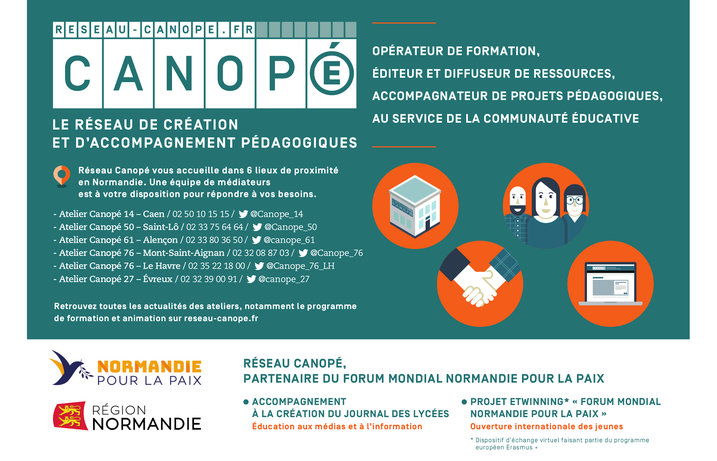
La diplomatie européenne agit
C’est une question récente car le projet initial de l'Union européenne était de garantir la paix après la Seconde Guerre mondiale, mais pas de se positionner sur la scène internationale. Le débat était mené par Alain Leroy, secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure de 2015 à 2016, Elena Lazarou, Monika Nogaj, service de recherche du Parlement européen, et Serge Stroobants, directeur de l'Institute for Economics and Peace.
Grâce à la PSDC (Politique de sécurité et défense commune), l’Union européenne assure la sécurité, gère les crises comme le terrorisme et les cyberattaques. C’est avec 7 milliards de fonds qu’elle mène des opérations militaires : 19 jusqu’alors comme l’opération Atalanta, pour lutter contre l'insécurité des côtes africaines dans l'océan Indien. L’UE adopte aussi une politique de voisinage pour assurer paix, stabilité et développement aux 16 pays ayant une frontière terrestre ou maritime voisine, notamment la France avec l'Allemagne. Avec une aide financière et une coopération politique avec ces pays, elle vise à établir un espace de prospérité.
L’UE est l’une des économies les plus ouvertes sur le monde. Elle est le premier exportateur mondial avec la Chine. Elle occupe également une place importante dans le commerce international. De plus, elle s’engage, d’ici à 2030, de réduire à 55 % ses émissions de gaz à effet de serre. Elle essaie donc de prendre une place importante pour limiter le réchauffement climatique.
Juline DAUBEUF.

La perte de confiance s'étend
Lors du débat « Comment restaurer la confiance », nous avons pu écouter tout d’abord Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po Paris, qui évoquait la question à l’échelle de la France. Ensuite, Arthur Goldhammer, traducteur américain, au niveau des États-Unis, et Marc Van Der Woode, professeur de droit de la concurrence à Rotterdam, ont clôturé la session en démontrant le point de vue de l’Europe.
M. Perrineau a expliqué que le peuple français était celui qui avait le moins confiance en ses institutions. Notre société est défiante envers le gouvernement, on a confiance en nos proches, voisins, armée, hôpitaux et aussi la police. Or, la confiance est un ressort décisif du fonctionnement de la démocratie. Avec cette perte de confiance, un Français sur trois souhaiterait un régime autoritaire, selon l’IFOP en 2018.
M. Goldhammer a poursuivi ce débat en disant que les inégalités augmentent aux États-Unis entre l’élite et le peuple puisque c’est un pays basé sur la politique du capitalisme. Donc, le peuple moins aisé est mis de côté. Contrairement aux Français, les Américains ont plus confiance en leurs institutions et gouvernement.
M. Van Der Woode a conclu avec l’Union européenne en nous disant que les peuples confondaient la politique de leur nation avec la politique européenne. Le Parlement européen utilise l'eurobaromètre pour mesurer la confiance des peuples. Dans l'ensemble, le ressenti est positif même s'il varie entre les États. La France garde un sentiment de défiance envers les institutions européennes. La confiance est remise en cause avec la montée de l’individualisme.
Léa GOSSET,
Aurélia SIMON,
Nathan LAVIGNE.