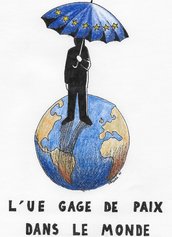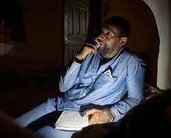Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Édito
En raison du contexte sanitaire, la 4e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix a dû être reportée les 30 septembre et 1er octobre 2021. Rendez-vous annuel ouvert à tous, le Forum est un lieu de réflexion et d’échanges pour contribuer à la construction d’une paix durable dans le monde.
Sur le thème « Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? », le Forum proposera des pistes de réflexion et d’action pour mieux gouverner la paix autour de deux questions majeures : pourquoi la paix nous échappe-t-elle ? Et comment reprendre la paix en main ?
La pandémie de Covid-19, les crises économiques de ces dernières décennies ainsi que l’augmentation des conflits dans le monde ont accentué les difficultés des institutions internationales à maintenir leur rôle de « gardiennes de la paix ». Ce constat, les lycéens du lycée André Malraux de Gaillon l’ont retranscrit à travers la 4e édition du journal « La Colombe ». Ces articles, travaillés en lien avec leurs professeurs et encadrants vous plongeront au cœur de l’actualité internationale et vous donneront un avant-goût des sujets qui seront abordés à l’occasion du Forum.
Je tiens à féliciter le travail de ces jeunes et vous donne rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre pour la 4e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix.
Bonne lecture !
Hervé Morin
Président de la Région Normandie
Une gageure : « Gouverner la paix »
Un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien vient de se clore par un cessez-le-feu précaire entre le Hamas et le gouvernement Netanyahou. Il rappelle la lancinante exigence à construire la paix et cristallise de nombreux enjeux qui seront au cœur du Forum mondial Normandie pour la Paix. Ce numéro, réalisé par des lycéens de Première HGGSP (Histoire Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques) de Gaillon, en dresse plusieurs axes. Notre photo : Des enfants dans les ruines d'un immeuble regardent les bâtiments détruits par des frappes israéliennes, le 21 mai 2021 à Gaza.
L'Organisation des Nations Unies à la peine
La gardienne de la paix mondiale a su s'adapter mais est aujourd'hui remise en cause.
Le réveil du conflit israélo-palestinien au Proche-Orient pose à nouveau la question de la capacité des Nations unies à maintenir la paix.
Une réforme nécessaire
Créée en 1945, l’ONU a toujours eu un rôle de « gardienne de la paix mondiale » mais elle est de plus en plus remise en cause. Les tensions entre les États membres et le fait que les cinq membres du Conseil de sécurité (États-Unis, Chine, Royaume Uni, Russie, France) utilisent leur droit de veto de manière récurrente ont poussé les autres membres de l’ONU à poser la question d'un pouvoir monopolisé par cinq États. Ils ont été désignés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne correspond plus tout à fait au contexte actuel.
Les 193 membres de l’ONU se sont réunis en novembre 2020 pour discuter d’une éventuelle réforme du Conseil de sécurité. Mais les divergences restent très fortes.
Des tensions entre les États créent des obstacles à ces réformes. Par exemple, le Pakistan préférerait quitter les Nations unies plutôt que de voir l’Inde accéder à un siège permanent. En décembre 2016, la Russie a utilisé son véto à sept reprises sur des projets de résolution qui auraient limité les souffrances des Syriens dans la ville d’Alep.
Selon le diplomate turc, Volkan Bozkir, président de l'assemblée générale des Nations unies, il est urgent et inévitable de réformer l’ONU : « À de nombreuses reprises, le Conseil a failli à sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationale. » La plupart des pays demandeurs sont des pays qui ont émergé il y a peu (Turquie, Inde, Kenya…). Ils voudraient réformer le Conseil de sécurité pour laisser place à un conseil qui les représenterait davantage.
L'UE à la place de la France
Bien que l’ONU ait déjà connu plusieurs évolutions comme la création de la Force de maintien de la paix des Nations unies, aussi appelée les « casques bleus », ou son ouverture aux ONG, la question d’une réforme du Conseil de sécurité se pose toujours.
Plusieurs hypothèses ont été émises, comme l’élargissement du nombre de membres permanents au Conseil de sécurité ou encore l’idée que la France cède son fauteuil de membre permanent et qu'il soit occupé par l'Union européenne .
Cassandra BOUCHET-GUILHO,
Marina GEANCY.
L'Europe et la paix hors de ses frontières
Une politique commune lui fait défaut, mais l'Union européenne veut jouer un rôle.
L’Union européenne (UE), actuellement composée de 27 États, a été fondée en 1993 par le traité de Maastricht. Il s’agissait à l’origine d’unir les pays européens sur le plan politique et économique pour garantir une paix durable sur le continent.
Il n’existe pas de réelle politique étrangère commune au sein de l’UE, chaque État membre demeure souverain en la matière. Pourtant, l’UE cherche à s’affirmer dans le domaine. Ainsi, le poste de haut représentant de la politique étrangère actuellement occupé par Josep Borrell a été créé en 2007 dans le but de donner corps à la politique étrangère européenne à l’échelle mondiale.
Les sanctions
contre la Russie
L’UE use de différents moyens pour défendre ses valeurs et promouvoir la paix dans le monde. Par exemple, en 2014, elle a mis en place des sanctions contre la Russie pour répondre à l'annexion de la Crimée qui a provoqué une crise diplomatique internationale. La Crimée est une presqu'île au sud de l’Ukraine.
Les sanctions initiales ciblaient 21 personnalités russes, leur interdisant de voyager dans l’UE et gelant leurs actifs financiers. L’UE interdit les importations de Crimée sans certificat d’origine ukrainienne.
La Russie a réagi à ces sanctions en restreignant sa coopération économique avec l’UE : elle a décrété un embargo alimentaire en 2014 et, en 2015, interdit à une liste de personnalités européennes de séjourner à l'intérieur du territoire russe. Ces mesures sont inefficaces car elles atteignent rarement les objectifs qu’elles poursuivent.
À l’heure actuelle, Joe Biden semble durcir le ton tout en appelant à une relation stable.
Le maintien de la paix
dans le cadre onusien
L'UE intervient aussi dans la prévention des conflits en coopérant avec les Nations unies. Contribuant pour un tiers à son budget, elle est mandatée pour réaliser des opérations de maintien de la paix.
Ainsi, en 2003, l’opération Artémis est la première opération militaire de l’UE au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) en dehors du continent européen. Elle est lancée à la demande de l’ONU en Ituri, en République démocratique du Congo, afin de mettre fin aux combats.
L'UE dépendante
des États-Unis
L’UE reste dépendante du « parapluie américain ». Le retour du multilatéralisme annoncé par Joe Biden peut représenter un espoir de renouveau des relations transatlantiques et de l'OTAN pourtant déclaré en « état de mort cérébrale » sous la présidence de Donald Trump.
Nathan BISSON, Arthur PÉRIER.
L'impossible rêve d'une justice universelle
L'exemple du Rwanda révèle un processus long et encore fragile.
À l’automne 2020, Félicien Kabuga, accusé d’être le financier du génocide rwandais, a été remis à la justice internationale. La création du Tribunal pénal international du Rwanda (TPIR) remonte pourtant à 1994. Le conflit a provoqué près d’un million de morts en trois mois. Des responsables sont encore poursuivis en 2021.
Après la guerre froide
Cinquante ans après les procès de Nuremberg et de Tokyo, l’idée de justice internationale, née en 1872, se concrétise à nouveau dans les années 1990 après la parenthèse de la guerre froide. Tandis que les Nations unies travaillent à l’élaboration des statuts de Rome, des tribunaux internationaux sont créés pour juger des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.
Les procédures pénales internationales sont possibles mais extrêmement longues.
Ainsi, le TPIR a permis de juger, après vingt ans de procédures, 93 personnes pour génocide et violations graves au droit international humanitaire commis à l’encontre des Tutsis. 62 ont été condamnées. 4 ont été renvoyées devant des juridictions nationales, 2 sont en fuite.
Une fragilité qui perdure
La compétence de la Cour pénale internationale (CPI) est assez limitée. Elle ne peut juger que quatre catégories d’infractions, considérées comme les plus graves : crimes contre l’humanité, génocides, crimes de guerre et crimes d’agression et n'intervient que si le crime a été commis sur le territoire d’un État ayant signé la convention.
Enfin, la compétence de la Cour est complémentaire, elle n’est possible qu’en cas de défaillance de l’État pour juger le criminel. Cette limitation du rôle de la CPI souligne la difficulté pour la communauté internationale de construire une véritable justice pénale universelle. 32 États n’ont jamais ratifié le statut de Rome, fondateur de la Cour et d’autres ne l’ont même pas ratifié. De plus, en 2016, le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur décision de quitter la Cour pénale internationale. Ce qui témoigne de la fragilité d'une justice universelle.
Janys PORTEBOIS,
Alice MARTEL.
Joe Biden clôt définitivement l'ère Trump
Après 120 jours au pouvoir, le président démocrate impose son empreinte.
Joe Biden est à la tête de la première puissance mondiale depuis le 20 janvier 2021. Il est le 46e président des États-Unis.
La rupture
Dès le début de son mandat, Biden a souhaité renouer avec le multilatéralisme. Il a rejoint les accords de Paris tandis que son prédécesseur avait tourné le dos à la réalité du réchauffement climatique.
Biden réaffirme aussi l'attachement des États-Unis aux droits humains et à la démocratie : il a condamné les violences en Birmanie et le génocide arménien, durcissant ainsi le ton envers la Turquie mais aussi contre la Russie en qualifiant Vladimir Poutine de « tueur ».
Dans la continuité
D'un point de vue économique, le pays demeure toujours en forte concurrence face à la Chine : Biden, à ce titre, continue la politique agressive de Trump.
Dans la lignée de ces prédécesseurs au Moyen-Orient, il a aussi annoncé le retrait définitif des troupes américaines en Afghanistan, mettant ainsi terme à vingt ans de guerre et a renouvelé le soutien des Etats-Unis à Israël en tension avec les Palestiniens, précisant qu'« Israël a le droit de se défendre » .
Reste le défi intérieur
Même si le bilan de la lutte contre la Covid-19 est positif (le port du masque n'est, par exemple, plus obligatoire pour les personnes vaccinées), Biden est confronté au défi de l'immigration. Alors que Trump voulait renforcer et étendre le mur entre les États-Unis et le Mexique, Joe Biden peine à réguler les flux tout en préservant les droits des migrants.
De la même façon, l'invasion du Capitole par les « pro-Trump » au lendemain des élections risque de laisser des traces dans un pays encore déchiré par le racisme.
En 100 jours, le nouveau président des États-Unis surprend en offrant l'image d'un chef d'État déterminé à replacer la première puissance mondiale au cœur du jeu diplomatique.
Antoine MENISSEZ,
Lucas LEBOURG,
Jade PIGACHE.
Le Yémen, un conflit encore trop oublié
Le pays de la péninsule arabique s'enfonce dans une crise humanitaire désastreuse.
Le Yémen est un pays arabe situé à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique. Depuis 2014, le pays est déchiré par une guerre civile opposant les rebelles chiites Houthis au gouvernement Hadi. Manque de nourriture, maladies, déplacements de population et impossibilité d'accéder aux services essentiels sont le lot quotidien des Yéménites.
Un conflit complexe
La guerre au Yémen a longtemps été ignorée et demeure difficile d'accès pour les médias. Particulièrement complexe, elle est devenue un conflit international engageant, entre autres, l'Arabie saoudite et l'Iran.
Des intérêts contradictoires animent les puissances occidentales, la France et les États-Unis en particulier, montrées du doigt en raison de leurs ventes d'armes aux pays du Golfe persique. Malgré l'enlisement du conflit, les États-Unis ont signé pour 130 milliards de dollars de livraison d'armes à Riyad. Le prince saoudien Mohammed ben Salmane a bénéficié d'un appui inconditionnel de Donald Trump.
Désastreuse, la situation humanitaire a été qualifiée de « pire crise au monde » par les Nations unies : plus de vingt-deux millions de Yéménites ont besoin d'aide alimentaire, soit trois habitants sur quatre, dans un pays où les infrastructures, déjà fragiles, ont été largement détruites.
En France, des associations humanitaires comme Amnesty International réclament la fin des livraisons d'armes françaises à Riyad. Aux États-Unis, le New York Times a publié des photos insoutenables d'enfants mourant de faim au Yémen, renforçant ainsi la pression médiatique. Les Nations Unies espèrent organiser des négociations de paix en Suède avant la fin de l'année.
Le 4 février, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé la fin du soutien américain à la coalition emmenée par l'Arabie saoudite, en mettant un terme à certaines ventes d'armes au royaume. Le 46e président des États-Unis a déclaré que les « efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Yémen seront renforcés ».
Chloé PIGNÉ, Jade BARBÉ,
Léa DELCOURT.
Lueur d'espoir pour la médiation en Libye
Après plus de dix ans de guerre civile, l’imbroglio tend à se dénouer à Tripoli.
Depuis la mort en 2011 du dictateur Khadafi, la Libye est en guerre civile.
En 2015, l’ONU a organisé un « processus de réconciliation internationale » pour rétablir la paix et organiser des élections. Malheureusement, ce projet ambitieux a été entravé par plusieurs facteurs.
Les groupes politiques et armés impliqués dans cette guerre sont soutenus par divers États et organisations extérieurs au pays. Le GAN (Gouvernement d’accord national), est soutenu politiquement par la communauté internationale et militairement par la Turquie, et l’ANL (Armée nationale libyenne) par la Russie.
Ces deux puissances mêlent leurs propres intérêts au conflit, au détriment de l’ONU. Par exemple, après un accord commun pour prolonger le cessez-le-feu, les Turcs et les Russes ont préféré ignorer ce progrès pour préserver leurs récents gains stratégiques (pétrole...). Le pays est donc une zone de non-droit où règnent toutes sortes de trafics.
De plus, les démissions successives de Ghassan Salamé et Nickolay Mladenov, chefs de la Mission d’appui des Nations unies en Libye, en mars et décembre 2020, ont encore compliqué ces réconciliations. En revanche, des élections ont eu lieu le 5 février 2021 pour élire un gouvernement stable.
Vers des élections
Le groupe d’Abdel Hamid Dbeibah a été élu à la quasi-unanimité. Un remplaçant de Ghassan Salamé et Nickolay Mladenov a aussi été mis en place et s’entretient déjà avec le nouveau gouvernement libyen.
Pour finir, le Conseil de sécurité encourage le groupe de Dbeibah à se préparer pour les élections présidentielles et parlementaires de décembre prochain.
Tout cela laisse présager une issue favorable après ces dix années de guerre. Reste à espérer que le cessez-le-feu soit ainsi respecté et que les élections se déroulent sans accroc.
Titouan CLIVILLE,
Siméon LUKIC.
Les espoirs déçus du Printemps arabe
Après une vague de soulèvements inédite, le désenchantement.
Le Printemps arabe a commencé le 17 décembre 2010, en Tunisie. Les contestations se sont propagées dans dix-sept pays en l’espace de quatre mois.
Les peuples du Maghreb et du Moyen-Orient dénoncent partout les conditions de vies devenues insoutenables, la corruption des systèmes politiques contrôlés par de petits groupes d'individus et l’absence de libertés.
Malgré la dureté de la répression et la censure exercée sur les réseaux sociaux, le mouvement a permis de renverser trois dictateurs en Tunisie, en Libye et en Égypte, suscitant une vague d’espoir sans précédent. Mais la plupart du temps, les tenants du pouvoir sont restés en place et partout les groupes islamistes, comme les Frères musulmans, ont tenté de récupérer les mouvements.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Les révoltes arabes n’ont pas fonctionné dans tous les pays, certains s'en sont bien sortis, alors que d'autres sont encore en guerre.
La Libye, la Syrie et le Yémen subissent encore aujourd’hui des guerres civiles devenues internationales.
Le président de l'Égypte, Fattah al-Sissi, exerce une dictature encore plus autoritaire qu'avant 2010.
En Arabie saoudite, rien n'a évolué, le Koweït et Bahreïn sont toujours dans la même situation tandis qu'au Maroc, des réformes modestes ont été réalisées face à une révolte moins soutenue.
En Algérie, le mouvement a commencé tardivement, en 2019, avec le « Hirak » qui veut dire « mouvement » en arabe.
Un bilan mitigé en Tunisie
Au final, seule la Tunisie a entamé sa transition démocratique.
Rania Chaabane, 31 ans, et Mehdi Zied, 29 ans, ont grandi avec la dictature, ils se confient à Juliette Montilly (France 24). Aujourd’hui, pour Rania, « la scène politique manque encore de maturité » alors que « les révoltes ont réuni les gens ». Mehdi confie que « le système n’a pas beaucoup changé », les politiques « n’ont pas encore compris ce que désire le citoyen tunisien » alors que le peuple tunisien « a failli mourir pour en arriver là ». Les défis sont encore nombreux. Rania a même parfois l’impression que Ben Ali n’est jamais réellement parti.
Des élections ont eu lieu en 2019. Cependant, le pays traverse une crise économique, les chiffres du chômage sont hauts, en particulier chez les jeunes qui représentent 40 % de la population.
Noé POULAIN, Esteban ABADIE, Léo ISSARTELLE.
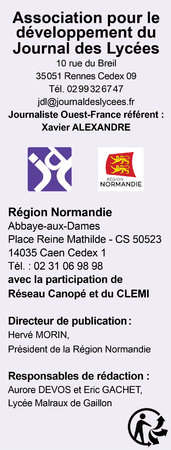
Le Liban au bord de l'effondrement
Un pays prospère il y a encore soixante ans rendu prisonnier de son système politique.
Le Liban, longtemps surnommé « la Suisse du Proche-Orient », connaît aujourd’hui une crise sans précédent.
Une crise économique
Une dette publique de plus de 90 milliards de dollars, soit deux fois son PIB, nécessaire à la reconstruction du pays après la guerre civile, pèse sur l’économie. À cela s’ajoute la crise du Covid-19, qui entraîne des licenciements massifs. Le salaire minimum a aussi été divisé par 10.
Cette économie en crise a de graves conséquences : une inflation et un taux de chômage qui s’envolent, ou encore l’effondrement de la valeur de la monnaie nationale. Aujourd’hui, c'est plus de 50 % de la population libanaise qui vit sous le seuil de pauvreté. Toutefois, le Liban espère des aides internationales.
Une crise sociale
Des milliers de familles issues de toutes classes sociales sont incapables de subvenir à leurs besoins. Sans travail, sans revenus, beaucoup déscolarisent leurs enfants par manque de moyens et recourent à des associations caritatives telles que « Al Chrafieh » pour se nourrir. Tout cela ne fait qu’augmenter la fureur et le sentiment d’abandon des Libanais.
Face à l'urgence, le pouvoir en place semble toujours indifférent et détaché de la réalité. La population s’exaspère et manifeste depuis octobre 2019. C’est donc pour exprimer un ras-le-bol général que les Libanais descendent en masse dans les rues, où les manifestations tournent souvent à la violence entre civils et forces de l’ordre. La volonté des Libanais de s’unir et de se réinventer n’a jamais été aussi forte.
Et une crise politique
La société libanaise dénonce l’inefficacité d’un gouvernement fragile, corrompu, incompétent et animé par des tensions qui n’arrangent pas la situation du Liban. En effet, depuis 1943, le pouvoir est partagé entre les différentes communautés, sunnite, chiite, chrétienne maronite, auxquelles s’ajoute le Hezbollah, parti islamiste. La classe politique est ainsi discréditée depuis longtemps auprès de la population dont les besoins ne sont pas satisfaits. À ce jour, les dirigeants n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un nouveau gouvernement ou des réformes.
Océane DESBONNES,
Najia KRIFA, Solène LEJEUNE.
La Birmanie en quête de démocratie
Depuis le 1er février, la population se soulève contre la répression militaire.
Le 1er février 2021, un coup d'État militaire a renversé la démocratie. Depuis, la population birmane manifeste quotidiennement pour reconquérir ses droits fondamentaux.
Répression féroce
La junte entretient un climat de terreur : les réseaux Internet et mobiles sont coupés, les médias locaux indépendants ont été interdits, les droits du peuple sont restreints. Près de 800 civils ont été tués et plus de 3 600 arrestations ont eu lieu.
Développement entravé
Le pays n’a connu que de brèves expériences démocratiques depuis son indépendance, en 1948. La plus importante est celle de ces dix dernières années.
Aung San Suu Kyi, fille du leader du mouvement d’émancipation, Aung San, en est le symbole. Elle a bénéficié d'une éducation dans de grandes écoles comme Oxford et a permis à la population de se moderniser et d'avoir accès à de nouveaux droits. Elle est aujourd’hui emprisonnée.
C’est aussi le développement économique récent et encore fragile qui a permis l'accès aux nouvelles technologies. L’armée vient l'entraver mais les Birmans ne souhaitent pas perdre leurs libertés et leurs droits.
Population déterminée
Ils manifestent, appellent aux regroupements. La population répond dans le calme et se fait entendre par son silence.
Le salut à trois doigts d'Hunger Games est devenu un symbole fort de la lutte pour la pro-démocratie. Il a déjà été utilisé en 2014 en Thaïlande après un coup d'État.
Malgré l'absence de réactions d'un Conseil de sécurité une nouvelle fois paralysé, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions économiques sur des entreprises contrôlées par l'État.
Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire plier les responsables birmans encore financés par des entreprises comme Total.
Laina THERON.
La démocratie menacée à Hong Kong
L'ex-colonie britannique acculée face à la répression de la Chine communiste.
Depuis deux ans, les Hongkongais s'opposent à la loi d’extradition qui permet le transfert vers la Chine de n'importe quelle personne considérée par Pékin comme « fugitive ». Ils redoutent la remise en cause de leurs libertés.
Les revendications s'accumulent
Suite aux violences policières, les manifestants réclament le départ de la chef de l'exécutif Corrie Lan et la libération de leurs compatriotes arrêtés comme émeutiers. Ces manifestations sont animées par des groupes variés et organisés, comme celui des partisans de l’indépendance ou de professionnels composés essentiellement de juristes mais aussi des étudiants comme Agnès Chow, leader du parti pro démocratique « demosisto ».
Ces manifestations prennent plusieurs formes : désobéissance civile, barricades, émeutes, cyberactivisme Les modes d'action sont multiples.
La répression s'intensifie
On recense aujourd'hui plus de 10 000 arrestations. Des procès ont aussi été engagés même si les manifestations n’ont pas de réel organisateur mais plutôt des figures comme M. Lee.
Les têtes tombent : neuf acteurs de l'opposition hongkongaise ont été désignés coupables le 1er avril 2021. Parmi eux, l'ex-députée de l'opposition Margaret Ng, avocate de Martin Lee, rédacteur de la loi fondamentale qui régit la péninsule, et le patron de presse, Jimmy Lai. Ces sentences sont représentatives de la forte répression qu'exerce le gouvernement chinois pour étouffer toutes velléités de préserver un pays pour deux systèmes.
La Chine a engagé depuis 2020 une reprise en force de Hong Kong par la loi, d'abord sur la sécurité nationale adoptée le 30 juin 2020, aucune manifestation n'est désormais possible, mais aussi du code électoral renforçant un peu plus le contrôle de Pékin sur HongKong. Les autorités ont, au prétexte du coronavirus, reporté d'un an les élections législatives où l'opposition pouvait encore espérer être représentée.
Evann QUERE
et Pablo LAFERTE-ROUXEL.
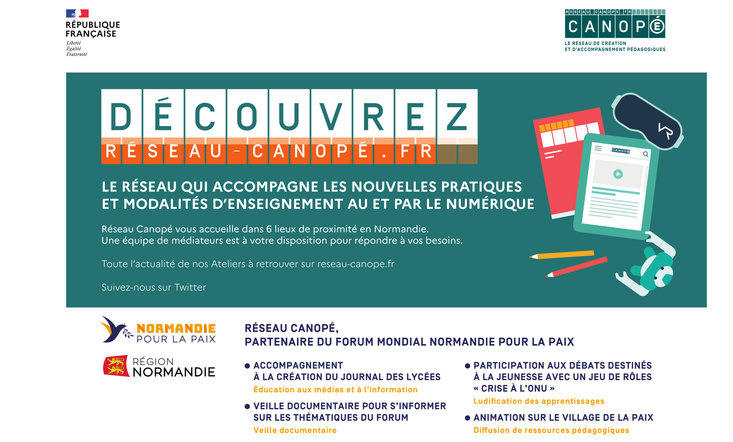
L'intégration forcée subie par les Ouïghours
Cinq questions/réponses sur le drame de la minorité chinoise turcophone.
Les Ouïghours sont des Chinois musulmans, situés majoritairement dans la province du Xinjiang. Cette communauté turcophone représente plus de onze millions de personnes en Chine, et est aussi présente dans le monde.
Quelle est la cause du conflit ? Qui en sont les acteurs ?
Le pouvoir communiste chinois reproche aux Ouïghours de ne pas être assez « investis » dans leur société. Il souhaite qu’ils s’intègrent dans leur culture car Pékin refuse les traditions des ethnies minoritaires par peur que ces dernières forment un contre-pouvoir.
La propagande faite par le gouvernement joue avec une autre peur, celle du terrorisme, dont sont souvent taxées les minorités musulmanes par le pouvoir autoritaire. Le gouvernement se sert de cet amalgame pour légitimer leurs actes.
Quelles conséquences ?
Pékin a décidé d’éliminer la culture ouïghoure. Des « camps de rééducation » ont été créés en 2015 dans le but de les rendre plus « Chinois » en les forçant à apprendre le mandarin et à lire les textes du Parti communiste, pourtant contradictoires à leur religion.
Les femmes y sont stérilisées et violées, leurs organes font l’objet d’un trafic et la garde de leurs enfants leur est retirée. Certains médias parlent même de « génocide ».
Par quel biais ce problème est désormais connu de tous ?
Les actions pour faire changer cette situation se sont multipliées grâce aux réseaux sociaux, aux journalistes, aux rescapés ayant pris la parole et aux révélations faites par les organismes internationaux sur le sort des minorités, comme l’ONU qui souhaite intervenir.
Que peut faire la communauté internationale ?
Les États-Unis et l’Union Européenne dénoncent les agissements de Pékin. Washington a pris des mesures punitives sanctionnant onze entreprises chinoises impliquées dans l’exploitation des Ouïghours. Pékin a répondu en interdisant l’accès à son territoire à six Européens dont plusieurs élus du Parlement.
Comment la société civile peut alors contribuer à l’évolution de cette cause ?
Des comptes engagés comme « ouighours.news » publient l’évolution de la situation.
Des pétitions numériques ont amassé plus de 270 000 signatures via change.org.
Des dons permettent de soutenir la cause.
83 grandes enseignes considérées comme complices, comme H&M, sont l’objet d’un boycott.
Anaelle GASPARD,
Maryne DENNIS,
Erwann ZE EYA'AN.

Reporter de guerre, un métier à haut risque
En 2020, cinquante journalistes ont été tués sur des conflits et 400 autres emprisonnés.
Depuis début avril, on est sans nouvelle d'Olivier Dubois, journaliste confirmé travaillant au Mali depuis 2015. Son enlèvement illustre bien la dangerosité du métier.
Ce métier
continue d'exister
Le reporter de guerre est un journaliste rapportant des conflits militaires tout en abordant les enjeux politiques, géopolitiques, diplomatiques, économiques et sociaux. Ils ont la possibilité d’être rattachés à une unité militaire mais la plupart travaillent indépendamment des armées.
Tour à tour écrivain, photographe ou cinéaste, il n'existe pas un modèle de reporter de guerre à l'image de Patrick Chauvel, doublement récompensé au prix des correspondants de guerre de Bayeux.
Pour Adrien Jaulmes, ex-lieutenant au 2e régiment étranger de parachutistes, à présent journaliste, un reporter de guerre « apprend sur le tas et ne rencontre pas d’école lui permettant d’apprendre à se comporter sur un champ de bataille ».
Il a couvert la plupart des conflits contemporains, comme la guerre en Afghanistan en 2001, l'invasion de l'Irak en 2003 et la guerre d'Israël contre le Hezbollah de l'été 2006. Pour lui, « ce métier continuera d’exister, d’une façon ou d’une autre ». Depuis le début de la pandémie, le métier de reporter de guerre est pourtant encore plus menacé qu’avant.
Les menaces
sont multiples
De nombreux pays déjà critiqués pour limiter la liberté de la presse ont encore renforcé la censure. La Malaisie, le Brésil, le Venezuela utilisent la Covid-19 dans le but de restreindre le travail des journalistes.
Déjà, avant la crise sanitaire, RSF avait fait le constat que beaucoup de pays sont privés de la liberté d’information. Les médias sont contrôlés par l’État comme en Corée du Nord, en Chine ou encore dans un pays en guerre comme la Syrie mais aussi entravés dans certaines démocraties européennes (Pologne, Hongrie, Slovaquie) où les reportages sont de plus en plus difficiles à mener.
Les rédactions prennent moins le risque de financer des reportages coûteux et peu rentables, c'est pourquoi davantage de reporters travaillent aujourd'hui en free lance à l'image d'Olivier Dubois.
Les journalistes sont aussi devenus des cibles, sources de financement pour des groupes terroristes.
Louise JOSSEAUME,
Ilian HIBLOT-MERY,
Tom OFFER.