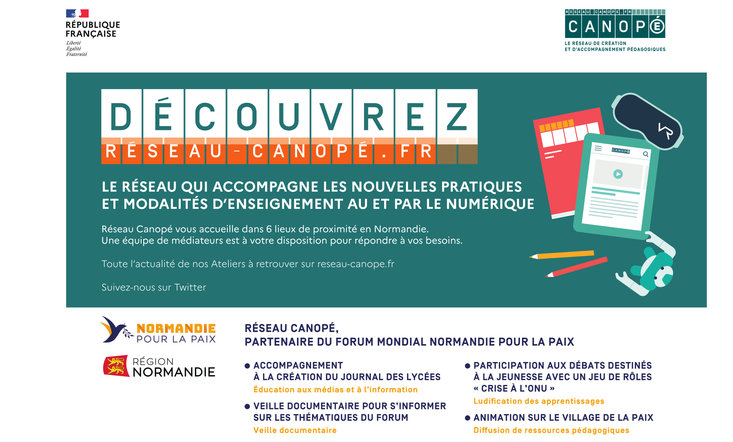Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Jeunes, acteurs de la paix à Caen
Cérémonie de remise du Prix Liberté à Sonita Alizada dans le cadre de la 4e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix organisée par la Région Normandie.
Éditorial
La quatrième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix sur le thème « Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? » a rencontré, cette année encore, un franc succès avec près de 7000 participants dont 4000 jeunes. La Région Normandie avait en effet tenu à maintenir cette édition malgré le contexte sanitaire afin que la construction de la paix ne connaisse une année blanche.
Acteurs de demain, la jeunesse a tenu une place prépondérante dans la programmation de cet événement. Chaque année, la Région Normandie, en partenariat avec les autorités académiques, déploie de nombreux programmes pédagogiques et temps forts à destination des lycéens normands. Pour la première fois lors du Forum mondial Normandie pour la Paix 2021, six débats ont été dédiées à la jeunesse autour de thématiques fortes telles que l’abolition de la peine de mort et la liberté d’expression.
En feuilletant les articles rédigés par les élèves du lycée André-Malraux de Gaillon, vous retrouverez la parole d’une centaine d’experts internationaux venus échanger sur les conflits contemporains ainsi que sur les grands enjeux de demain en termes de sécurité humaine, alimentaire et sanitaire. Compte tenu de l’actualité, la situation en Afghanistan a également été placée au cœur des débats de cette édition du Forum mondial Normandie pour la Paix. La rappeuse et militante afghane Sonita Alizada a ainsi été désignée par près de 5700 jeunes issus de 86 pays pour recevoir le Prix Liberté pour son combat contre le mariage forcé des enfants.
Le projet « La Colombe » constitue un formidable marqueur d’engagement de la jeunesse normande en faveur de la paix au travers de l’initiative Normandie pour la Paix et je tiens vivement à remercier et à féliciter les jeunes du lycée André-Malraux de Gaillon ainsi que leurs encadrants pour le travail qu’ils ont fourni dans la rédaction de cette nouvelle édition.
Bonne lecture à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous en 2022 pour la cinquième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix, évènement unique en faveur de la paix et de la liberté.
Hervé MORIN.
Président de la Région Normandie
Afghanistan : le destin dégradé des femmes
Depuis l'arrivée des Talibans, la liberté et les droits des Afghanes se détériorent.
Depuis la chute de Kaboul et la prise du pouvoir des Talibans, le 15 août 2021, les Afghanes sont face à un avenir incertain. Peu à peu, ces femmes perdent leurs droits. Elles ne peuvent plus exercer de profession ou étudier, et sont exclues de la vie politique. Le ministère des Affaires féminines est dissous. La burqa et le niqab deviennent obligatoires.
Le mouvement taliban
Les Talibans appartiennent à un mouvement fondamentaliste musulman, aussi considéré comme terroriste par de nombreux pays. Ils ont déjà été au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001. L'évacuation des soldats américains le 11 septembre 2021 permet aux Talibans d'y revenir. Certains Afghans voient un adoucissement chez les Talibans de 2021, une version plus tolérante comparée à ceux de 1996 : ils ne montrent pas ouvertement leur aversion pour les femmes et ne les harcèlent pas ou presque pas. Mais cette idée fait débat. Certains estiment que les Talibans n'ont pas changé. C'est le sentiment de Chékéba Hachemi, fondatrice de l'association Afghanistan Libre ou encore de l'ancienne députée afghane Fawzia Koofi.
Le combat des Afghanes
Depuis le 15 août dernier, les Afghanes sont en pleine résistance contre le nouveau régime. Une manifestation féminine a eu lieu le 15 septembre 2021 près du palais présidentiel de Kaboul. Mais elle a été sévèrement réprimée. Plusieurs femmes ont été frappées avec des barres de fer. D'autres manifestent à visage découvert dans les médias ou encore portent des vêtements traditionnels volontairement très colorés pour s'opposer au niqab et à la burqa bleue ou noire.
La condition des femmes se dégrade à mesure que les Talibans instaurent leurs règles et appliquent une version très stricte de la charia.
Mame Diarra SOCK,
Najia KRIFA.
Le cacique Ninawa défend son Amazonie
Le chef indien se déplace pour alerter le monde sur les risques de la déforestation.
Le cacique Ninawa a quitté son village de la forêt amazonienne pour venir à la rencontre des jeunes Normands à l’occasion du Forum mondial Normandie pour la Paix organisé par la Région Normandie, à Caen. Nous avons eu la chance d’assister à un chant traditionnel, un chant de paix qui évoque la proximité entre la nature et nous les hommes. Ce chant nous enjoint de créer une harmonie avec le monde qui nous entoure et de le respecter pour vivre en paix. Le but du chef Ninawa, aujourd’hui, est de nous sensibiliser à l’écologie et à l'environnement. Il nous incite à planter des arbres et à faire des actions locales.
Espace sacré
Ninawa signifie protecteur de la forêt. En effet, les conditions environnementales sont très importantes pour lui et son peuple. La Terre est considérée comme un espace sacré. Dès l'enfance, il s'est préparé à être chef. Cependant il n’a aucun droit de se sentir supérieur aux autres.
Il mène un réel combat contre la déforestation, qui détruit son village ou encore d'autres villages d'indigènes. Dans la forêt, il y a aussi plein d'espèces d'êtres vivants. Mais si la déforestation continue, les animaux disparaîtront tout comme les plantes médicinales. Cependant, ce n'est pas son seul combat. Il s'oppose au président brésilien Bolsonaro qui menace le droit à la terre des indigènes. Il n'a pas peur du chef d'État brésilien mais du résultat de ses actions : « La politique de Bolsonaro conduira à un génocide des peuples indigènes. »
Un film, du nom de Terra libre réalisé par Gert-Peter Bruch, permet de comprendre ce que tous les chefs indigènes essayent de défendre. Le réalisateur a contacté plusieurs chefs indigènes afin de raconter 30 ans de lutte contre la déforestation. Il montre que les indigènes sont, par leurs actions, responsables de la sauvegarde de 80 % de la biodiversité sur Terre, qu'ils sont donc des héros qui veulent éviter l'extinction de la vie humaine et de tous les êtres vivants.
Cybellia CHEMIN,
Lou-nn DA SILVA.
Justice, ouverture vers une paix continue ?
La Cour pénale internationale, une institution destinée à lutter contre les crimes.
La Cour internationale de Justice est créée en 1945, lors de la signature de la Charte de San Francisco. Le but étant de préserver les générations futures du fléau de la guerre.
On peut voir que la justice nationale est différente de la justice internationale sur plusieurs points. La justice internationale assure l'obligation de rendre des comptes sur les crimes les plus graves comme les génocides ou les crimes contre l'humanité. Tandis que la justice nationale est beaucoup plus flexible par rapport aux crimes classiques.
Essai de tribunal hybride
À cause de ces différences, une combinaison est donc nécessaire pour rendre plus efficace ces deux justices. Un premier essai de combinaison a été réalisé lors de la création des tribunaux hybrides en 2002 par la Cour pénale de Justice. Ces tribunaux sont des juridictions nationales avec une participation internationale comme le Tribunal spécial pour le Liban. Mais cette combinaison n'a pas été efficace.
La Cour pénale internationale est une juridiction permanente. Elle a été créée afin d'ouvrir des enquêtes et de juger les personnes accusées des crimes les plus graves, qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, ainsi que des génocides.
Rôle du Conseil de sécurité
Le statut de la Cour pénale internationale confère au Conseil de sécurité un double rôle.
Il peut tout d'abord la saisir, ce qui donne d'ailleurs à la CPI une compétence accrue par rapport aux autres cas de saisine.
Le Conseil de sécurité peut aussi suspendre les enquêtes et les poursuites qu'elle conduirait.
En théorie, la force de la Cour pénale internationale est considérable, puisqu'elle exclurait tout risque d'impunité du ou des auteurs de crimes qui se seraient produits dans un État qui aurait refusé la juridiction de la Cour pénale internationale. Mais cela s'applique-t-il vraiment ?
Emeline PRADEL,
Lola MAISONNEUVE.
Les complexités de l'après-guerre
Une situation pacifiée peut rester menacée par des tensions latentes.
Depuis 1991 et l'éclatement de l'URSS, les après-guerres deviennent de réels débats et des défis à surmonter pour que le terme « paix » puisse seulement être pensable dans des pays meurtris. En Colombie, les stupéfiants (cocaïne) sont à l'origine du problème majeur de l'économie du pays. Cela a des conséquences sur le système politique qui est corrompu selon le journaliste et écrivain Ed Vulliamy. Elle crée une situation violente pour la population, qui se rebelle par des assauts, des rassemblements massifs contre des groupes armés. Le refus du traité de paix en 2016 par l'armée du peuple (FARC-EP) signe une après-guerre tumultueuse qui présente finalement la continuité du conflit.
L'après-guerre en Bosnie-Herzégovine conserve les séquelles d'un massacre d'origine religieuse. Les lignes de fronts sont toujours d'actualité entre la Serbie et la Bosnie Herzégovine. Selon Rémy Ourdan, correspondant de guerre du journal Le Monde, cette situation est plus dangereuse que lors du conflit de 1992 à 1995. La haine du peuple reste présente malgré les reconstructions des mosquées en Serbie. Chacun reste autour de son culte et observe le pays voisin. Un climat de tension a envahi les territoires bosniaques et serbes depuis près de trente ans. Les accords de Dayton sont un échec, selon Thierry Cruvellier, rédacteur en chef de JusticeInfo... Cette après-guerre est finalement un conflit généralisé et laisse penser à une guerre perpétuelle mais surtout « banalisée » et ancrée dans le quotidien.
Le massacre rwandais reste le plus grand génocide après celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale avec près d'un million de morts en trois mois (07/04/1994-17/07/1994). Ainsi, des dispositifs importants, tel qu'un tribunal international, ont été mis en place pour juger ce crime organisé par les autorités rwandaises d'alors. La mémoire de ce crime contre l'humanité reste vivace : meurtriers et victimes vivent encore aujourd'hui dans des maisons voisines.
Lucile DURAND, Lou DENISE, Laina THERON.
La Russie et l'Europe, une paix fébrile
Pour les Européens, Poutine donne de son pays l'image d'un État autoritaire.
Le parti politique de Poutine, Russie Unie, a de nouveau gagné les élections législatives russes de 2021. Vladimir Poutine exerce le pouvoir en Russie depuis 2000 et il n'est pas parvenu à instaurer une paix durable entre la Russie et les pays alentours. C’est pourquoi l’Europe veut travailler avec la société civile russe.
Une population
sous contrôle en Russie
La politique de Poutine utilise énormément la propagande pour pouvoir contrôler la population. La Russie est classée au 150e rang sur 195 en ce qui concerne la liberté d'expression. Tous les médias sont soumis à la censure. Le média indépendant Doge ne possède pas de chaîne TV et il est difficile de trouver sur Internet ses propos opposés à la politique de Poutine. Le média Russia Today, lui, est une chaîne créée et contrôlée par le gouvernement. Elle n'hésite pas à falsifier des images ou des vidéos afin de rendre favorable l’opinion envers le gouvernement. Par ailleurs, les opposants sont pourchassés.
Alexeï Navalny est l'opposant russe le plus médiatisé dans le monde car il n'a pas peur de s'opposer au gouvernement russe et de le dire ! Il a été empoissonné en juillet 2019. Il a survécu mais il a été arrêté en Russie le 17 janvier 2021 et condamné à 2 ans et 8 mois d'emprisonnement à la prison de IK-2. Récemment, Alexeï Navalny a obtenu le prix Sakharov, décerné par le Parlement européen pour la liberté de l'esprit.
Des relations tendues
avec les pays à proximité
La Russie semble diplomatiquement refermée sur elle-même, surtout depuis l'annexion en 2008 de la Crimée, une région d’Ukraine. Ce fut une transgression à l’accord d'Helsinki. Cet accord, signé par 33 pays européens à la fin de la guerre froide, permettait de maintenir une bonne entente et le pacifisme entre les pays signataires dont faisait partie la Russie. Ce genre de désaccord avec le monde occidental ne date pas d’hier. Depuis la fin de la guerre froide, la Russie ne cesse d'entretenir des conflits, par exemple par son attitude sur la gestion des ressources et son refus des énergies renouvelables. La Russie est en effet la première productrice et consommatrice de gaz naturel. En outre, comme le montre Anastasia Kirilenko dans son film Poutine et la mafia, ce dernier est assez controversé car il est accusé de trafic d'armes et de drogues.
Il est donc difficile de créer une paix stable et durable avec la Russie. D’un point de vue politique, ses valeurs ne sont pas les nôtres et ces différences mènent à de nombreuses complications avec l'Union européenne. La population est contrôlée par une propagande de masse qui pousse ses habitants à ne pas croire ce que l’Europe peut leur proposer, sans oublier les opposants sévèrement réprimés.
Antoine MENISSEZ,
Erwann MESSAGER-SCARON.
Joe Biden, le sauveur de l'Amérique ?
À l'aube du « nouveau monde », les enjeux sont multiples au pays de la liberté.
Une politique intérieure tumultueuse. L'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis s'est faite difficilement : les incidents survenus au Capitole, le 6 janvier dernier, soulignent une fracture au sein de la population américaine, partagée entre les « trumpistes » et les « pro-Biden ». La réconciliation de ces deux Amériques représente donc le premier défi du 46e président des États-Unis. Concernant la crise sanitaire, Biden renforce les mesures avec l'imposition du port du masque dans les espaces fédéraux, en janvier 2021, et l'incitation ou l'obligation pour certaines professions à la vaccination. D'autre part, Biden prend très au sérieux la question migratoire en faisant passer le quota de 15 000 à 125 000 réfugiés accueillis et en affirmant vouloir assouplir les conditions d'entrée des émigrés. Enfin, alors que Trump qualifiait l'urgence climatique de « complot chinois », Biden en fait l'une de ses priorités : la baisse des émissions de gaz à effets de serre et la COP26 seront cruciales. Malgré la sortie de la crise sanitaire qui paraît encore lointaine, la relance économique s'opère déjà. Le dynamisme démographique, l'innovation et la bonne santé économique sont autant de facteurs qui laissent à penser que le pays rebondira si son président prend les bonnes mesures.
Une politique extérieure en demi-teinte. À l'extérieur, « l'équipe sage » a beaucoup de problèmes à résoudre. Du côté diplomatique, la montée en puissance chinoise qui pourrait prendre la place de première puissance mondiale et la possibilité d'une guerre froide 2.0 inquiètent. De plus, le rappel de l'ambassadeur français, pour la première fois depuis plus de 200 ans, à la suite de la crise des sous-marins démontre une réelle fracture entre les États-Unis et ses alliés. D'un point de vue militaire, le retrait des troupes américaines en Afghanistan ne s'est pas passé comme prévu en raison de la prise de pouvoir des Talibans. Enfin, concernant le nucléaire iranien, l'enjeu est de taille puisque l'Amérique n'a pas intérêt à laisser l'Iran s'approprier l'arme atomique. La possibilité de rallier l'ennemi juré, la Chine, est même une option envisagée. Le président démocrate devra faire preuve de multilatéralisme, si cette fois, il veut remettre l'église au milieu du village.
Emilie JOILLE,
Raphaël BARBIEUX.
Condamnée à mort, libérée après cinq ans
Le témoignage d'Antoinette Chahine, militante libanaise contre la peine capitale.
Antoinette Chahine, une femme accusée d'avoir participé à un attentat au Liban dans les années 1990, a été condamnée à mort à seulement 22 ans. Elle a finalement été libérée le 24 juin 1999, après cinq années de torture et d'emprisonnement.
Antoinette Chahine a su capter son auditoire lors de la conférence sur la peine de mort à Caen, où elle s'est présentée comme une militante contre la peine de mort, en racontant son parcours au Forum mondial Normandie pour la Paix.
« C'est avec une grande émotion que je vais témoigner pour vous [...]. Je viens d'un pays malade, blessé, le Liban, la Suisse du Moyen-Orient [...], un pays tellement meurtri par l'explosion qui s'est produite dans la capitale, Beyrouth, le 4 août 2020. Aujourd'hui, des maisons restent brisées, il y a des centaines de martyrs que je pourrais appeler des "martyrs de la négligence" [...] Nous allons nous en sortir, j'en suis sûre, grâce aux pays qui sont autour de nous, comme la France. Pour moi, rien ne pourra arrêter la lutte contre la peine de mort, la torture, l'injustice [...] J'ai vécu tout cela alors que j'étais très jeune. Oui j'ai tout vécu, l'injustice, la présomption d'innocence et en même temps condamnée à mort, accusée de complicité de meurtre, torturée et puis obligée d'attendre cinq ans et demi dans l'obscurité d'une cellule trop étroite avant que justice soit faite. Voilà le pourquoi, et surtout le comment de mon histoire. »
Une histoire
dans l'Histoire du Liban
« J'ai été arrêtée la première fois à la fête des mères au Liban le 21 mars en 1994. J'étais jeune étudiante [...] J'ai été arrêtée simplement parce que mon frère Jean était membre des Forces libanaises et ce parti politique chrétien était persécuté à cette époque. Il avait quitté le Liban comme beaucoup d'autres depuis les années 1990 [...]. Ils m'ont peut-être choisie parce que j'étais très jeune. Ils prévoyaient que j'accepterais tout ce qu'ils voulaient, comme de signer une déclaration selon laquelle mon frère Jean était au Liban au moment de l'attentat de février 1994. »
Antoinette Chahine continue ainsi son histoire, en nous parlant des terribles conditions dans lesquelles elle a vécu. « J'ai été transférée dans une prison pour femmes [...], accusée du meurtre d'un prêtre. Pendant 23 jours, j'ai été dans une cellule seule et je devais garder mes pieds en l'air car la cellule était trop petite pour que je m'y tienne allongée. Jamais je n'oublierai lorsque j'ai été opérée du pied, dangereusement [...], car l'opération a eu lieu sans anesthésie. » Elle a également su émouvoir son auditoire en donnant son ressenti en tant que mère aujourd'hui : « Je ne pouvais recevoir de visites de ma famille, que j'ai vue pour la première fois après un mois et demi [...]. J'ai rêvé pendant cinq ans et demi d'embrasser ma mère, sans pouvoir la toucher, et comme maintenant je suis mère je comprends très bien ce qu'elle a vécu. »
Chloé PIGNE, Jade BARBE.
Les dix ans du printemps arabe
Malgré un premier bilan décevant, la réplique de 2019 ouvre de nouveaux horizons.
L'expression « Printemps arabe » désigne les soulèvements démocratiques qui ont eu lieu dans la majeure partie des pays arabes au cours de l'année 2011. Cependant, Ghazi Gherairi, ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, nuance cette expression médiatique : « La notion même de printemps arabe est à questionner car il ne s'agit pas que d'une vague saisonnière, mais bien d'une crise structurelle de longue durée, ralentie par le coronavirus, mais toujours actuelle. »
Jean Pierre Filiu, professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, rappelle brièvement la chronologie des différents soulèvements populaires dans cette région du monde. « La première vague du printemps arabe commence dès les années 1980 au Soudan et se termine en Algérie. En 2011, les médias, et particulièrement la télévision, mettent en lumière ce qu'il se passe en Tunisie et dans les pays voisins, et la renaissance de la mémoire pré-dictatoriale et post-coloniale. En 2019, a lieu une troisième vague au Soudan, en Irak, en Libye. Il s'agit d'une crise structurelle avec des régimes irréformables. Cependant, la pandémie a été une bénédiction pour les dictateurs arabes. »
L'installation durable
des démocraties
Pour l'instauration d'un régime stable et démocratique, l'ambassadeur tunisien réunit plusieurs conditions : « D'une part, le soutien international économique est nécessaire pour relancer l'économie des pays concernés. En effet, un bien-être socio-économique est requis pour l'installation de la démocratie, sans quoi on assistera à une montée des extrêmes. Enfin, il faut croire en l'égalité des êtres humains et être cohérent avec nos valeurs démocratiques ».
Ziad Abdel Samad, directeur exécutif du Réseau des ONG arabes pour le développement depuis Beyrouth, réclame, lui, des sanctions ciblées sur les dirigeants mis en cause, et non pas des embargos qui ne feraient que plomber l'économie du pays et prolonger les éventuelles crises qui traversent le Moyen-Orient.
« Il faut privilégier les décisions politiques aux interventions militaires », déclare le Libanais.
Les aspirations déçues
du printemps arabe
Les révoltes de 2011 n'ont pas abouti à la naissance de régimes démocratiques, menacés par le poids croissant des mouvements islamistes radicaux. La Tunisie, pourtant souvent citée à titre d'exemple pour l'adoption de sa nouvelle Constitution en 2014, a aujourd'hui un bilan contrasté depuis l'accaparement du pouvoir le 25 juillet 2021 par son dirigeant Kaïs Saïed, à l'image des autres régimes qui avaient été secoués par le cri de la rue.
Nathan BISSON,
Camille LEBEGUE,
Titouan CLIVILLE.
Les beaux portraits de Sylvia Galmot
28 photographies de femmes engagées qui font entendre leur voix.
Lors du Forum mondial Normandie pour la Paix, nous avons rencontré la photographe Sylvia Galmot. Son exposition, « Libres et Égales », se compose de 28 portraits féminins. L'artiste tente de mettre en place un soutien psychologique pour toutes les femmes victimes de violence ou sous l'emprise d'un conjoint. Elle souhaite modifier les standards d'exposition sur les femmes en dévoilant, non pas des femmes violentées, mais des icônes éminentes pouvant véhiculer un message d'espoir et de force.
Héroïnes de notre temps
L'artiste Sylvia Galmot, grande photographe de son temps, expose en pleine rue, pour rendre ses œuvres accessibles à toutes les femmes, quels que soient leurs moyens financiers ou leur contexte familial. Cette exposition est conçue comme un ensemble de 28 femmes, représentant les 28 jours du cycle féminin, à l'origine même de la force brute des femmes. Ces portraits montrent des héroïnes de notre temps, dont les activités professionnelles sont diverses telles des psychothérapeutes, des actrices, des humoristes, des avocates, des gynécologues et bien d'autres professions honorables. Ces œuvres sont accompagnées d'un message d'espoir créé par leurs modèles, afin de définir le but de leur engagement à l’attention de toutes ces femmes abandonnées par la vie.
Libérer la parole
Ces travaux audacieux réclament une attention particulière afin de promouvoir l'évolution de la condition féminine. Son intention majeure est à la fois de donner de l'espoir et de juger leurs bourreaux sur un plan psychologique, afin de leur faire prendre conscience de leurs méfaits. L'artiste entreprend cette thématique, pour faire taire les tabous et libérer une parole trop souvent ignorée ou blâmée par la société. L'ensemble de ses œuvres portent sur des sujets semblables. Elle affirme révéler la beauté de chacun de ses modèles. Ses nombreuses expositions sont par conséquent la marque même d'une beauté associée à la force féminine. Sylvia Galmot nous a fait part de son envie de réaliser une nouvelle exposition sur le thème des femmes accomplies.
A Marseille aussi
Son exposition, visible au Forum mondial Normandie pour la Paix, trouve également son alter ego à Marseille, avec une même démarche. Cet ouvrage semblable est également composé de 28 autres portraits féminins, pour montrer d'autres figures auxquelles s'identifier, pour montrer au monde et aux victimes un modèle auxquelles elles pourront se rapporter. Afin de se libérer d'une emprise qui trop souvent les gouverne.
Florentin AIMY,
Marina GEANCY.
À travers les murs, les conflits s’expriment
Des murs qui isolent et divisent, visibles grâce à une exposition de photographies.
Jusqu'au 30 novembre, dans le parc de l'Abbaye aux Dames à Caen, s'est tenue l'exposition "Murs : entre guerre et paix" en partenariat avec Paris Match. On dénombre aujourd'hui dans le monde de plus en plus de murs : entre 70 et 75 aujourd'hui contre une douzaine en 1979. Ils sont des preuves tangibles des conflits passés et présents.
Des murs qui séparent
Ces lisières conventionnelles peuvent être des lieux de tensions et de confrontations, où l’espoir de s'évader ou de s’y introduire se mêle à des questions morales, politiques et économiques. Paris Match propose une exposition symbolique et emblématique sur la question des murs qui peuvent fragmenter une société.
Adil et Martine, qu'une trentaine d'années sépare, apprécient l'exposition. « J’ai pu en apprendre plus sur les murs qu’il y a dans le monde, il y en a certains dont je ne connaissais pas l’existence » affirme Adil. « On peut voir différentes formes et sortes de murs qui ont pour autant le même objectif », souligne Martine.
C'est surtout pour des causes politiques que l'on construit des murs. C'est notamment visible par exemple à la frontière entre Israël et la Palestine : de grands murs de béton allant jusqu'à neuf de mètres de haut ont été érigés, suite à la deuxième Intifada pour protéger le pays contre des attentats. Le mur de Berlin, plus connu sous le nom du « Mur de la honte », fut construit pour empêcher les tentatives de fuite des habitants du bloc de l'Est vers le bloc de l'Ouest. Enfin la DMZ, zone démilitarisée située entre les deux Corées, a servi à mettre fin à la guerre qui les opposait.
À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un mur de 1181 km de long s'érige : il a pour vocation d'empêcher les flux migratoires et de trafic de drogue. La clôture de barbelés dressée entre la Grèce et la Macédoine, après la crise migratoire de 2015, sert à empêcher des milliers de migrants de rentrer dans l'espace Schengen. À la frontière syrienne, pour limiter les flux migratoires, c'est un mur de 764 km qui empêche les familles syriennes qui fuient leur pays, de se réfugier en Turquie.
Janys PORTEBOIS,
Hajar KHOMSI.
Peine de mort : l'abolir pour la paix
Partout, la lutte pour l'arrêt de la peine de mort est importante.
L'une des conférences du Forum mondial Normandie pour la Paix à Caen était consacrée à la question de l'abolition totale de la peine de mort au niveau mondial. Deux pays y étaient représentés par des victimes de condamnation à la peine de mort. Mohamed Cheikh Ould, ex-condamné à mort mauritanien, et Antoinette Chahine (lire p. 5), ex-condamnée à mort au Liban, sont venus témoigner de leur expérience. Tous deux militent pour l'abolition de la torture et de la peine de mort partout dans le monde. Si la peine capitale a été abolie par de nombreux États, elle est encore présente dans 88 pays dont certaines démocraties telles que les États-Unis.
D'après les intervenants, il ne faut surtout pas que le sang appelle le sang. En effet, chaque individu est en capacité de s'améliorer et de changer. La question du pardon est essentielle pour ceux qui sont contre la peine de mort. Il est cependant compliqué de faire entendre raison aux partisans de la peine de mort car elle est populaire et peu coûteuse. Mohamed Cheikh Ould, l'ex-condamné à mort mauritanien, a insisté durant son discours sur les souffrances de la vie de prisonnier. D'après lui : « La plus grande souffrance du prisonnier est sans aucun doute la solitude. » Ayant passé cinq ans et demi emprisonné, il compare la prison à de la torture. La lutte pour l'abolition de la peine de mort au niveau mondial doit continuer afin de mettre un terme à ce crime contre les droits humains.
Tom OFFER,
Esteban ABADIE.
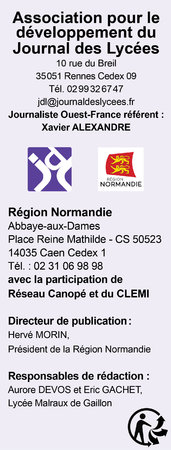
Lutter contre la faim, œuvrer pour la paix
Dans le monde, près d'un habitant sur trois souffre de la faim ou de malnutrition.
Le vendredi 1er octobre, au Forum mondial Normandie pour la Paix à Caen, Thomas Delage, de Diplomatie Magazine, a invité des intervenants pour parler de l'insécurité alimentaire et des manières de lutter contre ce fléau afin d’œuvrer pour la paix.
Céline Jurgensen, ambassadrice de France auprès de l'ONU, explique que l'insécurité alimentaire est liée essentiellement aux conflits ou aux catastrophes naturelles. Au Yémen, pays touché par la guerre depuis 2015, plus de la moitié de la population souffre de la famine. En outre, iI est probable que la pandémie du COVID-19 provoque une crise alimentaire.
Augmenter les salaires
des producteurs
Les agriculteurs sont les principaux concernés par le manque de nourriture. Pour faire face à ce fléau, des associations luttent. Leur objectif est de nourrir le monde de manière durable. L'AFDI (Agriculteur français et développement international), par exemple, est une association qui se bat afin d'augmenter les salaires des producteurs.
Éric Pichon, du Service de recherche du Parlement européen, a également évoqué la problématique suivante : peut-on rêver de souveraineté sans sécurité alimentaire ? Les plus grandes puissances mondiales, comme la Russie ou encore la Chine, misent énormément sur l'agriculture, ce qui leur permet aussi de développer leur économie. L'Union européenne apporte une aide logistique à l'agriculture mondiale, mais dépend également du reste du monde pour son alimentation.
Les ressources de la mer
Un autre organisme, très reconnu, le Programme alimentaire mondial de l'ONU, lutte contre la faim et aide à l'importation de denrées alimentaires, difficiles à acquérir pour certains pays. Il aide également les agriculteurs à devenir autosuffisants en leur fournissant des machines.
D'autre part, la bluefood, nourriture venant de la mer, est une autre ressource intéressante. Le Vietnam mise énormément sur l’aquaculture et la pêche. D'après les prévisions, leur production risque de doubler d'ici à 2050. Malgré la rentabilité de ces activités, il faut s'assurer que cette économie soit durable et ne soit pas totalement dépendante.
La nourriture est un élément indispensable pour l'humanité, la paix dépend de l'accès à la nourriture pour tous. Cela nous permet d'intégrer le fait qu'il est indispensable de s'occuper de cette question et de s'interroger sans cesse sur les moyens d’œuvrer pour une paix durable dans le monde.
Léo ISSARTELLE
Noé POULAIN.