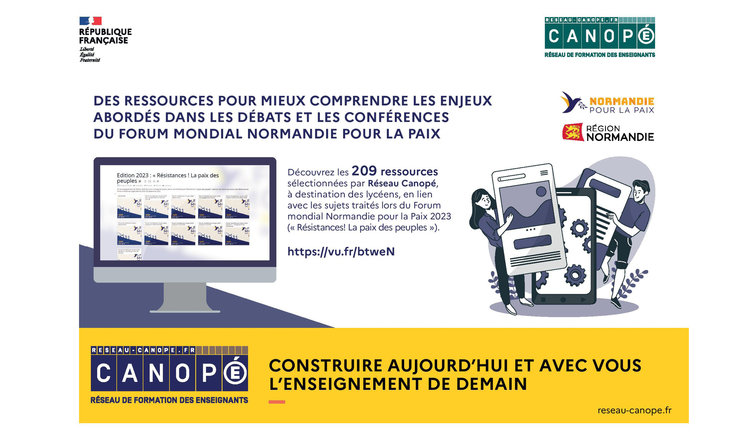Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Pas de paix sans les peuples !
Le 6e Forum mondial Normandie pour la Paix s'est tenu à Caen les 28 et 29 septembre. Alors que les conflits se multiplient partout dans le monde, plus que jamais, les populations sont le coeur des résistances. « Aucune paix durable ne peut se construire sans les peuples » a rappelé Nicole Gnesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors.
Éditorial
La sixième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix s’est tenue les 28 et 29 septembre derniers à l’Abbaye aux Dames à Caen autour du thème « Résistances ! La paix des peuples », mettant l’accent sur la mobilisation des peuples à travers le monde face à des situations d’injustice ou d’oppression. Plusieurs milliers de participants, parmi lesquels de nombreux lycéens, se sont donnés rendez-vous pendant ces deux jours riches d’échanges et de débats.
Acteurs de la paix de demain, les jeunes tiennent une place importante dans la programmation du Forum. Chaque année, la Région Normandie, en partenariat avec les autorités académiques, déploie de nombreux programmes pédagogiques et temps forts à destination des lycéens normands. Au cours du Forum, plusieurs débats leur ont ainsi été dédiés afin qu’ils puissent aborder les thématiques au cœur de cette édition.
En feuilletant les articles rédigés par les élèves du lycée Le Verrier de Saint-Lô, vous retrouverez la parole de nombreux experts et témoins venus s’exprimer lors du Forum : situation à Taïwan, en Irak ou encore en Turquie, guerre en Ukraine sont autant de sujets d'actualité qui ont été traités cette année.
Le projet La Colombe constitue, dans le cadre de l’initiative Normandie pour la Paix, un formidable marqueur d’engagement de la jeunesse normande en faveur de la liberté et de la paix. Je tiens à cet égard, à remercier vivement et à féliciter ces lycéens et leurs encadrants pour le travail qu’ils ont fourni dans la rédaction de ce nouveau numéro.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie
Résister : contre qui et pour quoi ?
Des professionnels débattent sur trois sujets.
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, Kléber Arhoul, directeur du Mémorial de Caen, et Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction The Conversation France, débattaient en présence de la réalisatrice Eve Minault, après la projection de trois épisodes de la websérie, créée à partir d'archives de l'INA Résister, contre qui et pour quoi ? Comme l'a rappelé Eve Minault, « [...] L'Histoire est aussi racontée par les images ».
Le premier épisode traitait de la résistance des peuples. On pouvait y voir, par exemple, des images tournées en Ukraine, montrant la population résistant contre l’offensive russe ou encore des images de la résistance française dans les années quarante.
Le deuxième épisode portait sur l’émancipation des femmes, en prenant comme exemple les femmes qui n’ont plus accès à l’avortement dans plusieurs états américains, les femmes qui militent contre le port du voile obligatoire en Iran ou encore le mouvement #metoo. Pour Kléber Arhoul, le mouvement « #MeToo c’est une parole qui se libère et toutes les paroles se libèrent ». Donc, chacun a un besoin important de s’exprimer et #MeToo est une façon, pour beaucoup de femmes, de s’exprimer.
Et le dernier épisode portait sur les dangers climatiques. On y apprenait que les changements climatiques provoquent plus de décès que les actes de terrorisme : cinquante-mille morts sont causés par le terrorisme pour huit millions de morts en raison du climat. « Je crois aujourd’hui qu’il y a une prise de conscience que la Terre peut mourir » déclare Kléber Arhoul.
Le public pouvait poser des questions et ces 4 personnes tentaient d’y répondre le mieux possible. Si les débats étaient souvent mouvementés, leurs avis finissaient souvent par pencher dans le même sens.
La résistance est une notion universelle, car, comme l’a dit Bertrand Badie durant le débat, « [Il existe], au fond de chacune et de chacun d’entre nous une absolue liberté. Le résistant, [quelle que soit la guerre], fait l’Histoire. » Le but de cette websérie est de montrer différentes formes de résistance et différentes raisons qui peuvent pousser les individus à résister.
Lexane FOULON, Eva LEROY,
Victoria LECLERE--LECONTE
L'ONU : acteur de la paix
Depuis leur création en 1948, les Casques bleus ont été missionnés par l'ONU à travers l'ensemble du globe. Ils sont encore présents aujourd'hui sur 12 opérations.
Véritables agents de la paix, le mandat multidimensionnel des Casques bleus cherche à protéger les populations en tout lieu en ayant pour but d'instaurer des accords de paix et de les faire respecter. À la fois militaires, policiers et civils, ils sont forts de leur polyvalence. Désormais, ils doivent faire face à de nouveaux défis tels que le terrorisme, les nouvelles armes, les trafics d'humains et de drogue, ainsi que la préservation de l'environnement. En répondant aux attentes et en instaurant un dialogue continu avec les civils, les Casques bleus peuvent espérer gagner leur confiance et les protéger, avant de clore leur mission lorsque les populations sont capables de garantir elles-mêmes leur sécurité et maintenir ainsi une paix durable.
Les Casques bleus jouent un rôle essentiel pour la paix : la prévention. Ils doivent détecter les signaux afin d'empêcher les conflits sous-jacents. C'est en enfermant les fauteurs de troubles en prison, en construisant des institutions, en établissant des votes inclusifs, en favorisant les droits de l'Homme, la justice et la liberté ainsi qu'en rapprochant les communautés, tout cela avec l'accord du peuple et des diplomates, qu'ils construisent la paix. Tout cela montre la complexité de l'élaboration des accords de paix et surtout de la mise en place des démocraties sur les ruines des guerres.
C'est pourquoi l'ONU assume également ses échecs. Des accords sont parfois mal négociés et peuvent être non-inclusifs, notamment envers les femmes et les minorités. De plus, il est parfois complexe de choisir la paix plutôt que la haine, quand la vengeance semble être la seule solution pour apaiser la conscience des peuples. Ces défis et ces devoirs ont des répercussions qui obligent l'ONU à instaurer une paix robuste, c'est-à-dire, le droit de recourir à la force. En effet, en Occident tout comme sur le terrain, l'efficacité de l'ONU est remise en cause.
Aujourd'hui, être Casque bleu n'est plus une protection pour les soldats qui subissent des attaques durant leurs missions et dont les infrastructures sont endommagées. À cause de la désinformation et des fake news, ces attaques sont de plus en plus fréquentes. Ainsi que l'a rappelé Nicole GNESOTTO (historienne, experte des questions européennes et internationales), en citant Raymond Aron : « Le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. ».
Zoé JOSEPH, Léonie PARIS
L’Irak, un pays divisé
Depuis la guerre en 2003, l'Irak est un pays disloqué entre la minorité Kurde au nord, les musulmans sunnites au centre et les musulmans chiites au sud. C'est l’intervention des États-Unis, fondée sur des mensonges, qui a entraîné la chute de Saddam Hussein. Le pays, qui possédait des universités très réputées dans le monde, a aujourd'hui plus de 80 % de sa population qui ne sait ni lire ni écrire.
C'est dans un témoignage chargé d'émotion que le docteur Nagham Hawzat HASAN, gynécologue irakienne, a évoqué le sort des femmes et des jeunes filles Yézidies qu'elle accueille dans un centre qui leur est dédié. Réduites en esclaves sexuelles par les hommes de DAECH, certaines d'entre elles n'étaient alors que des enfants. Victimes de trafic, de torture et d'innombrables viols, ces femmes sont des survivantes qui, auprès de cette gynécologue devenue leur confidente, se reconstruisent. "Je n'oublierai jamais" confie Nagham Hawzat HASAN.
Emeline NOQUET,
Adèle LECLUZE
Turquie : l'exil, une action contre le régime
La politique d'Erdogan, au pouvoir depuis 2001, divise le pays et pousse une partie de la population à l'exil.
Ahmet Insel, éditeur et politologue, a évoqué au cours du débat "Agir depuis l'exil", le sort des populations opposées à la politique d'Erdogan. Certains n'hésitent pas à choisir la voie de l’exil comme forme de protestation.
L’une des causes : la propagande religieuse qui sévit dans les établissements scolaires. Les élèves sont soumis à des cours de religion devenus obligatoires. Elle provoque chez les parents des désaccords, en majorité chez les femmes, qui décident de quitter le pays avec leurs enfants pour les scolariser dans des établissements laïcs.
Outre les femmes, les médecins désignés comme des opposants fuient le pays. Le nombre de médecins turcs voulant exercer à l’étranger est estimé à environ 1400 en 2023.
Des minorités privées de leurs droits
De plus, les minorités font face à de sévères répressions, notamment la communauté LGBT, qui cette année encore s'est vue interdire une marche des fiertés, mais aussi la minorité chrétienne qui n’a pas accès aux emplois publics et subit des discriminations. Les personnes issues de la communauté Kurde sont même considérées comme des terroristes. Une majorité d’entre elles se sont exilées pour fuir la répression.
Certaines de ces minorités, restées sur place, en viennent à provoquer de violentes altercations et même des actes de terrorisme - comme on a pu le voir récemment - pour faire entendre leur voix.
Angélie HENAUT,
Manech LEFORESTIER-POULAIN
Sur les ruines de l'URSS, un conflit stratégique qui dure
Entre la Russie et la Turquie, l'avenir incertain de l'Arménie.
Le Haut-Karabagh, enclavé, est au cœur de tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ce couloir entre 2 mers subit de hautes conflictualités. Tandis que le Haut-Karabagh mène sa quête vers l’indépendance, l’Azerbaïdjan s’arme continuellement auprès de ses alliés. Sa politique soutient un discours nationaliste voire raciste.
En 2020, il passe à l’offensive en prenant les 7 districts dans le but d’encercler le Haut-Karabagh et sa population arménienne. Après 44 jours de guerre, une forte pression est instaurée sur ses habitants, privés de médicaments et de vivres. Le corridor de Latchine, correspondant à la ligne de vie entre les deux populations arméniennes est pris de force. Les Azéris ont ainsi commis une violation de l’intégrité territoriale. Le blocus continue, empêchant toute aide humanitaire d’agir. L’attaque fulgurante du 19 septembre 2023 aboutit à la capitulation arménienne seulement 24 heures plus tard. Cette population majoritaire du Haut-Karabagh ne peut défendre son territoire à cause du manque de moyens financiers et son affaiblissement provoqué par la famine, le manque important de soins et la censure de l’information subis depuis 10 mois. Ces habitants sont donc contraints à l’exode dans des conditions épouvantables, qu'on peut qualifier d’épuration ethnique.
Le Caucase, carrefour entre l’Europe, la Turquie, la Russie et le Moyen-Orient est au cœur d’un enjeu complexe. Aucune action n’est actuellement menée en faveur des arméniens du Haut-Karabagh : l’Occident et les États-Unis continuant de préserver selon Gaïdz Minasian (politologue et enseignant chercheur) leur modèle de « paix impériale ». Par manque de traité de paix, la situation demeure hostile pour les Arméniens. L'Azerbaïdjan possède de nombreuses ressources en hydrocarbures vendues sur les marchés européens, à l'inverse de l'Arménie qui ne dispose d'aucun moyen de pression. Ainsi l'Occident ne prend pas parti dans ce conflit, l'Arménie se retrouve sans alliés. A contrario, une alliance se développe entre la Turquie et l'Azerbaïdjan souhaitant instaurer un hub gazier passant par le corridor de Zangezur.
L'héritage post-soviétique marque aussi depuis des décennies ce conflit, l’armée azerbaïdjanaise a profité de la guerre en Ukraine pour lancer son offensive. Les acteurs mobilisés, les alliances floues, l’émergence de nouvelles puissances, et la volonté de « désoccidentaliser » sont un point commun entre les deux conflits. Ici et là le passé refait surface.
Coralie DANIEL
Une figure pour la liberté des hong-kongais
Un militant explique son déroutant parcours à travers une conférence où les lycéens sont invités à lui poser des questions suite au visionnage du film Blue Island.
Nathan Law, jeune activiste hong-kongais, était présent à la projection du film Blue Island. Après la dissolution de son parti pro-démocrate et son emprisonnement pour manifestation, il s‘exile à Londres pour poursuivre la lutte car « ce n'est pas une fuite, mais un combat extérieur ». Le militant a coupé volontairement les liens avec sa famille pour leur éviter tout danger. Il reste à ce jour le principal porte-voix des étudiants et citoyens de Hong Kong. Malgré son départ, il désire conserver son identité culturelle et ses valeurs, tout en continuant son combat au niveau international. Son passé est identique aux personnages du film et il exprime sa forte émotion. Il décrit une Chine actuelle isolée et déclinante qui a beaucoup de problèmes économiques, démographiques et industriels. Mais les grèves sont impossibles car les travailleurs n’ont pas de protection financière.
La seule issue : l'indépendance
Nathan espère une liberté pour les générations futures sans pour autant oublier les traumatismes du passé. Outre ses actions et son grand rôle dans le mouvement des Parapluies, il écrit en 2021 « Freedom, how we lose it and how we fight back » (La liberté, comment on la perd et comment on riposte), où il raconte son exil précaire et l'autoritarisme dominant la liberté d'expression. Il exprime une vision sans tabou de la Chine et de l'objectif du gouvernement de s'emparer de Hong-Kong. Un an avant la rédaction de son ouvrage, il est classé parmi les 100 personnes les plus influentes par le Time Magazine.
Le peuple n'oubliera pas
Nathan Law encourage les jeunes de toutes les nationalités à se battre pour leur liberté et indépendance, tout en conservant l'importance de ne pas fermer les yeux sur les injustices du monde. Il incite à l'enseignement des actes et violences du passé aux nouvelles générations pour ne pas reproduire les erreurs. Ainsi, il espère construire un futur meilleur.
Céliane GUERIN,
Aïdie LEMOINE, Inès ATBIB
Un climat de tensions permanent à Taïwan
Dans le cadre des prochaines élections présidentielles, l’île de Taïwan fait face à des menaces de la part de son voisin chinois.
Indépendante depuis près de 75 ans, Taïwan n’est pas reconnue par la Chine, qui la revendique comme un territoire qui lui appartiendrait de droit. Après avoir annoncé son intention de « réunification » avec Taïwan en 2019, Xi Jinping semble prêt à mettre ses menaces à exécution à tout moment. Il a également fixé une date limite, et a assuré s’occuper du dossier. C'est une première depuis l’indépendance de l’île, tous ses prédécesseurs l’ayant volontairement reléguée à leur successeur. L’enjeu est de taille : en plus d’un « devoir sacré » comme le soutiennent ses partisans, c’est aussi une occasion de repousser les États-Unis, et de retrouver le contrôle de la mer de Chine, et des terres de l’ancien empire Mandchou. Pas d’attaque de la Chine, mais pas de reconnaissance de Taïwan comme nation indépendante : voila les termes du fragile contrat qui garantit une paix provisoire entre les deux territoires.
La situation problématique du statu quo
Les Taïwanais se contentent du statu quo pour l’instant. Ils comptent sur l’interdépendance économique qui résulte de l’utilisation par la Chine du plus grand port de la côte taïwanaise, l’un des principaux ports marchands du monde, et du quasi monopole des entreprises taïwanaises sur les semi-conducteurs. Cela permet aussi à l’île de se faire de puissants alliés même en Europe, où cette technologie est utilisée dans pratiquement tous les objets électroniques. Ces alliés sont précieux face aux menaces de la Chine ces dernières années. Entre les intrusions dans l’espace aérien et les perturbations pendant la visite d’un centre militaire de la présidente taïwanaise, Pékin investit également dans des médias et des entreprises, afin de resserrer son étau autour de la population.
Une guerre impossible ?
Xi Jinping n’a toujours pas ordonné d’engager ce qui semble n’être qu’une petite opération militaire. Son problème serait de ne pas assumer militairement une opération contre les États-Unis, surtout si les pays frontaliers comme le Japon, la Corée du Sud ou les Philippines s’en mêlent. Un arrêt de l’économie engendré par la guerre pourrait aussi lui poser problème. Bien qu’il ait annoncé s’en occuper, Xi Jinping « ne s’engagera pas sur une guerre dans laquelle il n’est pas sûr de gagner », assure Stéphane Carcuff, sinologue spécialiste de Taïwan. Le 15 novembre, Xi et Biden se sont rencontrés pour tenter d'apaiser les tensions.
Manech LEFORESTIER-POULAIN
Abolir ou maintenir l'arme nucléaire ?
Le sujet fait toujours débat pour une réponse plus complexe qu'il y paraît.
La planète compte officiellement actuellement neuf puissances nucléaires : la France, la Russie, le Royaume Uni, les États-Unis et la Chine, mais aussi le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du Nord. La menace de prolifération est cependant grandissante avec l’Arabie saoudite et l’Iran qui intensifient leurs recherches et enrichissent l'uranium.
L'abolition de l’arme nucléaire semble une nécessité car vivre tout en acceptant d’être menacé et en menaçant en permanence l'autre n’est pas viable. Les armes nucléaires représentent un risque inouï pour l’humanité toute entière et les enjeux sont vitaux. Le discours belliciste de certains États tirerait ainsi un trait sur le traité de non prolifération qui visait à limiter le nombre d’armes nucléaires dans le monde. Accepter la dissuasion nucléaire, c’est donc autoriser des essais nucléaires et par conséquent, des dangers en masse.
Faut-il alors se tourner vers un désarmement progressif afin de ne pas subir des guerres en masse et l'invention d'une arme encore plus puissante ? ou bien faire le choix d'une prolifération qui tire un trait sur le traité mis en place ? Cette interrogation se pose avec acuité alors que notre monde subit de nombreuses menaces quotidiennement, comme actuellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec une pression importante et une menace nucléaire plus que présente...
Certains prétendent qu'il faut garder l’arme nucléaire, tout en désarmant progressivement. Cependant, d’après Héloise Fayet, abolir cette arme reviendrait à inciter les pays à créer un autre type tout aussi - voire plus - destructeur. Elle explique « Si nous avons réussi à inventer l’arme nucléaire nous pouvons inventer bien pire encore ». C'est en ayant l'avantage de la dissuasion nucléaire et en maîtrisant son fonctionnement qu'il devient possible d'ouvrir des discussions. Depuis le traumatisme d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945, aucun conflit entre puissance nucléaire ne s’est produit mais, « personne ne sait ce qu’a Poutine dans la tête, le risque 0 n’existe pas » nous dit Nicole Gnesotto. L'objectif final serait donc d'espérer un désarmement progressif en diminuant le nombre de têtes nucléaires et en arrêtant la production de plutonium afin de stabiliser le nombre d’engins nucléaires.
Svanilde DROMAIN
Autochtones : résister face à l'exclusion
Les peuples autochtones participent activement à la protection de la biodiversité mais sont les grands oubliés d’une société consumériste qui épuise les ressources.
Les peuples autochtones qui représentent 6 % de la population mondiale, sont intimement liés à la terre qu’ils considèrent comme « leur pharmacie » et « leur épicerie » car elle fait partie de leur identité. Ils gardent à l’esprit, ainsi que le dit Brijlal Chaudhari, du peuple des Tharus : « la Terre ne nous appartient pas, c’est nous qui lui appartenons ». Leurs savoirs sur la nature sont exemplaires, c’est pourquoi les États devraient prendre en compte ces peuples et leur mode de vie comme l’a fait l’Équateur refusant de puiser du pétrole sur leurs terres. Leurs connaissances servent désormais les scientifiques qui collaborent avec les Samis de Finlande et les Inuits du Canada. Ailleurs, des autochtones travaillent à la préservation des rivières ou des montagnes.
Si leur voix n’est que faiblement entendue dans la sphère internationale, elle est pourtant d’une importance primordiale. Cela fait 30 ans que les autochtones sont conviés aux discussions de l’ONU sans vraiment y participer malgré leur volonté d’être entendus. Sara Olsvig, présidente à la fois du comité arctique qui regroupe 8 associations d’autochtones et du conseil du cercle polaire inuit, témoigne de la chance de pouvoir représenter les Inuits (180000 personnes), une population occupant un vaste territoire qui s’étend de la Russie au Canada en passant par le Groenland dans cette « lutte de toute une vie » à l’ONU. Les inuits revendiquent la justice climatique pour ne plus subir le dérèglement mondial qui les pousse à l’insécurité alimentaire. Les Nations Unies accordent aux peuples autochtones un fonds de compensation cependant inégal entre les différents Natifs du monde. Aujourd’hui, les Nations Unies se demandent s’il faut insérer la notion d’écocide dans la déclaration des droits des peuples autochtones.
Les traditions, langues et modes de vie des peuples autochtones sont menacés par l’assimilation d’une nouvelle culture. Cela mène à une extinction progressive de la leur et des territoires. Les jeunes natifs veulent cependant protéger leur identité en s’engageant au côté de la communauté internationale, qui ferme encore les yeux sur cette menace.
Doline DUVAL
Guerre informationnelle, le rôle des réseaux en Ukraine
Depuis le début du conflit en Ukraine, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. L’information est devenue une arme.
« Dès les premières heures de la guerre, les médias traditionnels, malgré leur rapidité, ont mis une demi-journée avant de renseigner la population. Les réseaux sociaux ont donc pris le relais pour informer les 43 millions d’Ukrainiens » explique Oxana Melnychuk, spécialiste ukrainienne de la communication stratégique.
Le gouvernement a instauré une censure militaire pour protéger la population des fausses informations venues de Russie, et afin d’éviter une transmission involontaire de renseignements stratégiques. Les seules nouvelles sont apportées par des « speakers », uniques journalistes présents directement sur le front.
Pour une meilleure communication des informations, le président Zelensky a créé un canal Telegram dans lequel il partage les nouvelles vérifiées par l’État. Il y publie également des selfies vidéos journaliers qui affichent une proximité avec sa nation.
Aujourd’hui, l'information est une véritable arme capable de déclencher ou mener une guerre. Afin de déstabiliser des pays comme la France, la Russie effectue ainsi des formations massives pour créer des « professionnels des fake-news ».
Lilou LETOURNEUR,
Amandine BESSIN,
Maëva FESTOU, Assia DARIK
Comment bien s’informer ?
Il existe aujourd’hui de nouveaux moyens de s’informer avec des réseaux sociaux tels que YouTube, X, TikTok et Instagram. Mais il faut savoir distinguer entre vraies et fausses informations.
Sur YouTube, Il est possible de trouver différents formats de vidéos (documentaires, interview...). Ils permettent d’approfondir des connaissances sur des sujets, d’actualité ou non. Hugo Décrypte, un influenceur, poste quotidiennement des formats courts sur TikTok et Instagram résumant les informations essentielles.
« Mister geopolitix », un youtubeur, s’est spécialisé dans ce même domaine. Il publie du contenu analysant la géopolitique dans le but d’informer sa communauté. Il explique que la vigilance sur les réseaux sociaux est nécessaire face aux informations erronées. Ainsi, des photos peuvent être sorties de leur contexte et des vidéos utilisées uniquement dans le but de générer de l’argent. Ces fausses images sont aussi fréquemment diffusées afin de manipuler le public sur un plan politique. Plusieurs gestes peuvent être utiles pour éviter les « fake-news ». Le youtubeur conseille de regarder les commentaires sous une publication, vérifier les sources des informations ou encore suivre des comptes de débunkage (qui analysent, critiquent et vérifient des propos ou informations...).
Afin d’aider les utilisateurs, certaines plateformes ont mis en place des dispositifs pour simplifier la vérification des informations. X (ex Twitter) a par exemple instauré un nouvel outil de « fact-checking » (Birdwatch) pour lutter contre la désinformation.
La meilleure posture reste celle expliquée par Feurat Alani (journaliste franco-irakien) : « La bonne information est celle qui répond aux trois questions : est-elle utile ? me satisfait-elle ? est elle fiable ? ».
Lilou LETOURNEUR, Maëva FESTOU, Amandine BESSIN, Assia DARIK
La Croix-Rouge : humanité, volontariat, impartialité
La Croix-Rouge et son équivalent oriental, le Croissant-Rouge, sont des associations internationales avec des antennes spécifiques dans chaque pays. Il existe ainsi la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge ukrainienne, le Croissant-Rouge marocain et beaucoup d’autres. Ces associations s’occupent des civils, de leurs droits en temps de guerre, des blessés, des réfugiés lors de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Elles tentent de restreindre les moyens et méthodes de guerre. « Plus de 100 millions de bénévoles portent l’emblème de la Croix-Rouge », a expliqué François, l’un des trois bénévoles présents au Forum.
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est présent au coeur des conflits armés. Il a un devoir essentiel d’impartialité. Il doit s’occuper de tout le monde : qu’importe la nationalité de chaque individu, qu’importe qui a déclenché la guerre, qu’importe le statut social. Le Devoir International Humanitaire (DIH) agit notamment pour rétablir les liens entre les soldats, les prisonniers, les blessés et leurs familles. Le CICR et le DIH sont tous les deux présents en Ukraine depuis le début du conflit. Dans les pays musulmans comme le Maroc et l’Irak, c’est le Croissant-Rouge qui intervient.
Des missions qui évoluent
Certains bénévoles sont dirigés vers les pays en guerre pour tenter de retrouver les membres des familles éclatées, renouer les liens des blessés ou des prisonniers avec ces derniers... Tout cela existe dans le but de leur donner de la force, ou l’espoir de les revoir une dernière fois. Cindy, bénévole présente au Forum, fournit des explications sur l'une de ses dernières missions : La Croix-Rouge Française a ainsi envoyé des bénévoles en Russie afin de rencontrer les prisonniers ukrainiens pour tenter de retrouver des membres de familles ukrainiennes vivant désormais en France.
Lexane FOULON, Eva LEROY,
Victoria LECLERE--LECONTE
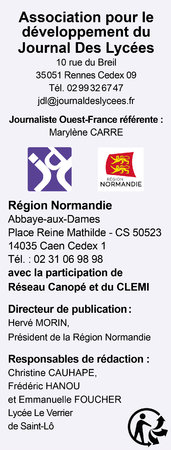
En Ukraine, l'art est aussi un moyen de résistance
Deux artistes ukrainiennes utilisent leur art au service de la paix et de la liberté.
La guerre est brutale, violente et sanglante. En Ukraine, face à l'insuffisance des mots contre les Russes, l'art est devenu un moyen privilégié d'expression. Les artistes jouent un rôle essentiel au cœur des conflits. Ils sont porteurs de messages de paix ou au contraire acteurs engagés au service d’un État ou d’une armée. Ils peuvent faire réfléchir, divertir, exprimer leurs idées ou relater des faits. Ils prennent ainsi le relais pour faire entendre ce qui est indicible.
Iryna Tsilyk, écrivaine, est la réalisatrice du film « The Earth is blue as an orange ». Ce long-métrage trace le quotidien d’une famille ukrainienne durant le conflit Russo-Ukrainien. Elle dénonce la violence russe et l’angoisse de la population locale. Le problème des artistes qui dénoncent est qu’ils mettent leur vie en péril. Les Ukrainiens disent ainsi être « en train de perdre leurs plus grands talents et cerveaux ».
Lesia Khomenko est une peintre qui utilise ses œuvres comme un instrument de guerre à la fois offensif et défensif. Elle s’oppose aux crimes et aux barbaries de Vladimir Poutine envers son pays. Ses toiles font garder en mémoire la gravité des choses et permettent de ne pas oublier ces actes inhumains. Mais elle est en exil afin de se protéger des autorités russes. Loin de son pays, elle perçoit et ressent les choses d’une manière différente. Lesia peint donc des tableaux plus universels qui peuvent concerner tous les conflits. Pour elle, le rôle de l’artiste dans la guerre est de « montrer comment mieux comprendre l’évènement ». Paradoxalement, ce conflit a permis de développer une certaine renaissance de la culture ukrainienne par l’émergence de nouvelles idées et inspirations.
Angèle LETERRIER,
Théo VENARD
Résister signifie-t-il tout montrer ?
Balian Le Guen, étudiant au lycée Le Verrier à St-Lô était présent au Forum. Il nous raconte ce qu'il a retenu de deux conférences auxquelles il a assisté.
Quel était le sujet de ces conférences ?
Il s'agissait d'un débat sur la question :"faut-il tout montrer lorsqu'il s'agit de guerre ?". C'était intéressant de voir tous les points de vue des lycéens sur la question. Le débat était organisé par les journalistes de Ouest-France. Avant, ils nous ont montré un article de leur journal présentant le témoignage d'un soldat français opérant en Ukraine. Son récit était assez marquant, c'est de là qu'est venu le débat.
Quel était ton point de vue pendant le débat ?
J'étais plutôt contre le fait de tout montrer. Les journalistes ne doivent bien sûr rien dissimuler mais y a-t-il besoin de tout montrer ? Actuellement, beaucoup de photos circulent sur la guerre en Ukraine. En voir une partie suffit à se tenir informé. Tout montrer peut aussi conduire à une "routine de l'information" et à un désintérêt du lecteur. Pour les personnes favorables au fait de tout montrer, les journalistes ne doivent absolument rien cacher de l'information, et plus on a d'images, plus on se sent impliqué. Montrer toutes les images permet aussi de rendre hommage à tous les soldats.
Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce débat ?
Je me suis rendu compte que sans ce genre d'évènement, on ne prend pas forcément conscience que la guerre en Ukraine par exemple, ne se situe pas loin de chez nous et qu'on est plus concerné qu'on ne le croit. Je pense aussi que je ne suis pas le seul à être dans cette situation et c'est pour ça que le débat m'a interpellé. En soi ce n'est pas la question en elle-même mais plus mon rapport à l'information qui était en jeu.
Qu'est-ce que le témoignage de Patrick Chauvel t'a apporté ?
Cela a renforcé ma conviction que mon rapport à l'information n'est pas complet. Il nous a présenté quelques images de ses reportages, notamment l'Ukraine et je n'avais jamais imaginé un tel degré de destruction dans ce pays avec la guerre. Malgré la prise d'information sur les réseaux sociaux assez complète, on n'a pas tous les détails des évènements qui se passent dans le monde. C'est aussi pourquoi le témoignage de Patrick Chauvel était vraiment intéressant et marquant, en particulier ses anecdotes sur ses différents voyages.
Qu'est-ce que tu as retenu de ces deux conférences ?
Si on veut se tenir bien informé, il faut vraiment chercher l'information en profondeur. La guerre en Ukraine influence aussi davantage notre quotidien que ce que je pensais.
Propos recueillis par
Adèle LECLUZE