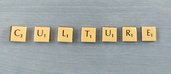Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
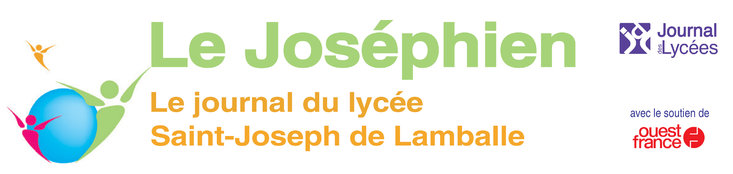
| N° 56 - Mai 2023 | www.lycee-saintjoseph-lamballe.net |
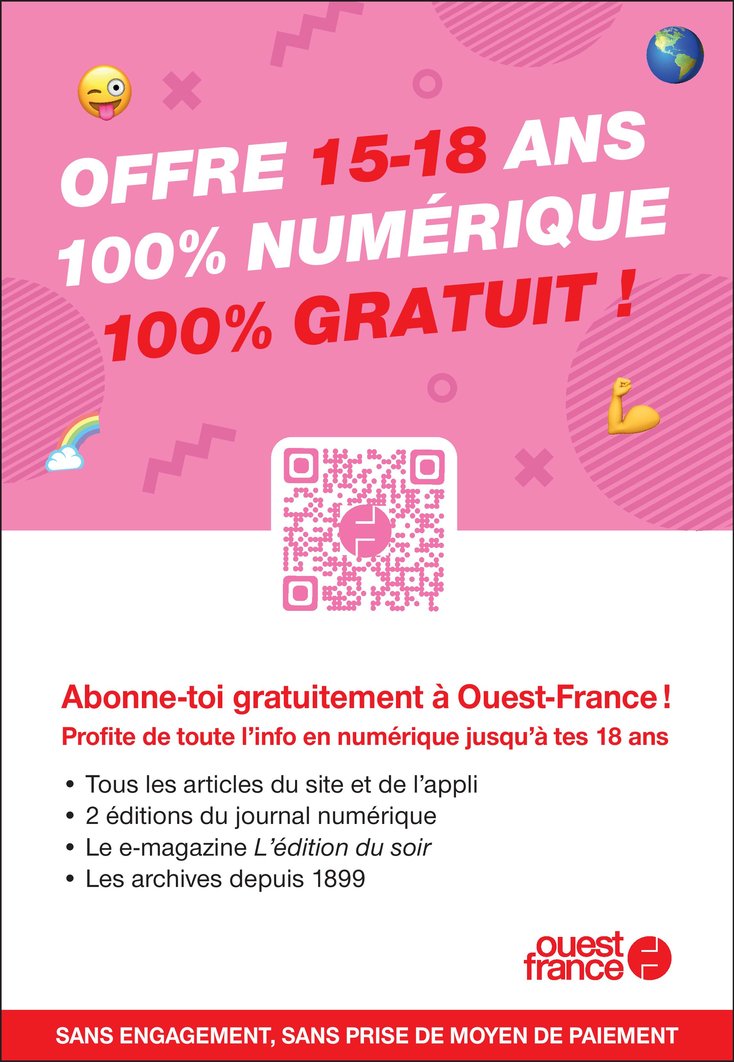
Gwendoline Lemée est restauratrice d'art
Ancienne élève du lycée, Gwendoline a obtenu son bac S en 2007. Voici son parcours.
Quels sont tes souvenirs du lycée ?
J'ai le souvenir de beaux moments d'amitié, mais aussi de l'intensité du rythme et d'une grande quantité de savoirs à assimiler, dans divers domaines. J'aimais beaucoup les matières scientifiques, même si je ne savais pas vraiment où me mèneraient toutes ces connaissances accumulées. Finalement, mon bagage scientifique m'a beaucoup servi par la suite quand j'ai étudié les pigments, les liants, les encres ferro-galliques, la composition du parchemin et du papier, les phénomènes de dégradation des œuvres d'art... Et évidemment, je me souviens du forum des métiers organisé par le lycée où j'ai eu la chance de rencontrer des conservateurs-restaurateurs de bois doré et de sculptures anciennes, installés à Noyal. Ce fut le coup de cœur pour ce métier : l'équilibre parfait entre l'intellect et le manuel, entre les sciences, l'histoire de l'art et l'artisanat.
Quels sont les professeurs dont tu te souviens ?
Je me souviens de tous, chacun avec sa personnalité, son style, sa pédagogie, son humour. Je me souviens d'eux comme des personnes ayant un grand savoir dans un domaine particulier, un univers à chaque fois et une envie de nous transmettre leurs connaissances.
Quelles études supérieures as-tu suivies ?
J'ai commencé par une MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués) au Lycée Vauban à Brest qui m'a ouvert les portes de nombreuses écoles d'art en France et notamment les écoles de Design. Or rester devant un ordinateur ne m'intéressait pas. J'ai donc suivi mon coup de cœur et j'ai passé le concours pour l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon où j'ai commencé mon apprentissage du métier de conservateur-restaurateur du patrimoine. Après avoir validé mon DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques) au bout de trois ans, j'ai décidé de me spécialiser dans l'univers du livre ancien et du papier. J'ai donc intégré La Cambre à Bruxelles (Ecole Supérieure des Arts Visuels) pour valider un Master en conservation-restauration de livres et documents graphiques. Ce furent des années extraordinaires. J'ai adoré le concret de mes études, surtout les sciences appliquées, tous ces savoirs qui prennent enfin leur sens : la chimie des molécules de cellulose et de collagène pour comprendre le papier et le cuir, les mécanismes de dégradation des œuvres d'art, l'usage des polymères dans les adhésifs de restauration... J'ai aussi consacré beaucoup de mes vacances à faire des stages dans divers ateliers de restauration, en France et à l'étranger.
Parle-nous de tes expériences professionnelles
Grâce aux encouragements de ma maman, Annie Raymond-Lemée, professeur d'anglais au lycée, je me suis tournée vers le Royaume-Uni pour commencer ma carrière. J'avais lu et étudié de nombreux auteurs anglo-saxons dans le cadre de mon mémoire de fin d'études et j'aimais beaucoup leur approche patrimoniale. J'ai donc commencé par travailler dans un atelier privé en Cornouailles anglaises où j'ai été plongée dans le monde de la restauration des reliures anciennes et de documents d'arts graphiques. Cette expérience très enrichissante m'a permis ensuite d'intégrer un poste de conservateur-restaurateur de manuscrits au Fitzwilliam Museum de Cambridge où j'ai passé deux années merveilleuses à restaurer de sublimes et précieux manuscrits (manuscrits enluminés de l'époque médiévale, manuscrits de musique de grands compositeurs comme Bach et Haendel), chartes sur parchemin avec sceaux en cire. Ce fut un environnement très stimulant intellectuellement car j'étais entourée de spécialistes en tous genres et de chercheurs du monde entier.
Quelles missions exerces-tu actuellement ?
Après quatre années passées en Angleterre, j'ai décidé de rentrer en France et de monter mon atelier de conservation-restauration de livres et de documents graphiques. Depuis 2018, je travaille à mon compte pour de nombreuses institutions (musées, bibliothèques, archives) et pour quelques collectionneurs privés. Je passe la plus grande partie de mon temps à l'atelier où je restaure des ouvrages. Mes activités sont très variées. Bien sûr il y a la diversité de la restauration des biens confiés : d'une carte du monde gravée sur papier vergé du XVIIIème siècle à un manuscrit écrit sur parchemin datant du XIIIème siècle ; d'une reliure en cuir du XVIIème siècle avec fleurons dorés sur le dos à un livre d'artiste du XXème siècle. Et puis il y a la diversité des activités : restauration des œuvres, réalisation de conditionnements sur-mesure, constats d'état, documentation des interventions, réalisation de dossiers de candidatures pour des marchés publics, conseil aux conservateurs de fonds anciens rencontrant des problèmes de moisissures par exemple, aide au montage d'exposition, mise en place de formations d'initiation au monde du livre ancien pour des archivistes, et enfin tout ce qui est lié à la gestion d'une petite entreprise individuelle. Pas de quoi s'ennuyer, et surtout, je continue d'apprendre, chaque jour, de nouveaux savoirs. Pour pallier la solitude du métier, je collabore avec d'autres restauratrices indépendantes comme moi.
Quels conseils peux-tu donner aux élèves ?
Travailler et faire de son mieux autant que possible. En effet, mes bulletins de notes du lycée m'ont souvent été demandés, même tardivement, et mes (relativement) bonnes notes m'ont ouvert de nombreuses portes. Et enfin, réalisez vos rêves, visez haut ! Moi qui pensais partir en CAP reliure pour éviter d'avoir à passer le baccalauréat, je me suis retrouvée dans une école prestigieuse avec un Master en poche et de multiples possibilités de travail. J'ai maintenant un beau métier qui me procure beaucoup de joie, une reconnaissance sociale et une stabilité financière.
Propos de Gwendoline LEMEE
recueillis par Valérie HERAULT.
L'état du sexisme en France : une situation alarmante
Le sexisme ne recule pas dans la société française et ses manifestations les plus violentes s'aggravent en particulier chez les jeunes générations. Tel est le constat préoccupant du rapport annuel 2023 du Haut Conseil à l'Égalité (HCE). Malgré des "avancées considérables en matière de droit des femmes" et une sensibilisation importante face aux inégalités notamment depuis Metoo, les clichés et les stéréotypes perdurent.
Des chiffres qui interpellent
La majorité des Français (93 %) estime qu'hommes et femmes ne sont pas traités de manière égalitaire dans la société. Un quart des hommes de 25 à 34 ans pense qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Chez les femmes, 37 % disent avoir déjà subi des rapports sexuels non-consentis.
Une réponse globale
En même temps, tous considèrent que l'action des pouvoirs publics est insuffisante. Le HCE propose un plan d'urgence global passant par la prévention dès le plus jeune âge. La régulation du secteur numérique, en particulier les vidéos pornographiques, apparaît parmi les mesures clés. L'intégralité de ce rapport est à retrouver sur "haut-conseil-egalite.gouv".
Ysia DEROUET-PRIDO.
Les Cyber-attaquent les démocraties
Alors que les Etats font face à une intensification de la cybermenace, l'essor du numérique fait planer de nouveaux enjeux sur la scène internationale auxquels tentent de répondre des démocraties déjà fragilisées.
D'un simple piratage informatique à l'utilisation de données personnelles, les cyberattaques peuvent émaner de personnes isolées ou de groupes criminels, éventuellement étatiques. En France, l'essor du télétravail consécutif à la crise sanitaire a entraîné une hausse de 400 % des cyberattaques, touchant entreprises, administrations publiques et citoyens.
Un danger pour les démocraties
Les démocraties se livrent à une véritable guerre de l'information, faisant face à une prolifération des "fake news", particulièrement en période de crise ou d'élections présidentielles. L'enjeu devient géopolitique lorsqu'un État comme la Russie, par le biais du "hack and leak", a tenté d'influencer l'élection de Donald Trump en 2016. Une révélation qui a largement bouleversé le débat public, illustrant l'importance du cyberespace dans le processus démocratique aujourd'hui.
Ainsi, la multiplication des cyberattaques devient une arme de déstabilisation majeure, menaçant l'ordre politique national et international. L’espace numérique devient un véritable terrain d’affrontements, à l’image du conflit russo-ukrainien. En effet, depuis plus d'un an, la cyberguerre russe s'est accélérée, menaçant les administrations publiques mais également l'armée ukrainienne. Aussi, la succession de piratages de messageries d'établissements scolaires comme École Directe instaure un climat d’insécurité globale à une échelle plus restreinte.
Une réponse des États difficile à mettre en oeuvre
L'apparition récente de ces risques nécessite une réponse rapide des États qui peinent à élaborer une politique de cybersécurité en raison de la complexité du phénomène. Aujourd'hui, il n'existe pas de réelle coopération internationale sur ces questions, les États n'arrivant pas à trouver un terrain d'entente. De son côté, l'Union européenne s'investit et crée dès 2004 l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.
A l’image de la France, la cyberdéfense relève avant tout des compétences de l’État. Ainsi, elle doit faire face à ces nouvelles menaces et réagit en développant un important dispositif de cybersécurité, pouvant à terme donner naissance à des “sociétés de la surveillance”.
Le cyberespace apparaît, dès lors, comme un nouveau terrain d'affrontements ou de nombreux acteurs souhaitent s'imposer, déstabilisant nos démocraties au niveau national et international.
Ysia DEROUET-PRIDO,
Théophile COLAS.
Une réforme qui ne bat pas en retraite
Contrariée, rejetée, la réforme des retraites ne fait pas l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale tout comme chez de nombreux Français. Les oppositions, nombreuses, se sont mobilisées contre cette loi et ont tout tenté jusqu'au dépôt de motions de censure, en vain.
Contrainte d'utiliser le 49.3 pour "forcer" le passage de la réforme, il n'est pas anodin que la Première ministre, Elisabeth Borne, en soit venue à cette ultime solution. En effet, comme exprimé par le Président, Emmanuel Macron, lors de son discours télévisé le mercredi 22 mars, cette réforme bien qu’assujettissante, est nécessaire pour maintenir la stabilité économique du pays.
Un mécontentement tant compréhensible que répréhensible
Suite à cette instauration poussive de la loi, nombreuses ont été les oppositions politiques et syndicales à se soulever et à appeler à manifester. D'importants débordements sont survenus alors que les valeurs démocratiques étaient remises en cause par les opposants à la réforme, qui regrettaient l'absence de vote. Aussi, cette réforme accroîtrait les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Le 14 avril, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. En tenant compte de l'allongement de l’espérance de vie et de la nécessité de cette loi pour pérenniser l'équilibre financier du système des retraites, il a décidé de la valider.
Théophile COLAS.
Repas solidaire au lycée Saint-Jo
Tous les ans, l'espace "Réjouis-toi" organise un repas solidaire pour aider une petite association locale. Cette année, nous avons voulu aider l'association "Léo super héros".
Le jeune Léo, âgé de 11 ans, est atteint d’une maladie génétique qui entraîne un mauvais fonctionnement de ses muscles. Le jeune garçon ne peut ni tenir debout, ni marcher. Il souffre de raideurs dans les bras et les jambes. Il ne se déplace qu’en fauteuil électrique ou en tricycle. Cette maladie occasionne des frais très importants qui ne sont pas pris en charge. Il a besoin d’un auxiliaire de vie scolaire qui l’accompagne douze heures par semaine pour lui faciliter les gestes quotidiens.
Le problème moteur de Léo est apparu à la naissance. Depuis l'âge de 5 mois, il va régulièrement chez le kinésithérapeute pour garder de la souplesse dans les membres, mais cela ne suffit pas.
Ses parents multiplient les démarches et les recherches afin de trouver des solutions pour que Léo progresse. Malheureusement, il n'y a pas de prise en charge pour les différentes thérapies qu'il suit.
L'association « Léo super héros » multiplie les actions afin d’obtenir des fonds pour que Léo profite encore de thérapies qui lui donneront la possibilité de progresser. Malgré de nombreuses actions, l'association a besoin de nous, élèves, professeurs, personnels du lycée Saint-Joseph de Lamballe afin de permettre à Léo de gagner en autonomie.
Elouana GUILLAUME.
La soeur de tous les lycéens
Soeur Solange est une religieuse de la Congrégation des Filles de Sainte-Marie de la Présentation et vit dans une communauté à Lamballe.
La religieuse a été engagée au sein du lycée en tant qu'animatrice de la pastorale scolaire. Elle assure une permanence à l'espace "Réjouis-toi" le midi tous les jours de la semaine sauf le mercredi. Soeur Solange y est présente pour accueillir les élèves. Elle les écoute et échange avec eux sur des sujets qui ne sont pas toujours en lien direct avec la religion.
Elle organise avec un groupe d'élèves volontaires les célébrations de Noël et de Pâques au sein du lycée. Elle intervient aussi dans certaines classes pour proposer des temps de réflexion et permettre aux lycéens d'acquérir une culture religieuse.
Soeur Solange est une personne souriante, ouverte d'esprit, à la bonne humeur communicative
Soeur Solange, est-ce facile actuellement, d'être une religieuse dans une société qui croit de moins en moins en Dieu ?
Non ce n'est pas évident car la place de l'engagement définitif effraye beaucoup de jeunes. Maintenant quand quelqu'un n'aime pas faire quelque chose, il change... ce que ne font pas les religieuses. Aujourd'hui, chacun veut sa liberté, ne pas dépendre d'un supérieur comme Dieu.
Sacha LOGEAIS-JOUANNO.
S'engager et espérer ?
Par définition, l’engagement est la participation active d’un individu, en lien avec ses convictions profondes, à la vie publique. A l’heure où l’on est parfois tenté de se replier sur soi-même et d’être individualiste et au moment où l’évolution de la société nous questionne et peut nous rendre égoïste, on peut se demander si la notion d’engagement personnel pour le bien du collectif est toujours de mise.
Au-delà de cette vision pessimiste qui a été accentuée par les années COVID, peut-on espérer que les jeunes générations impulsent une nouvelle donne et montrent une autre voie à un monde qui semble être parfois aux abois. Si l’on met en valeur le dynamisme des élèves de notre établissement en lien avec l’idée d’engagement, on peut alors avoir beaucoup d’espoir. Leur investissement dans le développement durable, dans la vie démocratique du lycée ou dans son animation, prouve clairement que cette jeunesse n’est pas à court d’idées et de temps à donner pour faire en sorte que la communauté avance et progresse.
Cette force collective, ce bouillon d’idées aussi novatrices que constructives et cette motivation sans faille nous permettent de déclarer qu’avoir foi en nos adolescents peut être la clef d’un monde plus simple, plus joyeux et plus imaginatif. Il ressort souvent des conversations que l’on peut avoir avec eux que, malgré la pression engendrée par Parcoursup ou le baccalauréat, des idées nouvelles germent tous les jours pour animer la vie de notre lycée, améliorer notre environnement et nous représenter dans divers cadres qu’ils soient sportifs, démocratiques ou linguistiques. Notre jeunesse est une source d’espoir intarissable en qui nous devons avoir confiance pour que notre monde soit plus beau. Celui-ci leur donnera-t-il la chance de s’exprimer autant qu’elle le voudrait ? C’est tout ce que nous pouvons souhaiter. Nos jeunes devront s’armer de patience et de ténacité pour exprimer leurs idées et faire évoluer les mentalités. Nous pouvons être sûrs que leurs multiples talents les mèneront loin et que cet engagement si cher à nos yeux leur apportera la réussite qu’ils méritent.
Emmanuel FERRON.

Un échange inédit avec la Hongrie
Dans le cadre de l’ouverture à l’international, pour élargir leurs connaissances, leurs relations sociales et aussi « to improve their english » dix-huit élèves et deux professeurs ont choisi de participer à un échange scolaire avec le lycée de Dabas, en Hongrie.
Partir et découvrir
C’est au mois de décembre que nous avons voyagé vers la Hongrie. Bien accueillis, par les jeunes, leurs familles et l’équipe enseignante, nous avons participé à des cours de langues, réalisé des travaux pratiques en laboratoire sur le thème du développement durable.
Nous avons également pratiqué le bobsleigh et le patin à glace. Nous avons visité la ville de Dabas, de Visegrad au nord du pays et la capitale, Budapest, dont le célèbre Parlement et les thermes.
Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir écouter des chants de Noël de la chorale de l’académie de musique de Budapest.
Accueillir et partager
En mars, les élèves ont reçu leurs correspondants dans leurs familles et à l'école. Le lycée leur a préparé un petit-déjeuner français avec croissants. Ensuite, ils ont assisté, avec leurs correspondants, à des cours pour vivre une journée-type au lycée.
D’autres activités ont été programmées dans l’établissement comme les danses bretonnes, la confection d'un dessert « le pain perdu » et la création d’un gel hydro alcoolique dans les laboratoires de sciences. Ils ont été reçus par le maire de Lamballe afin de leur souhaiter la bienvenue et renforcer nos liens.
Tous les élèves ont découvert notre patrimoine avec la visite du Mont Saint-Michel et son abbaye, Saint-Malo, la ville de Lamballe et son haras… Enfin, ils ont pratiqué le kayak à Erquy ! La semaine s’est conclue par une soirée conviviale avec les familles !
Isabelle FERREY.
Voyage des Roumains au lycée : un élève aux commandes !
Vous l'avez sûrement remarqué, la semaine du 3 au 9 avril des élèves roumains étaient présents au lycée. Ils ont découvert notre région en passant notamment par les remparts de Saint-Malo et les étroites rues du Mont Saint-Michel. Cependant, ce que vous ne savez pas, c'est que ce voyage est le fruit du travail d'un élève de Seconde du lycée.
En effet, sans David Cretu rien de tout cela n'aurait eu lieu. David a des origines roumaines. Il a vécu ses premières années dans ce pays. Il a gardé contact avec des jeunes qui sont aujourd'hui au lycée ; c'était l'occasion rêvée de faire découvrir son pays à ses amis.
Pour David, le but de ce voyage était de faire découvrir la France et le lycée aux élèves de Paşcani grâce au programme qu'il avait élaboré. Ainsi, les lycéens roumains ont assisté à des cours de chinois, d'espagnol et d'anglais. Ils ont découvert notre région et ont notamment visité, un après midi, l'entreprise d'automatisation locale "CIP Ovalt".
Naissance du projet
Pour l'élève de Seconde, proposer le voyage à M. Ferron ne fut pas compliqué : « Il m'a suffit de prendre rendez-vous avec lui et de présenter ce que je voulais faire ». Le directeur enthousiaste a alors accepté le projet, aidant David tout en lui laissant une grande liberté d'action. Ainsi, pour tous ce fut une réussite et pour nos invités un souvenir inoubliable.
Louise GAUDEN, Bixente JEGO.
Le système éducatif italien
Les systèmes éducatifs des lycées partenaires étrangers de notre lycée diffèrent du système français. Les écoles secondaires supérieures italiennes, par exemple, offrent différents types de programmes, notamment classique, scientifique, linguistique et artistique. Les étudiants choisissent leur programme en fonction de leurs intérêts.
Le programme classique se concentre sur l'histoire, la philosophie et la littérature italienne. Le programme scientifique est axé sur les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et l'informatique. Le programme linguistique est choisi par les étudiants qui se spécialisent dans les langues étrangères (anglais, français et espagnol) et la culture.
Le programme artistique est destiné aux étudiants souhaitant étudier les arts, tels que la peinture, la sculpture et l'architecture et même la mode. D'ailleurs, le lycée San Paolo de Sorrente avec lequel nous avons établi un partenariat cette année, possède son propre groupe de musique, "The Spicy Rock".
Un rythme différent
Les élèves italiens commencent leur journée à 8h30 ou 9h et la terminent à 14h. Ce rythme leur permet de pratiquer des activités, mais aussi de suivre pour certains des cours de soutien. La moyenne d'heures de cours est de 32 heures, mais elle paraît moins lourde que chez nous.
L'an prochain, nous aimerions travailler sur l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Julie BELLEVILLE,
Sara LARANJEIRO.
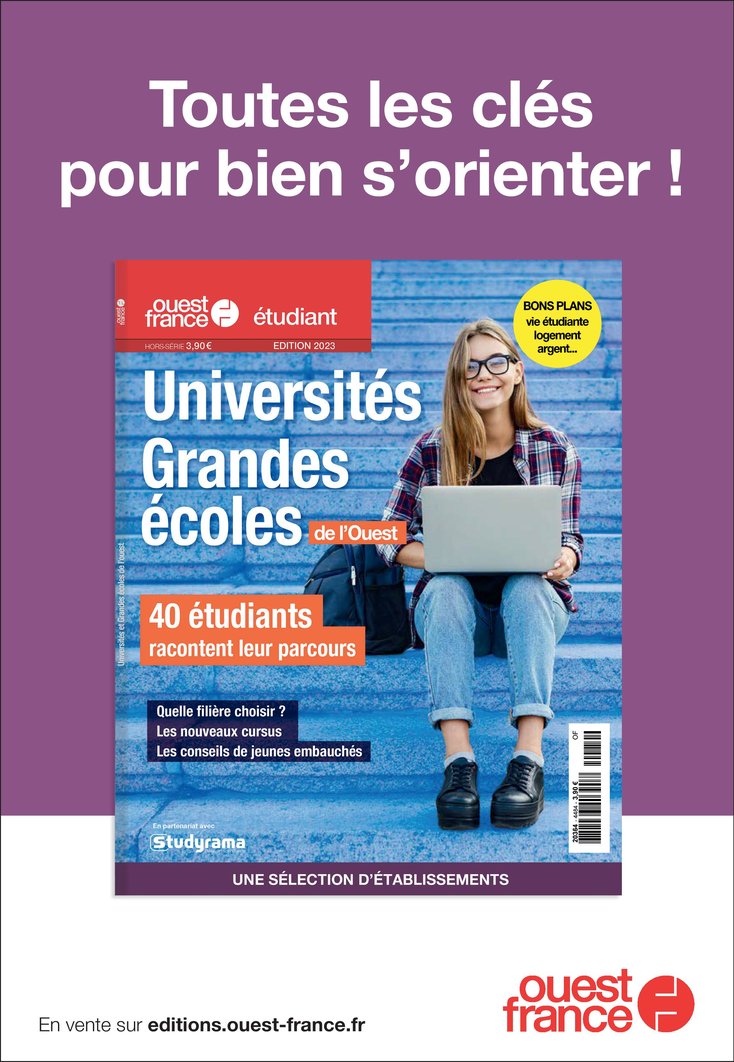
Tous ensemble contre la dette de sommeil
Les étudiants infirmiers informent l'ensemble des élèves du niveau Seconde.
Nous sommes étudiants infirmiers à l’IFPS (Institut de Formation des Professionnels de Santé) de Saint-Brieuc. Dans le cadre de notre formation, nous nous questionnons sur des thématiques de santé publique et proposons des actions dans le cadre de notre service sanitaire.
En novembre, nous avons travaillé sur la thématique du sommeil auprès des élèves de Seconde du lycée. Notre objectif était de déterminer s’ils présentaient une potentielle dette de sommeil. Nous leur avons transmis un questionnaire dont voici le bilan.
Il s’est avéré que la moyenne de temps du sommeil des élèves est plus faible que les recommandations nationales. En effet 6 élèves sur 10 dorment environ 6 à 7 heures par nuit en semaine. A savoir que la norme est comprise entre 8 et 10 heures chez les adolescents.
Les causes du manque de sommeil
Parmi les facteurs favorisants la dette de sommeil, nous avons identifié principalement des facteurs environnementaux tels que le stress ressenti fréquemment en raison d’une pression exercée par les cours et les évaluations. Nous avons remarqué que le rythme de sommeil est irrégulier et que les écrans sont majoritairement présents dans l’environnement des élèves : 4 élèves sur 10 ont tendance à se coucher de plus en plus tard en raison de l’usage des écrans et 9 sur 10 dorment avec leur téléphone à proximité. Selon les recommandations nationales, il est conseillé de les éteindre 2 heures avant de dormir pour favoriser un sommeil réparateur. Les enfants et les adolescents sont particulièrement sensibles à la lumière “bleue” des écrans qui retarde la libération de mélatonine, l’hormone du sommeil.
Un coucher tardif
Concernant le rythme de sommeil, nous avons déterminé que 8 élèves sur 10 vont au lit entre 21h et 22h30 et 1 sur 10 se couche après 23h. Malgré ces horaires de coucher, nous observons que 6 élèves sur 10 s’endorment réellement à partir de 23h : parmi eux, presque 2 sur 10 ne trouvent le sommeil qu’après 00h.
Des solutions de remédiation
Au regard de ces résultats, nous avons mené deux activités sous forme ludique : un Escape Game et des séances de relaxation au sein de l'établissement. A travers ces activités, nous avons sensibilisé tous les élèves de Seconde aux bienfaits du sommeil sur la santé, en leur fournissant différentes connaissances sur les facteurs favorisant la dette de sommeil et sur les moyens de les éviter. Nous les avons également initiés à différentes techniques de relaxation, par la respiration et l'automassage des mains afin qu’ils puissent être capables de réguler leur stress dès qu’ils en ressentent le besoin. Des numéros d’écoute et des ressources physiques, numériques et psychologiques leur ont été transmis, pour les rendre autonomes dans la gestion de leurs émotions.
Les étudiants de l'IFPS.
Faut-il être cultivé pour réussir ses études ?
Ces dernières années, de plus en plus de formations post-bac font passer à leurs candidats des tests de culture générale. On associe souvent cette dernière à la réussite académique, à un moyen de se démarquer scolairement. Mais est-elle réellement si importante ?
Évidemment, cela peut dépendre de votre parcours : un cursus universitaire vous demandera de développer davantage votre culture qu’un diplôme professionnel ou un parcours scientifique. Quoi qu’il en soit, avoir une certaine culture s’avére utile.
D’abord, de nombreuses écoles vous inciteront à vous « cultiver » pour comprendre les travaux que vous réaliserez. Les meilleures écoles (dans de nombreux domaines) prennent en compte les acquis culturels des candidats pour les sélectionner. Ainsi une école d’architecture valorisera un élève qui se renseigne par lui-même sur la profession. Connaître le corps humain donnera un réel avantage à un étudiant en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)…
Malgré tout, sur Parcoursup, vous êtes pré-sélectionnés par vos notes et ce sont vos résultats qui vous permettront ou non d’obtenir un diplôme. L'important est d'assimiler les méthodes et connaissances.
Donc, pas d’affolement, aucun besoin d'être un puits de savoir pour réussir. Selon les plus grandes écoles de commerce (EDHEC,ESSEC...) le but est surtout de « redevenir acteur de sa curiosité intellectuelle », d'apprendre à se renseigner par soi-même.
Malo FONTANELLA.
Option théâtre : le soutien précieux des professionnels
Ce n'est un secret pour personne : le lycée Saint-Joseph propose une option théâtre. Cet accès au sixième art, celui de la scène, est encadré par des acteurs, actrices, metteurs et metteuses en scène qui chaque année aident les élèves à mettre en place et à structurer leur projet final : le spectacle de fin d'année.
Le fonctionnement
En bref, à intervalles réguliers, des professionnels animent des cours de théâtre en collaboration avec un professeur. Ils proposent également des pistes pour le spectacle (pièces, mise en scène, méthodes) qui permettront aux lycéens de rechercher et de progresser dans leur jeu. Bien sûr, tout cela est évalué et compte pour le contrôle continu et le bac. Les intervenants donnent des conseils mais aussi du travail. Il est possible d'avoir une scène à écrire ou alors des mises en scène particulières sur lesquelles s'entraîner.
Marie-Lis Cabrières
Nous avons interrogé cette intervenante sur les raisons de son engagement dans ce partenariat. Elle nous confie : « J'ai toujours aimé transmettre, partager l'expérience de mon métier, créer, inventer des manières de découvrir le théâtre et raconter des histoires. »
Aëlik CONESA, Loïs PERRIN.
Bientôt en retraite !
A la rentrée prochaine, deux professeures auront quitté le lycée Saint-Joseph.
Mme Louisanne Lévêque, professeure d'anglais en filière générale et Mme Isabelle Ferrey, professeure de STMS auprès des ST2S partiront en retraite à la rentrée 2023. Elles ont accompagné des centaines d'élèves au cours de leur scolarité.
Arrivée en septembre 1986, Mme Louisanne Lévêque aura passé 37 ans au sein du lycée Saint-Joseph.
Qu'est-ce qui vous a motivé à enseigner ?
J'ai commencé à écrire et à lire à l'âge de 5 ans, car dans mon village, il n'y avait pas de maternelle. J'invitais mes camarades à la maison et à l'aide d'un tableau, je leur faisais la classe. En somme, je jouais à la maîtresse. J'ai toujours souhaité être institutrice et par la suite, je me suis tournée vers l'anglais.
Si vous aviez une ou plusieurs choses à garder en mémoire dans votre carrière, quelles seraient-elles ?
La transmission, la communication et la rencontre à l'autre. Je me dis que je fais toujours de jolies rencontres, car chaque élève est différent. Tout cela m'a véritablement portée.
27 ans au lycée
Mme Isabelle Ferrey est arrivée au lycée en septembre 1996. Elle aura passé 27 ans au sein de l'établissement.
Avez-vous un souvenir marquant en tête ?
Les résultats du bac étaient un moment fort de l'année scolaire. Je garde aussi en mémoire les préparations de la fête de la St-Jo. J'ai également adoré les voyages ; c'est très enrichissant.
Qu'est-ce qui vous rend fière dans votre métier ?
C'est d'avoir permis à des élèves de prendre confiance en eux pour pouvoir poursuivre leurs études et d'avoir pu établir une relation chaleureuse ainsi que des échanges humains sympathiques qui aident à avancer.
Nos deux professeures partent avec le sourire et avec des tonnes de bons souvenirs. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite et nous espérons les revoir à divers moments de l'année. Merci à elles.
Alexandre LEONARD.
Les latinistes traduisent des textes inédits
Déchiffrer d'anciennes tablettes de médecine jamais traduites, un challenge pour les latinistes.
Depuis trois ans, notre lycée s'est lancé dans un projet de traduction des planches anatomiques du célèbre médecin du 18e siècle, Eustache. Un défi pour les élèves latinistes, supervisé par la professeure Élodie Barbier en collaboration avec d'autres lycées et universités, sous la tutelle du professeur Benoît Jeanjean, professeur de latin à l'université de Bretagne de l'Ouest (UBO).
Ces planches écrites en latin n'ont jamais été traduites. Un fait qui a motivé les élèves qui se sont lancés dans ce travail avec intérêt.
Mais il reste des œuvres à traduire
En effet, le projet est loin d'être arrivé à son terme, malgré l'efficacité de nos petits traducteurs. Il reste un grand nombre de planches anatomiques à décrypter, permettant ainsi de continuer ce challenge qui passionne toujours autant les élèves latinistes.
Il leur reste donc encore beaucoup de travail pour que ce fameux projet soit achevé.
Clément ROBIN,
Loïs PERRIN.
Journée de la parole et des droits
Le jeudi 6 avril, les élèves de l'option DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain) ont présenté un procès inspiré des attentats du Bataclan devant un public d'une centaine de collégiens et lycéens. Leur professeur, Monsieur Garanger, les a accompagnés tout au long de ce travail.
S'exprimer à l'oral
Ce procès s'est déroulé dans le cadre de la journée de la parole et des droits, initiée il y a trois ans par Élodie Barbier, professeure de français et de littérature, et Loïc Léon, ancien professeur de SES. Ils ont associé leurs projets respectifs pour créer un temps fort dédié à l'art oratoire. Cet art regroupe différentes formes d'expression, notamment le procès mais aussi des discours, des plaidoiries de la part d'élèves du collège Sacré-Coeur et de lycéens de Première HLP (Humanités, Littérature et Philosophie), des groupes de musique ainsi que de la poésie déclamée.
Cette année, les Premières spécialité théâtre se sont produits "sur le vif" dans les classes, en jouant de manière spontanée devant les élèves.
En espérant que pour les années à venir de nouvelles idées seront apportées afin que cette journée prenne davantage d'ampleur et qu'elle soit accessible au plus grand nombre.
Manuela JAGUIN,
Alexandre LEONARD.
L'histoire de la Saint-Jo
A l'occasion de l'édition 2023 de la Saint-Jo, qui a été une réussite malgré le mauvais temps, grâce aux activités mises en place, nous avons voulu remonter le fil de l'histoire de cette fête avec la CPE Mme Léon qui nous a permis d'en apprendre davantage.
Les premières années
Lors des premières éditions, chaque classe préparait un projet (danse, musique, vidéo...) et tout le monde se rejoignait à la salle des fêtes de Lamballe pour le dévoiler aux autres classes. Les professeurs participaient également. Mme Léon se souvient : « Une fois, on s'était déguisé en soeurs, accompagné de Soeur Solange, c'était génial ! ».
Le changement de format
La Saint-Jo est devenue ce qu'elle est aujourd'hui quelques années avant le Covid. Elle a changé car il y avait de moins en moins d'investissement de la part des élèves. Mais le bureau des lycéens a redonné vie à cette fête.
C'était mieux avant ?
« J'apprécie les deux, c'est juste différent ! ».
En effet, l'ancienne version impliquait la participation obligatoire de l'ensemble des lycéens, contrairement à la nouvelle qui responsabilise un petit groupe de volontaires.
Ilona ROUXEL-BALLAN,
Mélissa PERRIGOUE.
Le BAFA au lycée pendant les vacances
Encore une année de collaboration entre le lycée Saint-Joseph et le CFAG Bretagne.
Depuis quatre ans, en collaboration avec le CFAG (Centre de Formation d'Animateurs et de Gestionnaires) de Bretagne, le lycée organise une formation pour le diplôme du BAFA durant les vacances d'hiver. Nombreux sont les élèves à participer à cette formation.
Qu'est-ce que le BAFA ?
C'est un diplôme qui prépare à l'exercice des fonctions d'animateur en accueil collectif de mineurs tels que les accueils de loisirs, les accueils périscolaires ou encore des séjours de vacances. Cette formation est répartie en trois étapes : un stage théorique de base, un stage pratique et un stage théorique d'approfondissement, tous essentiels pour valider le diplôme du BAFA.
Déroulement du BAFA
Cette année, la formation BAFA a réuni 54 stagiaires : 39 en base et 15 en approfondissement. Les stagiaires en base étaient encadrés par quatre formateurs : Isabelle, Camille, Jérémie et Marion, la coordinatrice pédagogique du CFAG Bretagne. Ce stage de base, d'une durée de 8 jours, a permis aux stagiaires d'acquérir les bases de la législation, de la pédagogie, de la sécurité et de la vie en collectivité en alternant théorie et pratique. Les stagiaires en approfondissement, eux, étaient encadrés par deux formatrices : Anne-Cécile et Florence. D'une durée de 6 jours, ce stage leur a permis d'approfondir leurs connaissances et de faire évoluer leurs compétences. Chaque stagiaire est évalué tout au long de la formation. Il reçoit, à la fin de son stage, une appréciation favorable ou non de la part des formateurs.
Point de vue d'un stagiaire
« Petite, j'allais très souvent en centre de loisirs et j'ai toujours adoré passer du temps avec les enfants. Ma volonté de devenir animatrice est née suite à un stage d'observation où j’ai retrouvé mes anciennes animatrices. Le BAFA m'a permis d'acquérir des connaissances sur la façon d'encadrer les enfants. Pour ce faire on nous a proposé différents types d'activités très divertissantes mais aussi des topos » confie Flavie Bourdonnais, stagiaire en base.
Le BAFA est une formation très appréciée des jeunes car elle permet de développer des compétences en communication, en créativité et en organisation. Elle contribue au développement de l'autonomie et du sens des responsabilités, des qualités essentielles pour exercer le métier d'animateur.
Oneil VODOUNOU.
Collégiens et ambassadeurs !
Nous sommes onze collégiens du Sacré-Coeur appelés "Les ambassadeurs du tri". Encadrés par M. Daniel, nous nous réunissons une heure tous les vendredis près de la zone de compostage. Nous y recyclons et compostons les déchets organiques du restaurant scolaire. Nous avons organisé d’autres actions telles que la présentation de vélos à smoothies (grâce au pédalage, l’énergie produite transforme en smoothie les fruits intégrés dans un récipient !) et de vélos à chargeurs de téléphone. Dans la zone de compostage, nous recyclons les déchets organiques du self pour créer un compost qui fertilise les plantes du collège. Nous venons de façon hebdomadaire pour aérer le compost, c’est-à-dire le retourner pour favoriser le développement des champignons et bactéries qui, avec l’aide des insectes, broient les déchets organiques. On y incorpore aussi les nouveaux déchets organiques de la semaine. On y ajoute des copeaux de bois, des feuilles, des branchages ou même de la paille. Nous nous sommes inscrits sur la base du volontariat parce que nous souhaitons contribuer à la protection de l’environnement. Pris dans un besoin d’échanges inter-générationnels, nous avons contacté les habitants des quartiers voisins du collège pour qu’ils puissent participer au compostage en amenant leurs déchets végétaux. Un projet qui permet aussi de sensibiliser toutes les générations à l’écologie et à la biodiversité.
Candice LE BOUEDEC.