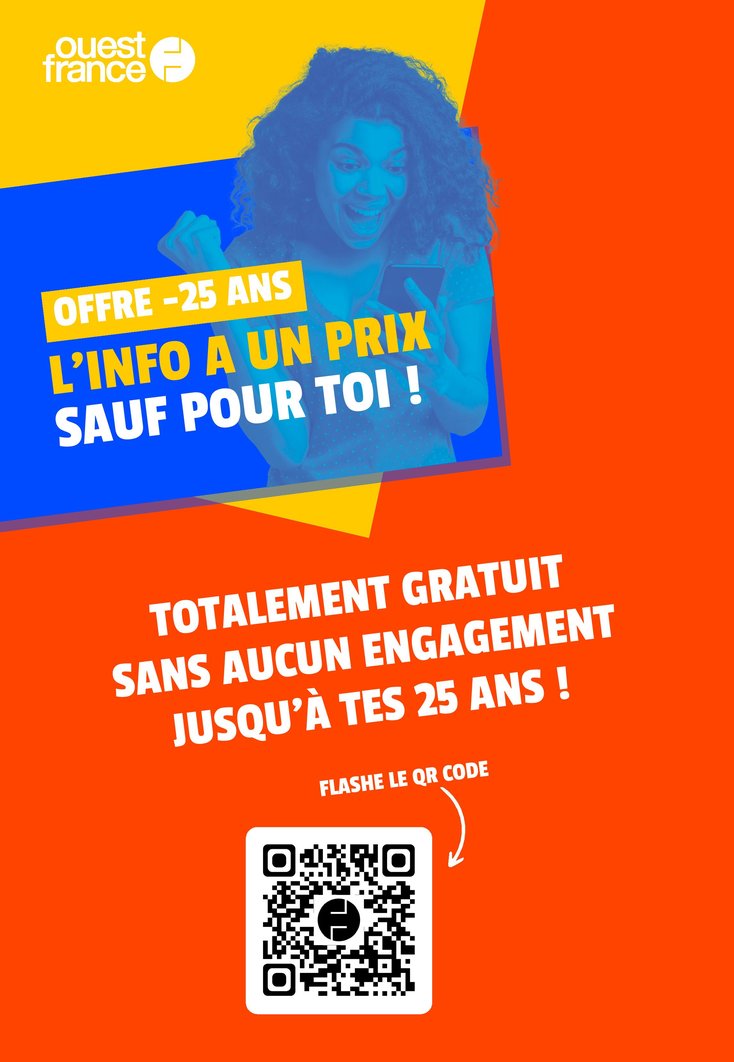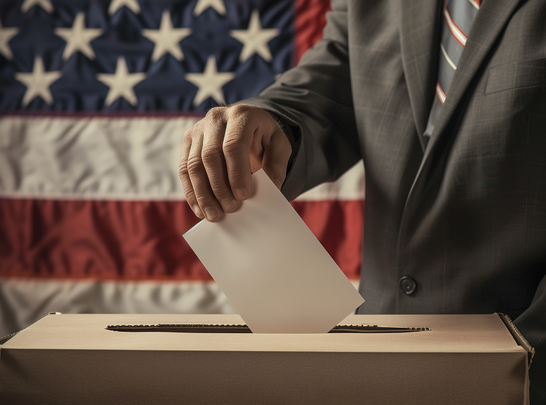Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
L'Art, miroir de l'âme
L'art est partout, depuis la nuit des temps, et sous mille formes. Peinture, danse, écriture… autant de langages qui varient à l'infini selon la sensibilité de chaque artiste. Mais au-delà de la diversité des médiums, l'art, et particulièrement l'art visuel, est avant tout un puissant vecteur d'expression, un moyen d'explorer et de partager nos pensées les plus profondes. Il est le miroir de nos sociétés et de nos âmes.
Quand l'image est porteuse de messages
Loin de constituer de simples ornements pour les yeux, les œuvres recèlent une signification profonde et une réelle intention. L’art représente une véritable manière d’exprimer ses pensées, en laissant libre court à sa plume, son fusain, son pinceau. Considérons ainsi les oeuvres de Jean-Honoré Fragonard, peintre rococo du XVIIIe siècle. Ses toiles, comme Le verrou ou Les hasards heureux de l'escarpolette, transmettent des messages plus ou moins explicites. À travers elles, l'artiste met en lumière les enjeux et les dangers de l'amour, n'hésitant pas à aborder des thèmes comme l'infidélité ou la duplicité dans les relations humaines. Dans un tout autre genre, Goya s'est insurgé contre les exactions dont ont été victimes les insurgés madrilènes, fusillés le 3 mai 1808 par l'armée d'occupation de Napoléon Ier... vous aurez reconnu El tres de mayo. A travers sa maîtrise esthétique, il donne corps à une idée et rend hommage à toutes les formes de résistance. A l'instar de Pablo Picasso, Il donne corps aux émotions, met en forme ce qui est abstrait, traduit l'indicible, l'ineffable : la puissance graphique de Guernica montre plus efficacement que ne le feraient les mots l'horreur du raid aérien allemand sur la petite ville basque, en avril 1937.
L'art, catalyseur d'intelligence émotionnelle
L’initiation à l'histoire de l'art et l'analyse des chefs'd'oeuvre participent activement au développement de l’intelligence émotionnelle, et permet à l’esprit de s'aventurer sur les chemins que la rationalité n'ouvre pas forcément. Il est frappant de se découvrir une complicité intellectuelle avec les initiés, car l'art offre aussi une formidable opportunité d'échanges et de confrontation des points de vue, afin d’explorer différentes visions de l’homme et du monde. Il éveille ainsi des sentiments inédits et une sensibilité accrue. Il est intrinsèquement bénéfique.
Mais quelle est la source de l'inspiration chez l’artiste ? Pourquoi cette impulsion créatrice ? Cet insondable mystère qui donne corps à une idée, une pensée, un sentiment, peut aussi provoquer une véritable catharsis.
Un héritage éternel et évolutif
Nous avons chacun notre propre vision de l'art, parfois naïve, plus ou moins nourrie de clichés et de bribes de souvenirs scolaires. Cette vision ne demande qu’à s’affiner et à s’affirmer, par la fréquentation d’œuvres et un intérêt sans cesse renouvelé pour les mystères qu’elles recèlent. Mais une chose est certaine : l’art ne se borne pas à la recherche du beau et à l’« esthétique ». Il ne se limite pas à la notion de « bon goût ». La beauté des œuvres d'art est infiniment plus complexe et plus subtile : le banal, l’ordinaire voire le trivial et même la laideur peuvent devenir des objets d'art. Cultivons notre appétence pour l’art, multiplions les expériences esthétiques, et forgeons notre culture !
Lisa Lefeuvre
Édito
Chers lecteurs, chères lectrices,
Vous tenez entre les mains un journal pas comme les autres : le fruit de l’engagement, de la créativité et de l’audace de nos lycéens, en collaboration avec les journalistes de Ouest-France. Rien que ça ! Ce projet va au-delà de l'exercice scolaire, c’est un véritable pas vers le monde, vers demain, vers une citoyenneté active et éclairée.
Dans ces pages nos élèves prennent la plume, la parole, engagent leur responsabilité. Ils enquêtent, questionnent, racontent… bref, ils s’expriment. Et dans un monde où les algorithmes parlent parfois plus fort que les humains, quelle belle preuve de vivacité intellectuelle !
Ce journal reflète aussi ce que nous défendons au quotidien dans notre établissement : une école qui forme des esprits libres, critiques, curieux et solidaires. Un lieu où l’on n’apprend pas seulement à réussir, mais à comprendre, à relier... à rêver aussi. Vous découvrirez dans ce sixième numéro du P'tit Pierrot des rubriques très variées qui sont le reflet direct des choix opérés par les lycéens-reporters.
Alors, à vous qui lisez ces lignes, soyez attentifs : vous tenez entre les mains un concentré de jeunesse, de talent et d’avenir. Et ça, croyez-moi, ça fait du bien.
Vous découvrirez dans ce numéro de juin 2025 les rubriques suivantes : art et culture, mode, voyages, examens, société, sport, économie, international... Sans oublier la page spéciale réservée à l'association des anciens élèves de Saint-Pierre.
Bonne lecture et… vivement le prochain numéro !
David Hersin
Directeur
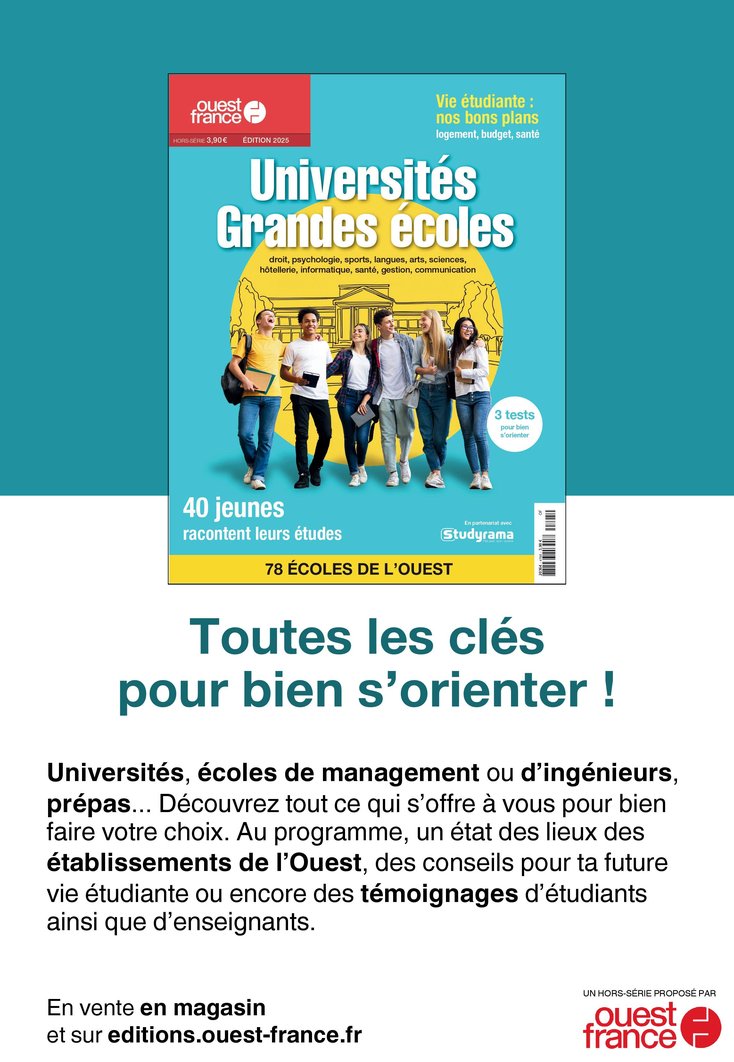
Tendances mode printemps-été 2025
Les tendances sont les lignes directrices d'une société et la mode n'y fait pas exception. C’est pourquoi, chaque année les créateurs se surpassent pour proposer de nouvelles pièces, de nouveaux styles, pour innover, briser les codes et se démarquer. Cette année encore, les plus grands noms du luxe ont apporté de nouvelles tendances à la fashion week, nous donnant tout un éventail de possibilités pour les saisons estivales qui approchent a grand pas. Pour commencer, de nombreuses couleurs ont été mises en avant lors des défilés, par exemple le marron glacé, les couleurs dites "ice cream" avec le jaune beurre, le bleu et le rose bébé ainsi que les couleurs métalliques également mises a l'honneur.
Bleu marine et rouge-cerise
Cette saison encore, le bleu marine et le rouge-cerise seront très présents. Que cela soit pour les teintes de rouge à lèvres, les vêtements et même les cheveux. La saison s’ouvre sur le règne des pois : en imprimé, en perles ou encore sous forme de broderie. Ils feront fureur tout comme l’imprimé fleuri. Les vêtements à volants feront eux aussi leurs grand retour dans un style léger et romantique, ainsi que les bustiers bandeaux vus par exemple chez Chloé. Du côté des jeans, les pantalons larges ou baggy n’ont pas dit leur dernier mot et seront déclinés dans toutes les coupes. Taille basse, haute, chez Valentino par exemple, de la même façon les slims noirs redeviennent tendance. La mode de la cravate classique, ou en lavallière pourrait se développer. Les vêtements transparents et ton sur ton en fonction des carnations dans un effet seconde peau déjà très prisés ne vont cesser de se populariser.
Durant ce début de printemps encore humide, la micro cape, le barn jacket, le bomber perfecto et le pancho - qui remplace le manteau-écharpe - vu par exemple sur Kendal Jenner, seront en vogue. Pour ce qui est du col, de nombreux choix s'offrent à vous : col polo, cheminée ou encore lavallière. La tendance est de les porter en les laissant dépasser d'un manteau. Cependant la mode se démode ! Ainsi certaines tendances sont vouées à disparaître, notamment la longue jupe en jean ou encore les très célèbres Sambas de chez Adidas. Au contraire d'autres persisteront comme l'imprimé animalier, avec le léopard très apprécié la saison dernière, qui s'étendra au zèbre ou encore au flamand rose.
Une tendance certes osée mais qui brille par son originalité est le bondage avec des lacets, des liens ou différentes ceintures superposées dans un effet sexy assumé vu chez Moschino, Diesel mais également chez Dior.
Restez vous-mêmes
D’autres styles bien plus simples ont également été dévoilés, comme les Tee-shirt slogans issus du marketing territorial. Tout le monde connaît l'incontournable I love New York, un style vintage mais qui ne s’épuise pas. Bien que la saison des shorts soit de retour, des alternatives sont envisageables comme le pantalon asymétrique, le skant (pièce hybride entre le pantalon et la jupe), la jupe crayon crayon, et le mini-short assorti au top que beaucoup ont apprécié au défilé Miu Miu.
Enfin, cette saison sonne la fin du minimalisme et le grand début du maximalisme avec, par exemple, les manchettes en or, les colliers à breloques et de nombreux accessoires voyants. Ou encore le medieval core avec ses vêtements en cote de maille et ses vieilles bagues...
Malgré tout, n’oubliez pas de rester vous-même ! Portez ce qui vous plaît, que cela soit à la mode ou non, car il n’y a rien de plus beau que quelqu’un qui assume son propre style.
Chloé Auchart
Les marques de luxe et les enjeux environnementaux
Dans le secteur du luxe, l'environnement s'est transformé en un enjeu stratégique.
Chanel, qui a longtemps été discret, effectue un mouvement mesuré mais symbolique. Avec sa "Mission 1.5", inspirée de l'accord de Paris, la marque vise à réduire les émissions de Co2 de 50 % d'ici 2030. Ces chiffres marquent un profond changement culturel qui se déroule dans une maison traditionnellement ancrée dans son héritage. Chanel privilégie désormais l'électricité renouvelable 100 % certifiée et utilise de plus en plus le transport maritime, moins polluant que le transport aérien (visant 80 % de ses expéditions par mer d'ici 2024, réduisant ainsi son empreinte carbone). Elle a également remplacé certains accessoires en laiton par de l'acier inoxydable (notamment comme les fermoirs des sacs Timeless de la maison), plus facilement recyclables et moins coûteux à produire, ce qui limite les conséquences sur l'environnement sans compromettre la qualité.
Pendant ce temps, LVMH an mis en place son programme LIFE 360. D'ici 2024, 31 % des nouvelles matières premières des maisons du groupe proviendront de processus de recyclage, tandis que le groupe a également réduit les émissions d'énergie de 55 % entre 2019 et 2024. Grâce à ces mesures, ils ont atteint leur objectif avec deux ans d'avance. Cette réalisation montre le besoin croissant de réorienter un domaine, celui du luxe, exceptionnellement dynamique, vers une plus grande rigueur imposée par la durabilité.
Martin d'Herouville
et Valentine Etienne
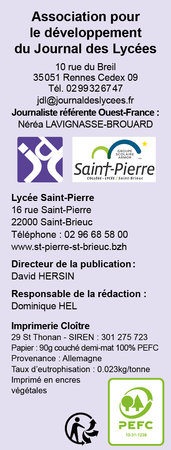
Des clés pour gérer son stress en examen
Les examens sont souvent une source majeure de stress chez les étudiants. C'est un véritable problème qui affecte leur concentration et leur performance.
Tout d'abord, pour appréhender son stress de la meilleure des manières il faut réussir à trouver ce qui le provoque.
Cela peut-être une situation particulière, des pensées négatives ou encore une mauvaise gestion du temps. Une fois que ces sources de stress sont bien identifiées, il faut se concentrer sur de petites astuces simples à mettre en oeuvre quotidiennement. Voici quelques exemple que tu vas pouvoir utiliser...
Un sommeil réparateur
Bien dormir aide à notre récupération physique mais aussi mentale. Dormir de façon régulière à des heures adaptées selon nos besoins est très important pour éviter d'accumuler trop de stress tous les jours.
La pratique d'une activité physique régulière
En plus de trouver un sport que tu aimes et qui vas te procurer du plaisir, cela peut t'aider à te défouler et lâcher prise. Toute les tensions disparaissent et le stress par la même occasion.
Une organisation efficace
Un bon emploi du temps avec une répartition de tes révisions peut faire la différence. En les planifiant, en te fixant des objectifs réalisables et en espaçant tes différentes tâchess tu te sentiras beaucoup moins submergé au dernier moment.
Apprendre de petites techniques de respiration
Enfin, apprendre à gérer sa respiration, que ce soit pendant un examen ou dès que le stress commence à arriver, peut être un véritable allié efficace et discret. Pour cela, rien de très difficile : inspire lentement par le nez en gonflant ton ventre puis expire doucement par la bouche. En répétant cela plusieurs fois, tu vas te recentrer !Lucile Leroy
Deux systèmes scolaires, deux visions de l’éducation : France vs USA !
Vous pensez que l’unique différence entre le système scolaire français et américain est que les élèves finissent plus tôt outre-atlantique ? Et bien détrompez-vous !
Alors qu'en France le lycée s'étend sur trois années (2nde, 1e, Terminale), c'est en quatre ans aux Etats-Unis, et selon cet ordre : “Freshman year" (9th grade), qui correspond à notre classe de 3ème, "Sophomore" (10th), "Junior"(11th) et l'année de "Senior" (12th) qui boucle le lycée ("high school"). Concernant la notation, en France, les élèves sont notés sur 20 avec un exigence académique parfois très poussée. Aux Etats-Unis, le système repose sur des lettres : de A (excellent) jusqu’à F (échec). Chaque note correspond à un certain nombre de points, qui forment ainsi la moyenne appelée "GPA" (grade point average). De plus, l'approche des enseignants américains sur la réussite et l’échec diffère en valorisant particulièrement les efforts et les progrès des élèves.
En France, les élèves suivent un tronc commun avec des matières imposées comme le français, l’histoire-géographie, ou encore les mathématiques. Alors qu'aux Etats-Unis, les deux seules matières obligatoires sont l’anglais et l’histoire américaine. Pour le reste, les élèves ont le choix entre différentes disciplines, dont certaines plutôt inhabituelles pour nous (danse, céramique, menuiserie, photographie). Par ailleurs, le sport occupe une place prépondérante dans les collèges et lycées américains lorsqu'en France, il reste une matière parmi d’autres, associée à moins d’enjeux et moins reconnue. C’est d’ailleurs pour leur permettre de s’entraîner que les élèves américains terminent les cours à 15h. Il existe aussi une véritable culture du sport d’équipe, avec des matchs qui sont de vrais événements, suivis par toute la communauté scolaire. Pour certains élèves, le sport représente même une opportunité d’être admis dans de grandes universités, grâce aux bourses qu’ils peuvent obtenir en raison de leurs performances.
Une multitude d’activités extrascolaires sont également proposées : théâtre, éloquence, club d’échecs, robotique, débats d'idées... Ce qui valorise l’engagement, la curiosité et l’esprit d’équipe. Enfin il y a aussi toutes les représentations que nous, Français, connaissons, à travers les films et séries : le "yearbook" avec ses photos et mots d'élèves, le bal de promotion ('prom"), les "homecomings" (ex : fête de retour en classe), le "spring break"... Ces nombreuses traditions contribuent à reserrer les liens entre élèves. En France, si certaines festivités sont organisées, elles se font davantage à l'initiative de chaque lycée et sont moins populaires. Et si le système scolaire idéal résidait dans la combinaison de ces deux modèles ?
Victoire Uguet
Orientation et inégalités de genre
Au lycée, le choix des spécialités est un moment clé pour l’orientation des élèves. Avec des filières encore trop genrées.
Au lycée, le choix des spécialités est un moment clé pour l’orientation des élèves. Force est de constater que filles et garçons ne se dirigent pas toujours vers les mêmes filières.
Une répartition genrée des spécialités
Certaines spécialités sont plus populaires auprès des filles, tandis que d’autres attirent davantage les garçons. Les spécialités scientifiques, par exemple la physique-chimie ou les mathématiques, sont majoritairement choisies par des garçons. En revanche les filles se tournent plus souvent vers des matières comme les lettres, les langues ou les sciences humaines.
Ces tendances ne sont pas le fruit d’une décision personnelle individuelle, mais sont influencées par des attentes et des pratiques culturelles qui restent présentes, et pernicieuses.
Les statistiques montrent que dans les spécialités scientifiques, les garçons représentent environ 70 % des élèves, alors que les filles sont bien plus nombreuses dans les spécialités littéraires.
Cette répartition, bien que parfois justifiée par les affinités et les intérêts de chacun, reflète aussi des orientations qui ne sont pas toujours libres de toute influence extérieure.
Pourquoi ces différences ?
Plusieurs facteurs expliquent cette répartition inégale, à commencer par l’orientation des élèves dès les premières années de la scolarité. Si l’influence de l’environnement familial et social n’est pas toujours évident, il n’est pas rare que des conseils d’orientation ou des modèles de réussite, plus souvent masculins dans certains domaines comme les sciences, influencent inconsciemment les choix des jeunes.
Les conséquences sur l’orientation professionnelle
Cette répartition genrée des spécialités peut avoir des conséquences sur le futur professionnel des élèves. Les garçons, qui choisissent davantage des spécialités scientifiques, accèdent plus facilement à des secteurs comme l’ingénierie, les technologies ou la recherche.
En revanche, les filles qui sont plus nombreuses dans les matières littéraires et les sciences humaines peuvent se retrouver concentrées dans des secteurs comme l’éducation, la communication ou la santé, où la présence féminine est plus importante.
Des initiatives pour une orientation plus équilibrée
Pour favoriser une plus grande diversité dans les choix des spécialités, certaines initiatives ont été mises en place. Des témoignages d’anciens élèves et d’étudiants dans des domaines peu investis par leur sexe sont mis en avant : il s'agit de démontrer qu’il est possible de dépasser les stéréotypes et d’embrasser une spécialité sans se conformer à des attentes de genre.
Accompagner chaque élève dans son parcours est essentiel, en permettant à tous de choisir librement sa spécialité, et en contribuant ainsi à ouvrir un éventail plus large de possibilités pour l’avenir de chacun.
Joséphine Le Masson
Réseaux sociaux : génération connectée, à quel prix ?
Aujourd’hui, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans notre quotidien et ne cessent de se développer.
En France, en 2024, selon l’INSEE, 99 % des 15-19 ans sont connectés à Internet, contre seulement 48 % des personnes de plus de 75 ans. Cette tendance illustre l’impact croissant des nouvelles technologies sur les jeunes générations, qui utilisent Internet principalement pour naviguer sur les réseaux sociaux. Véritables outils de communication et de divertissement, ces plateformes offrent de nombreux avantages, mais elles présentent aussi des risques non négligeables, tels que la propagation des infox (on ne dit plus "fake news" !), l’addiction ou encore le cyberharcèlement.
Grâce aux réseaux sociaux, on peut accéder facilement à de l’information et à du divertissement.
Que ce soit des journaux ou des personnes qui partagent des contenus, tout le monde peut s’exprimer et toucher un large public, surtout les jeunes. Mais attention : les fausses informations - ou infox - sont partout sur ces plateformes. Elles rendent plus difficile la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, ces fausses informations sont encore plus convaincantes, et donc plus dangereuses. C’est pourquoi dans les collèges et les lycées, on apprend aux élèves à vérifier les sources, et à se fonder sur des médias fiables comme les journaux reconnus ou les sites officiels. Mais ce n’est pas le seul problème des réseaux sociaux.
Beaucoup de gens deviennent dépendants de leur téléphone, parfois sans même s’en rendre compte.
Une étude de l’IFOP montre que 65 % des Français se disent dépendants de leur smartphone. On passe des heures à « scroller » sur TikTok, Instagram ou Snapchat, au point d’en oublier le temps qui passe. Cela peut aussi provoquer un isolement, car on préfère parfois rester seul sur son écran plutôt que de parler avec les autres. Les réseaux sociaux sont devenus un canal courant de harcèlement chez les jeunes. D’après une étude de l’OMS Europe en 2024, 15 % des adolescents disent avoir été victimes de cyberharcèlement, et 12 % reconnaissent en avoir déjà fait subir à quelqu’un. Ce genre de situation peut avoir de redoutables conséquences : perte de confiance en soi, dépression, voire dans les cas les plus graves, automutilation ou tentatives de suicide. Heureusement, il existe des moyens de se faire aider. Il ne faut pas rester seul mais en parler à un adulte, à un ami ou à un professionnel. Un numéro national gratuit, le 3018, est là pour ça. Il existe aussi des associations comme e-Enfance qui accompagnent les jeunes et leurs familles dans ces situations difficiles.
Hélèna Rouillé
To be, or not to be, that is the question
“And that sweet city with her dreaming spires, She needs not June for beauty’s heightening” Thrysis 1866 from Matthew Arnold about Oxford’s dreaming spires.
Du 4 au 9 novembre 2024, nous avons eu la chance - grâce à la spécialité LLCE (langues, littératures et civilisations étrangères) - de nous rendre en Angleterre dans le cadre d’un voyage linguistique et culturel, sur les traces des plus grands auteurs britanniques. Nous avons évidemment débuté par Stratford, ville natale de Shakespeare, où nous nous sommes essayés au théâtre en récréant la célèbre pièce Hamlet sous la houlette d’un comédien de la Royal Shakespeare Company. Le lendemain nous sommes allés à Bath. Si la ville est connue, comme son nom l’indique, pour ses thermes romains, nous nous sommes surtout attardés sur les traces de Jane Austen. En effet, l’écrivaine y a séjourné de 1801 à 1806, ce qui a influencé l’écriture de ses romans. Des lieux comme Milsom ou Benett street en sont devenus la toile de fond.
Une atmosphère so british.
Cette atmosphère faste de l’époque victorienne dans laquelle quelques-uns ont pu se plonger le temps d’un instant, en s’essayant aux robes à fleurs, se retrouve sur les bâtiments de la ville, à l'architecture somptueuse comme en témoigne la place circulaire.
À Oxford l’architecture est également remarquable, mais c'est surtout le prestige associé aux universités comme celle de Christ Church College qui retiennent l’attention. Plus vieille université de la ville, elle a inspiré de nombreux auteurs tels que Lewis Caroll et J.K. Rowling. Plusieurs lieux (citons notamment le magnifique réfectoire, les majestueux escaliers) apparaissent d’ailleurs dans des films culte.
Mais l’Angleterre ce n’est pas uniquement des monuments, c’est surtout des moments de partage et d’échange avec les familles d’accueil, la découverte d’une nouvelle culture et - malheureusement - d’une autre "gastronomie" ! Ce qui est certain, c’est que ce voyage a fait l'unanimité, et qu'il restera dans nos mémoires pendant longtemps : de quoi marquer cette dernière année à Saint-Pierre !
Mathilde Met
Le sucre, un plaisir à haut risque
Nous avons tous l’habitude de consommer du sucre mais est-il si bon pour nous ?
Nous en consommons très régulièrement. Certain plus que d'autre certes. Mais consommé en excès, il peu devenir un vrai poison pour notre cerveau. Chez les adolescents le cerveau est encore en construction alors les effets du sucre peuvent être particulièrement néfastes. Les études scientifiques montrent qu’une alimentation trop sucrée perturbe les performances de la mémoire, de la concentration, peut favoriser l’anxiété et même conduire à la dépression.
Lorsque la consommation est excessive, le taux de glucose dans le sang subit une élévation brutale. Sensible à ces variations rapides, le cerveau peut alors connaître des dysfonctionnements. Ainsi une surcharge alimentaire en glucose nuit au fonctionnement cérébral.
La résistance à l'insuline
Autre effet délétère : le sucre favorise la résistance à l’insuline dans le cerveau, qui est un des mécanismes liés au développement de maladies tel qu'Alzheimer.
Enfin, le sucre agit sur le cerveau comme une drogue, il stimule la dopamine qui est l’hormone du plaisir, et nous pousse à en consommer d’avantage, ce qui conduit à en consommer pour ne pas être malheureux... un cercle vicieux et une spirale infernale.
Un enjeu de santé
Unene consommation excessive de sucre nuit également à une santé physique performante. En effet, consommé en excès, il renforce les risques de diabète et d'obésité. On compte en Franceenviron 17 % d'individus obèses, mais si on ajoute les personnes en surpoids, nous arrivons à 49 %, ce qui est considérable.
Pour votre bien, et pour vous débarrasser de cette addiction de plus en plus présente, vous pourriez par exemple réduire progressivement votre consommation de sucres ajoutés et de produits transformés riches en sucre, pour les remplacer par des produits tels que des aliments naturels, bon pour tous.
Limiter le sucre c’est protéger son cerveau, ses capacités intellectuelles et éviter de tomber dans l’addiction. C'est donc limiter les risques de maladies liées à sa surconsommation.
Maÿlis Griffon
Critique court-métrage Mr Foley
Mr Foley est l'oeuvre d'un duo artisitique irlandais surnommé D.A.D.D.Y récompensé pour son travail dans de nombreux festivals.
Dès les premiers instants, le spectateur est plongé dans une chambre d'hôpital, l'atmosphère est étrange et surréaliste. Mr Foley découvre rapidement que l'un de ses mouvements est accompagné de bruits éxagérés. Le court-métrage joue habilement sur la perception de la réalité en jouant avec les bruitages ("folley" en anglais). Il remet en question la façon dont nous percevons notre environnement.
Ainsi au cinéma, l'élément clé est le son. Iciil n'a rien de naturel, le silence devient assourdissant et angoissant. En effet, il surgit sous la forme d'un bruit de vinyle en fin de course, nous invitant à imaginer une boucle.
Les situations dans lesquelles se retrouve Mr Foley sont à la fois amusantes et déroutantes, ce qui pousse le spectateur à réfléchir sur l'absurdité de certaines conventions cinématographiques.
On peut facilement comparer ce court-métrage à The Truman show. Ils montrent tous les deux l'image d'une société d'illusions. En somme, ce court-métrage est très bien réalisé, tant par son originalité que par son message. Il aborde des thèmes complexes liés à la perception et à la réalité.
Joséphine Le Masson,
Inès Dugaz,
Sacha Merre et Lila Masson
Partis extrémistes : comment évoluent-ils en Europe ?
Ces dernières années, l’Europe a connu une progression des partis extrémistes.
Certains agrandissent leur électorat sans accéder au pouvoir exécutif dans leur pays, quand d’autres y sont déjà installés depuis plusieurs années. Ces différents partis mettent l’accent sur des thèmes comme le rejet de l'immigration, la souveraineté nationale et la critique de l'Union européenne. Cependant l'extrême droite européenne est loin d'être homogène. Elle regroupe des partis (Rassemblement National en France, Fratelli d'Italia en Italie ou le FPO en Autriche) mais aussi des groupes plus radicaux voire violents. Ainsi, on pourrait citer l’AFD (Alternative für Deutschland) aux portes du pouvoir en Allemagne. Au Parlement européen, ces partis siègent dans différents groupes politiques ; ce qui montre leur diversité. Leurs nombreuses divergences (par exemple en matière de politique étrangère) en témoignent.
C’est quoi un parti extrémiste ?
L'extrémisme peut faire penser à une illégitimité et incarner la dangerosité. Cependant dans une démocratie toute opinion respectant l'État de droit, c'est-à-dire les règles qui préservent les libertés, a le droit d'être représentée. Dès lors « l’extrême droite » désigne des mouvements politiques situés à l’extrémité droite de l’échiquier politique. Ils se distinguent souvent par des idées radicales, qui s'écartent fortement des opinions politiques dites traditionnelles.
Quels enjeux pour l’Europe ?
L’Union européenne repose sur des principes fondamentaux : démocratie ou bien État de droit. Plusieurs partis d’extrême droite remettent en cause ces valeurs, notamment en adoptant des politiques xénophobes et discriminatoires, en attaquant l’indépendance de la justice ou la liberté de la presse, comme c'est le cas en Hongrie et en Pologne. D’autres, le plus souvent eurosceptiques, veulent affaiblir l'Europe ou la quitter (Frexit ou l'Italexit), emboîtant le pas au Brexit. Quand d'autres encore espèrent durcir les politiques de migration et de société, et remettent en question des avancés sociales (les droits LGBTQIA+ ou l’égalité homme-femme).
Ce phénomène, perçu comme inquiétant par certains, peut aussi être vu comme un signal d’alarme appelant à réfléchir sur les attentes des citoyens et sur l’évolution de la politique actuelle.
Pourquoi cette tendance européenne ?
Tout d’abord, la crise économique de 2008 et, plus récemment, la pandémie de Covid-19 a fragilisé économiquement de nombreux citoyens européens, provoquant un sentiment de perte de confiance envers les partis traditionnels. Nombre d'entre eux se sentent délaissés par les institutions et certains trouvent dans des discours plus radicaux une réponse à leurs inquiétudes, liées notamment à l'immigration et à un sentiment d'insécurité culturelle. Les réseaux sociaux ont, eux aussi, contribué à la diffusion rapide et massive d'idées extrémistes. Ainsi la montée des partis dits extrémistes peut-elle être analysée comme le reflet d'une perte de confiance mais aussi une aspiration au changement.
Sacha Merré
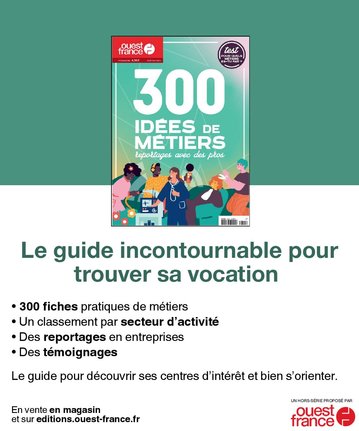
Les Griffons en folie !
D'une simple étincelle à un match face au PSG en quart de finale : l'épopée du Stade Briochin en Coupe de France édition 2024-2025.
Cette année, les hommes de Guillaume Allanou, président et entraîneur (depuis janvier 2024) du club évoluant actuellement en National 2, quatrième division du football français, nous ont proposé un parcours aussi exceptionnel qu’inattendu ! Chaque année, la Coupe de France voit des clubs, que l’on n’attendait pas forcément au tournant, s’illustrer en créant la surprise. C’était cette année au tour du club costarmoricain qui n’avait jamais proposé de tels résultats dans cette prestigieuse compétition, depuis qu’il y a participé pour la première fois lors de la saison 1991-1992.
Des performances exceptionnelles
Avant de se retrouver opposé au géant qu’est le Paris Saint-Germain, qui mettra tragiquement fin à la péripétie, le nom du Stade Briochin a retenti dans la France entière grâce à des succès face à des équipes de très haut de niveau. Par exemple, le Havre AC (32e de finale), le FC Annecy (16e de finale) ou encore une des équipes les plus en forme du championnat français, l’OGC Nice (8e de finale). En allant jusqu’aux quarts de finale, les Griffons et ont ravivé une ferveur indescriptible chez les supporters briochins grâce à leur leur détermination infaillible. Ils ont poussé leur équipe jusqu’à en perdre la voix... Tout ça dans un stade rempli jusqu’au bords du terrain ! Le temps de quelques semaines, l’attention de la ville bretonne était portée sur ces quelques hommes et sur leur talent, qu’ils ont su montrer de diverses manières mais toujours les yeux rivés sur le ballon.
Un avenir prometteur
Cette fabuleuse performance ne peut être qu’annonciatrice d’un avenir très prometteur pour le club, qui peut compter sur des joueurs d’expérience comme Christophe Kerbrat (38 ans, professionnel depuis 2003) et son incontournable capitaine James Le Marer, évoluant dans le club depuis maintenant treize ans. Cet espoir d’un futur radieux repose également sur de jeunes talents tel que Leo Yobé (26 ans) qui a particulièrement fait vibrer les supporters durant cette 108e édition de la Coupe de France de football. Les clubs français sont maintenant avertis, les Griffons ont faim de victoire et nous donnent rendez-vous en début d’année prochaine pour, on l’espère, un grand moment de football, lors de cette édition 2025-2026 !
Raphaël Arduin, Arthur Poupart,
Pierre Méhauté-Gueguen
La natation : un sport complet aux multiples bienfaits
Accessible à tous et sans impact sur les articulations, elle permet de renforcer le corps tout en douceur.
Grâce à l'apesenteur dans l'eau, la natation réduit de 90 % l'impact sur les articulations, limitant ainsi les risques de blessures. Elle est particulèrement bénéfique pour les personnes souffrant d'arthrite ou d'arthrose et aide à préserver la santé osseuse.
Des muscles tonifiés
L'effet d'apesenteur ressenti lorsqu'on est immergé dans l'eau permet de travailler l'ensemble des muscles tout en douceur. Chaque style de nage cible des groupes musculaires spécifiques : la brasse sollicite principalement les biceps, les pectoraux, les abdominaux et les mollets ; le crawl tonifie l'ensemble des muscles : bras, épaules, jambes, poitrine et abdominaux ; le dos crawlé renforce le dos et le papillon les abdominaux.
De meilleures capacités cardiovasculaires et respiratoires
Une pratique régulière renforce le cœur et augmente l'apport en oxygène nécessaire aux muscles, optimisant ainsi la respiration et l'endurance physique. On estime qu'une heure de natation à vitesse moyenne pratiquée au moins trois fois par semaine permet d'améliorer de 12 % les performances cardiaques.
Des bénéfices pour la santé mentale
Source de bien-être, la natation favorise la libération d'endorphine, réduisant le stress et l'anxiété. La natation présente en outre des effets antidépresseurs, qui s'expliquent par l'action de l'eau sur le système nerveux. Elle améliore la concentration, la mémoire, et présente des effets positifs sur la confiance en soi, afin de relever des défis personnels. De plus, elle favorise un sommeil de qualité car la dépense énergétique et la stimulation hormonale régulent le rythme circadien, c'est à dire l'alternance veille/sommeil.
Clémence Neauleau
Bureau de l’Amicale des Anciens du lycée Saint-Pierre : clap de fin
En juillet 2022, six anciens élèves du lycée Saint-Pierre faisaient le pari un peu fou de créer un réseau qui rassemblerait anciens et actuels lycéens. Trois ans plus tard, le premier bureau de l’Amicale des anciens, devenu depuis « La Clé », s’apprête à passer le flambeau après un mandat riche en initiatives, en rencontres… et en tournois de volley.
Dès ses débuts, l’Amicale a souhaité s’ancrer dans l’identité du lycée tout en apportant un vent de fraîcheur. Le changement de nom, de « l’Amicale des anciens élèves de Saint-Pierre » à « La Clé », n’était pas anodin : plus court, plus dynamique, il fait référence au symbole emblématique du lycée, tout en jouant sur l’idée d’un réseau prêt à ouvrir des portes. Le slogan « La Clé, un réseau Clé en mains ! » résume à lui seul la philosophie de l’Amicale : un espace d’échange, de partage et de soutien accessible à toutes les générations d’élèves.
Accompagner les lycéens : du concret, du vécu, du lien
L’une des grandes missions de l’Amicale a été de mettre l’expérience des anciens au service des actuels. Pour cela, plusieurs formats ont vu le jour :
Des interventions en classe, où des anciens viennent partager leur parcours, leurs réussites comme leurs doutes, afin d’offrir une vision concrète de ce qui attend les lycéens après le bac.
Le forum des anciens élèves, temps fort de l’année où se croisent parcours universitaires, formations courtes, reconversions et expériences à l’étranger.
La semaine de l’orientation pour les secondes, où les anciens jouent un rôle de témoins privilégiés, capables de parler avec sincérité de leurs choix post-lycée.
Au fil des années, ces témoignages ont permis de démystifier l’après-lycée, d’ouvrir les horizons, et parfois même, de déclencher des vocations.
Fédérer : convivialité et esprit de promo
Mais l’Amicale ne s’est pas limitée à l’orientation. Dès sa création, le bureau a voulu renouer les liens entre les différentes générations d’élèves, parfois séparées depuis longtemps. Plusieurs événements sont devenus emblématiques :
Les tournois de volley, organisés dans une ambiance à la fois sportive et bon enfant, où anciens élèves et professeurs se retrouvent sur le terrain.
Les soirées et repas des anciens, moments chaleureux et conviviaux où les souvenirs ressurgissent…
Ces évènements, dont certains sont déjà bien fidèles, ne désemplissent pas et sont aussi l’occasion de montrer que malgré les années d’écarts, les expériences et souvenirs à Saint-Pierre sont bien similaires !
Un bureau qui passe le relais, mais un réseau qui grandit
Le 17 mai, lors d’un ultime tournoi de volley, le premier bureau a achevé officiellement son mandat. Trois ans d’engagement, de coordination et d’inventivité. La suite ? Un nouveau fonctionnement, plus souple, va se mettre en place. Le bureau sera plus petit, mais il pourra s’appuyer sur un cercle élargi de membres actifs, prêts à s’impliquer ponctuellement dans l’organisation des événements.
Ce changement permettra à l’Amicale de gagner en réactivité et en diversité, en mobilisant un maximum d’anciens sans leur imposer un engagement lourd sur le long terme. Car si le bureau imagine les projets, c’est bien la mobilisation collective qui les rend possibles.
Les projets à venir : plus de liens et plus de témoignages
L’avenir s’annonce tout aussi prometteur. L’Amicale souhaite continuer à organiser ses événements phares, mais aussi développer un nouveau projet d’envergure : la collecte et la diffusion de témoignages d’anciens élèves aujourd’hui dans le monde professionnel.
Ces témoignages seront mis à disposition des lycéens, via des supports accessibles, et pourront devenir un véritable outil pour affiner son projet d’orientation.
Mieux encore : si un témoignage résonne particulièrement avec un élève, l’Amicale pourra faciliter la mise en relation directe avec l’ancien ou l’ancienne en question, pour aller plus loin, poser des questions, et pourquoi pas… décrocher un stage !
Une aventure collective qui ne fait que commencer
Avec ce passage de relais, La Clé reste fidèle à sa vocation première : créer du lien, faciliter les échanges, valoriser les expériences. Et surtout, rappeler que si l’on quitte un jour les couloirs de Saint-Pierre, on en garde souvent la clé… au fond de sa poche.
Titouan Masson Président du bureau
des anciens élèves
Blackrock le géant de la finance
BlackRock, fondé en 1988, est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.
Avec plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce mastodonte de la finance joue un rôle central dans l'économie mondiale. Mais au-delà de ces chiffres vertigineux, BlackRock influence-t-il positivement ou négativement nos sociétés ? Explorons les multiples facettes de cette entreprise tentaculaire.
Une influence économique tentaculaire
BlackRock détient des participations dans presque toutes les grandes entreprises cotées : Apple, Amazon, Microsoft, ExxonMobil, TotalEnergies, etc. En tant qu'actionnaire important, il a son mot à dire dans les assemblées générales, notamment sur la stratégie des entreprises, les politiques salariales, environnementales, ou encore la gouvernance.
L'entreprise fournit également des conseils et des outils technologiques à d'autres acteurs financiers et à des gouvernements. Son système d'analyse de risque, Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network), gère environ 21 000 milliards de dollars d'actifs, soit plus que le PIB de la plupart des pays. Utilisé par des banques centrales, des assureurs et des fonds de pension, Aladdin permet à BlackRock de modéliser les risques financiers à une échelle planétaire.
Une proximité controversée avec les gouvernements
L'influence de BlackRock ne se limite pas au secteur privé. Le groupe entretient des liens étroits avec plusieurs gouvernements. Aux États-Unis, plusieurs anciens hauts responsables politiques travaillent aujourd'hui chez BlackRock, et vice versa. En Europe, la Commission européenne a suscité la controverse en 2020 en confiant à BlackRock une mission de conseil sur la finance durable, alors même que l'entreprise était fortement exposée aux énergies fossiles.
En France, BlackRock a été pointé du doigt lors des débats sur la réforme des retraites. Son intérêt pour le développement de la retraite par capitalisation, plus favorable à son modèle économique, a été perçu par certains comme une tentative d'influence sur les politiques publiques.
Un engagement environnemental controversé
Larry Fink, PDG de BlackRock, a fait sensation en 2020 en déclarant que "le changement climatique est devenu un facteur déterminant dans les perspectives à long terme des entreprises". Depuis, BlackRock affirme intégrer les critères ESG (environnement, social, gouvernance) dans ses décisions d'investissement et fait pression sur les entreprises pour qu'elles adoptent des pratiques plus durables.
Cependant, cette posture est loin de convaincre tout le monde. Des ONG environnementales accusent BlackRock de greenwashing, dénonçant ses investissements massifs dans les énergies fossiles, l'agro-industrie intensive ou encore des projets miniers controversés. En 2023, un rapport indiquait que BlackRock figurait parmi les plus grands financeurs mondiaux du charbon.
Larry Fink :
un dirigeant influent
Larry Fink est une figure emblématique de la finance mondiale. En créant BlackRock, il a révolutionné la gestion d'actifs en introduisant une approche à la fois technologique et stratégique. Fink utilise son influence non seulement pour diriger les investissements de son entreprise, mais aussi pour orienter le débat public.
Chaque année, sa lettre aux PDG est très attendue. Il y parle d'investissement durable, de responsabilité sociale des entreprises, de gouvernance éthique. Pourtant, beaucoup de ses critiques estiment qu'il y a un écart entre ses discours et les pratiques réelles de BlackRock. Il reste cependant un acteur central dans les discussions sur l'économie mondiale de demain.
Un modèle remis en question
La crise climatique, les inégalités sociales croissantes et les tensions géopolitiques poussent de nombreux experts et citoyens à remettre en question le modèle incarné par BlackRock. Peut-on laisser une entreprise privée gérer une part si importante de l'épargne mondiale ? Quelle transparence exiger d'une entreprise qui conseille des gouvernements tout en poursuivant ses propres intérêts financiers ?
Des régulations sont en discussion, notamment en Europe, pour mieux encadrer les activités des gestionnaires d'actifs. La question de leur responsabilité sociétale est aussi de plus en plus abordée par les ONG et les journalistes d'investigation.
Pour couclure BlackRock incarne à la fois la puissance et les dérives possibles de la finance mondialisée. Son influence est immense, à la croisiée des chemins entre les marchés financiers, les politiques publiques et les enjeux environnementaux. Si certaines de ses initiatives peuvent paraître positives, elles doivent être examinées avec un regard critique.
Face à cette réalité, une seule certitude demeure : le pouvoir de BlackRock appelle à plus de transparence, de contrôle et de responsabilité. Car les milliards gérés déterminent aussi des choix de société, d'éthique et d'avenir.
Raphaël Boucheron-Brault
États-Unis : l'élection présidentielle
Le 5 novembre 2024, les résultats de l'élection américaine tant attendus par le monde entier sont tombés.
C’est Donald Trump, chef de file du parti républicain (parti conservateur orienté à droite) qui l'emporte face à Kamala Harris, en lice pour le parti démocrate, plutôt libéral. Dans le schéma classique américain, le parti démocrate est assimilé au centre gauche. Trump et Harris incarnent l'opposition entre ces deux courants.
Le retour
Donald Trump est déjà bien connu du peuple américain depuis son premier mandat présidentiel, de 2017 à 2021. Pendant toute sa campagne, il a pu compter sur ses partisans, qui se reconnaissent dans l'acronyme “MAGA” ; “Make America Great Again”. Un slogan imaginé par Ronald Reagan, alors candidat républicain à l'élection présidentielle de 1980 (et Président des Etats-Unis qui a exercé deux mandats). Trump se l'est approprié lors de sa campagne de 2016.
Kamala Harris se tient face à ce géant politique qui bénéficie déjà d’une certaine popularité. Alors vice-présidente aux côtés de Joe Biden, elle se présente à l'élection présidentielle comme un nouveau visage de la politique démocrate, mais ne dispose que de cent jours pour effectuer sa campagne.
Changement de cap
Dans un contexte d'inflation massive sous le mandat de Biden, l'électorat américain attend les candidats au tournant sur la question économique. Sur ce sujet, le programme de Kamala Harris se concentre sur la mise en place d'aides financières, la réduction d'impôts pour les citoyens modestes et son augmentation pour les milliardaires, ainsi que la hausse du salaire minimum. Lors de sa campagne, la candidate s'était aussi exprimée sur le droit à l'avortement, radicalement interdit dans de nombreux Etats depuis 2023. Trump quant à lui incarne une position très hostile sur cette question, il a nommé trois juges conservateurs, républicains comme lui, pour siéger à la Cour suprême. Ces mêmes juges ont appuyé la décision qui a permis cette interdiction presque nationale de l'avortement.
America first
Le programme de Donald Trump tient en un slogan : "America First". Son but est de faire des Etats-Unis la première des priorités, notamment économiques, à travers l'augmentation des droits de douane. Une décision qu'il a mise en oeuvre et qui a dernièrement fait grand bruit, suscitant la vive opposition de la Chine. Il impute l'inflation, le coût du logement, de l'éducation et de la santé à l'immigration, point phare de son programme. Il a parlé notamment de "la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des Etats-Unis", qu'il met activement en œuvre aujourd'hui avec en premier lieu des mesures hostiles au personnes issues de l'immigration. Il poursuit la construction du mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Et il évoque la possible remise en place du "muslim ban", qu'il avait créé lors de son mandat en 2017 : il interdisait l'accès au territoire des Etats-Unis aux citoyens issus de sept pays à majorité musulmane. Il veut également juguler l'immigration grâce à l'"immigration and Customs Enforcement" (ICE), une agence de contrôle de frontières.
Le retour de la politique isolationniste ?
Donald Trump fonde aussi son discours nationaliste sur le rejet des relations internationales, autre marqueur de sa politique que d'aucuns qualifient d'isolationniste, et mise en pratique presque immédiatement après son entrée en fonction. Le retrait des Etats-Unis des accords de Paris sur le climat en est l'illustration la plus spectaculaire. Ou encore celui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Un élément cependant contradictoire à cette politique "America First" est sa promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine, garantissant “la paix en 24h”. Une promesse sans résultat puisque son investiture de novembre 2024 n'a pas semblé peser sur la situation en Ukraine.
Un bouleversement géostratégique ?
Ces élections peuvent nous paraître lointaines en tant qu'habitants du "vieux continent", et nous pourrions ne pas nous sentir concernés. Il est toutefois primordial d'avoir conscience de l'influence des Etats-Unis en tant que puissance militaire et diplomatique, et de l'ascendant qu'elle exerce sur une partie du monde, sur l'Europe, sur la France, et indirectement, sur nous. Les résultats d'une élection aussi importante à l'échelle d'une nation peuvent mener dans une direction ou dans une autre. Le mandat de Trump sera vraisemblablement marqué par le retrait et le désengagement des Etats-Unis. Il n'est plus tout à fait un allié pour les démocraties européennes.
Aglaé Salfray