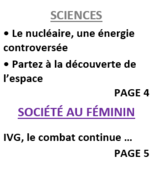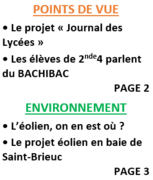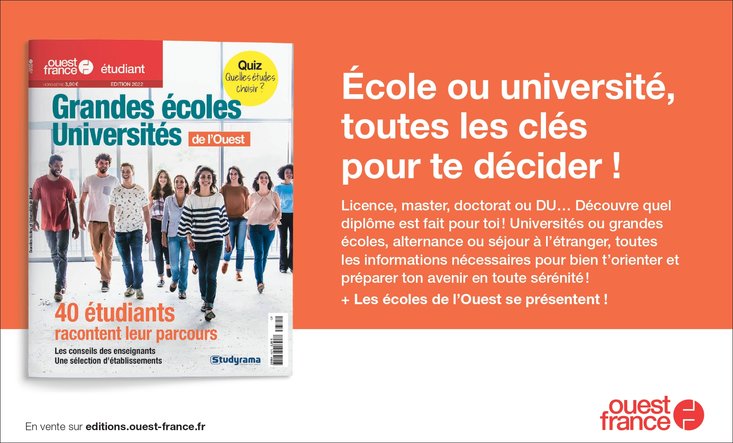Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
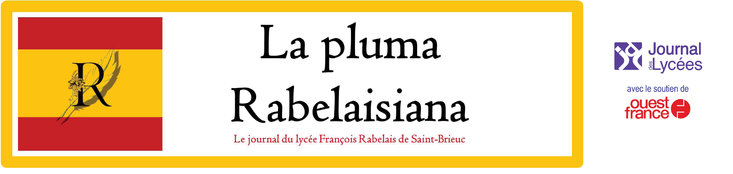
| N° 1 - Mars 2022 | www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr |

Le projet "Journal des Lycées"
Du "Cancre Rabelaisien" à "La Pluma Rabelaisiana".
La genèse du projet
Le lycée avait jusqu’en 2020 un journal Le Cancre Rabelaisien qui s’est arrêté lorsque le CPE qui le chapeautait est parti. Le journal renaît sous une forme qui sera différente chaque année, selon les classes et enseignants, CPE, AED qui y participeront.
Cette année l’association du Journal Des Lycées créée par le journal Ouest-France accompagne le projet, ce qui permet à une journaliste professionnelle d’intervenir auprès des élèves et donne accès à une salle de rédaction numérique. C’est M. Larboulette, professeur de français, qui pilote les lycéens dans la création de cette publication. Ils peuvent aussi s’appuyer sur M. Cancho, professeur d’espagnol, Ciré Djim, AED, et viennent régulièrement au CDI pour se documenter et travailler leurs articles.
Un journal, avec quels objectifs ?
Rédiger un journal donne aux lycéens la chance d’exprimer leurs intérêts et questionnements.
Ils ont choisi ici des thèmes variés qui vont de sujets de société très actuels (féminisme, environnement), scientifiques, culturels jusqu'à l’article plutôt inattendu sur le film La Grande Vadrouille !
Elaborer un journal de A à Z leur permet de comprendre comment se construit une information et de découvrir le monde du journalisme avec ses exigences : travailler en équipe, accepter les remises en question et critiques (bienveillantes), bien s’informer en amont, éviter tout plagiat même involontaire, reformuler, citer ses sources, être attentif aux droits d’auteur. Nous avons d'ailleurs appris que certains cabinets d’avocats traquent les erreurs de droits d’auteur jusque dans les journaux lycéens…
La salle de rédaction numérique ou "chemin de fer" sur laquelle les articles sont mis en ligne avant publication ne laisse là aussi, aucune place à l’à-peu-près.
Les journalistes en herbe se sont lancés avec enthousiasme, énergie et rigueur dans cet apprentissage bien concret de la rédaction d’article et attendaient avec impatience la parution de ce premier numéro de La Pluma Rabelaisiana.
Christine GUIHOT
(Professeure documentaliste)
Les élèves de 2nde4 parlent du Bachibac
Le Bachibac permet la délivrance simultanée du Bachillerato espagnol et du Baccalauréat français. L’élève obtient un double diplôme qui donne accès aux universités des deux pays.
BACHIBAC dans les textes
Les élèves sont en général issus d'une section européenne espagnole. Le programme comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature espagnoles et d'histoire-géographie, à raison de 7 heures hebdomadaires en seconde et 8 heures hebdomadaires en première et en terminale.
En seconde, l'enseignement d'histoire-géographie en langue espagnole et la langue vivante 1 fait l'objet d'un enseignement d'une durée de quatre heures hebdomadaires. Les programmes sont fixés par la France.
Le programme spécifique aux classes de première et terminale comporte un enseignement d'histoire-géographie de quatre heures en espagnol ; et un enseignement de langue et littérature espagnoles en langue espagnole. Il remplace l'enseignement de LV1.
Le programme est fixé conjointement par la France et l'Espagne.
BACHIBAC vu par les élèves
Voici pêle-mêle quelques réflexions des journalistes en herbe de cette section :
"La classe de Bachibac valorise un parcours de formation biculturel et bilingue."
"Le Bachibac permet d'acquérir de nombreuses compétences linguistiques et culturelles. Mais aussi d'approfondir celles que l'on possédait déjà."
"C'est avant tout un atout linguistique, mais aussi une chance de pouvoir échanger avec des hispanophones."
"Pour moi, le Bachibac est une chance de pouvoir étudier dans un pays étranger hispanophone."
"C'est une section passionnante qui enrichit notre vocabulaire et nous ouvre des portes pour aller étudier en Espagne."
"C'est l'occasion de voyager dans différentes parties du monde sans que la langue ne soit une barrière."
Nos journalistes sont :
Lilou ADAM,
Camille BOULENGER,
Youna BRUNEL,
Louenn BRY JORQUERA,
Louis CADORET,
Rose CHANOINE,
Julia CHARLES,
Léonie D'HOINE,
Lisanna GOARIN,
Laura GUERLESQUIN,
Louise HOAREAU,
Monica JIANG,
Erin LE CARDINAL,
Siobhane LE FAOU,
Gaïdig LE HIR,
Malo LE MOINE-FONTAINE,
Timothée LE ROUX,
Pierre-Louis LEGRIS,
Ribi OUEDRAOGO-
CHARRIER,
Janis PAQUET,
Nevena PELLIZERRI,
Zoé PIERRE,
William RIOU,
Lucie SIMON.
Le projet éolien en baie de Saint-Brieuc
Les chiffres clés
- 75 km2 de superficie de parc.
- 207 mètres de hauteur totale.
- 1820 GWh de production d’énergie annuelle, équivalente à la consommation de 835 000 habitants (chauffage compris) soit près de 9 % de la consommation électrique totale de la Bretagne.
- 2,5 milliards d’euros d’investissement.
- 62 éoliennes de 8 Mégawatts : soit 496 mégawatts de puissance totale d'après Ailes marines.
Cette société est en charge du développement, de la construction et de l’exploitation du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Les composants seront assemblés à Brest sur un espace de 11 hectares. L’assemblage complet aura lieu en Espagne et le port de Brest sera à nouveau mobilisé pour le stockage temporaire avant envoi des fondations sur le site. Les 62 éoliennes seront disposées en 7 lignes de 3 à 14 éoliennes, espacées de 1 300 mètres selon la société en charge du projet.
Le projet constitue une opportunité pour le développement de plusieurs activités en Côtes-d’Armor.
2 000 emplois directs sont mobilisés dans le Grand Ouest, dont un potentiel de 1 000 en Bretagne selon le site Batiactu.
Les grandes étape du projet
- 2021-2023 : fabrication et installation des éléments constitutifs du parc.
- 2023 : mise en service et exploitation du parc éolien en mer.
Le projet permet le recours de prestations d’entreprises locales situées majoritairement dans la région Bretagne et Grand-Ouest. Saint-Quay-Portrieux a été choisie comme base arrière pour l'entretien des éoliennes.
Sur la côte bretonne, la pêche est une activité importante. Par conséquent, en s’implantant dans la baie de Saint-Brieuc, le parc éolien doit s’adapter pour partager ce milieu. Ainsi, la société en charge du projet a consulté quelques pêcheurs professionnels concernés et réalisé des changements dans la disposition du parc et sa mise en œuvre.
Un nombre d'éoliennes réduit
de 100 éoliennes prévues en début de projet à 62 actuellement. Cela permettrait ainsi d’augmenter l’espacement entre les éoliennes afin que les bateaux puissent naviguer plus facilement et sereinement au sein du parc.
Une zone d’implantation diminuée
S'étendant initialement sur 103km2, le parc a désormais une superficie de 75km².
Le projet éolien qui voit le jour aux larges des côtes costarmoricaines suscite de vives oppositions au sein des riverains, des promeneurs, et des pêcheurs, inquiets de la transformation du paysage, ainsi que d’éventuels risques ou retombées sur leur activité, toujours selon le site Batiactu.
Monica JIANG,
Louise HOAREAU,
et Janis PAQUET
L’éolien, où en est-on ?
Nous vous éclairons sur la production d'énergie éolienne et ses répercussions sur l'environnement.
Dans le monde
En 2018, la Chine est le premier producteur d’électricité à partir de l’éolien (plus de 28 % de la production mondiale), les États-Unis figurent à la deuxième place (303,4 TWh soit 24 %) et l’Allemagne, à la troisième (126 TWh soit 9 %). Les pays ayant les plus grands parcs éoliens en mer sont : le Royaume-Uni (9,723 GW), l’Allemagne (7,49 GW) et la Chine (6,83 GW).
En France
Le parc éolien français est le quatrième plus important d’Europe en 2019. La France est dans le Top 10 mondial avec une production qui représente 8,9 % de la consommation électrique française. En 2020, la production d’électricité éolienne était de 39,7 TWh.
En Bretagne
La Bretagne figure au 4e rang des régions de France métropolitaine avec 173 installations éoliennes, soit une contribution de 8,7 % au parc éolien national. Le Morbihan et les Côtes-d’Armor rassemblent 56 % des éoliennes de la région. La vitesse de vent minimale pour démarrer une éolienne est d’environ 4,2m/s. (Chiffres : EDF) (Sources : SDES d'après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD)
Avantages
- L’énergie éolienne est renouvelable et ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, et ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs.
- L’électricité éolienne garantit une sécurité d’approvisionnement face à la variabilité des prix du baril de pétrole.
- Elle offre la possibilité de réduire les factures d’électricité.
- L’exclusion de la pêche des parcs éoliens offshore entraîne un effet de refuge pour certaines espèces de poissons.
- L’éolien permet de créer de nouveaux emplois liés aux métiers de la construction et de l'exploitation-maintenance.
Inconvénients
- Elles occupent de l’espace et du champ visuel.
- L’altitude peut poser des problèmes pour les oiseaux et les chauves-souris, qui peuvent être percutés par les pales en mouvement.
- Les éoliennes produisent des grincements engendrés par la rotation des différents éléments mécaniques.
- Elles requièrent une infrastructure de transport énergétique.
- Les champs magnétiques des câbles qui passent sous les plages excèdent les seuils de tolérance.
Malgré l'engouement que représente l'éolien en France, cette énergie constitue une infime part de la production totale d'électricité. L'éolien supplantera-t-il un jour le nucléaire ?
Source : ADEME
Le nucléaire, une énergie controversée
En plein questionnement mondial sur le nucléaire, on refait le point avec vous.
Inconvénients du nucléaire
Les centrales nucléaires engendrent un problème de sécurité croissant. Depuis 1952, de nombreux accidents de réacteurs nucléaires ont eu lieu comme par exemple l’explosion de Tchernobyl en Ukraine (manque de personnel), ou encore celle de Fukushima, au Japon due à un tremblement de terre et à un tsunami. Ces deux accidents ont provoqué des centaines de milliers de décès. En outre, les centrales nucléaires utilisent le plutonium, un métal dur nocif pour les êtres vivants, causant leucémies, cancers et mutations génétiques héréditaires. Cette énergie n'est également utilisable qu’une seule fois et utilisée pour la fabrication d’armes nucléaires. Les deux grandes villes d' Hiroshima et de Nagasaki ont chacune été détruites par une seule bombe nucléaire.
De plus elle produit des déchets radioactifs non recyclables : des matières radioactives (gravats, outils, gants, combustibles usés, pièces usagées...) pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est envisagée (source : Vie publique).
L’Agence internationale de l'énergie atomique affirme que le total des ressources en uranium dans le monde se situerait entre 5 et 8 millions de tonnes et que ces dernières seraient suffisantes pour permettre l’utilisation à long terme de l’énergie nucléaire. Cependant, certaines analyses critiques prouvent que les ressources exploitables en uranium seront épuisées dans quelques dizaines d’années.
Avantages du nucléaire
Selon différentes sources, le nucléaire n’émet pas de CO2, ce qui est évidemment une donnée à prendre en compte tant notre planète souffre des gaz à effet de serre. Cette énergie émet aussi autant de CO2 que toutes les autres énergies renouvelables, environ 7 g CO2/ kWh. De plus, cette énergie est peu chère au moment de sa production et de sa commercialisation. Les centrales nucléaires ont en outre une durée de vie d'approximativement 40 ans, ce qui est considérable. Elle peut aussi s’adapter aux besoins énergétiques mondiaux ou tout simplement français à tout moment de l’année et permet à une partie de la population mondiale d’avoir de l’électricité. En France, les centrales nucléaires sont au nombre de 18 . En augmentant sa production, cette énergie pourrait garantir l’indépendance énergétique de la France d’ici quelques années sans devoir en importer, comme c'est le cas de nos jours.
Louis CADORET
et Pierre-Louis LEGRIS
Partez à la découverte de l'espace
Novices en astronomie ? Nous vous proposons une plongée au cœur de l'espace...
Qu’est-ce qu’une galaxie ?
Un amas d’étoiles, composé de poussières stellaires et de gaz vierge. Une galaxie « meurt » lorsqu’elle ne produit plus d’étoiles. Il y en aurait environ 2000 milliards. La plus grande serait NGC 6872. Elles s'agrègent et forment des amas de galaxies qui peuvent en regrouper plus d’une centaine, liées par la gravitation.
La galaxie d'Andromède ou M31, située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, est notre voisine. Celle-ci et la Voie Lactée, se déplacent et s’attirent. Selon des chercheurs du Space Telescope Science Institute, aux États-Unis, elles entreraient en collision dans environ 4,5 milliards d’années. Elles ne formeraient plus qu’une galaxie, sans engendrer de changements pour la vie sur Terre (source : National geographic).
Supernova ?
D’après le dictionnaire Le Petit Robert, une supernova est l’explosion très lumineuse qui marque la fin de la vie de certaines étoiles.
La première supernova a été observée par l’astronome Tycho Brahé en 2011. La dernière supernova l'a été en 2019. A partir de celle-ci, des scientifiques ont émis l'hypothèse que les étoiles et les nébuleuses seraient issues de la collision de deux naines blanches qui sont des poussières d'étoile.
Le trou noir portail du temps ou créateur de l'Univers ?
Les trous noirs créés par des Supernovas, sont restés inconnus jusqu'au 20e siècle. Depuis leur découverte plusieurs théories ont été émises. Nous allons nous intéresser à deux d'entre-elles ; le voyage dans le temps et la création de l'univers. « Les trous noirs sont des zones dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. » Selon la théorie des " trous de ver " avancée par Einstein Rosen, il existerait comme un pont qui permettrait de voyager dans l'espace-temps, reliant ainsi un univers à un autre. D'un côté il serait comme un trou noir et de l'autre comme un trou blanc.
Un trou blanc ou fontaine blanche, serait un espace dont la matière s'échappe, à l'inverse du trou noir. Selon une autre théorie ces trous blancs pourraient avoir provoqué le Big Bang. Ces théories n'ont jamais été prouvées.
La naissance de l'Univers
Selon la théorie du Big Bang, l'univers aurait commencé à se dilater il y a environ 13,7 milliards d'années et serait toujours en expansion. Selon certains scientifiques, l’univers arrêtera de s’étendre, puis se contractera, c’est le Big Crunch.
Il existe bien sûr d’autres théories quant à l’origine de notre univers. Par exemple celle du Big Bounce, selon laquelle nous faisons face à un cycle constitué de deux phases : un phénomène d’expansion puis de contraction de l’Univers, qui se renouvelle à l’infini.
Camille BOULENGER,
Nevena PELLIZZERI,
Lilou ADAM
et Timothée LE ROUX
L’IVG : le combat continue...
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée en France par la loi Veil de 1975. Histoire et point sur la situation de l’IVG en France et chez ses voisins européens.
Histoire de l’IVG en France
Les seules techniques qui existaient à l'époque pour pratiquer l'IVG étaient plus atroces les unes que les autres, en passant du fil de fer aux aiguilles à tricoter... Dans les années 60, en France, de nombreuses personnes se sont révoltées contre ces méthodes horribles infligées aux femmes. Aujourd’hui, pour avorter il existe deux méthodes différentes :"médicamenteuse", possible jusqu’à 5 semaines de grossesse, et "instrumentale" jusqu’à la 12ème semaine de grossesse en France.
Le planning familial
Le planning familial est créé en 1960. Il prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, l’avortement ainsi que l’éducation sexuelle. Pour cela, il publie un journal qui a pour but d’éduquer les gens autour des sujets de sexualité qui, à l’époque, étaient considérés comme tabou.
Le manifeste des 343 « salopes »
Le 5 avril 1971, le manifeste des 343 ou « manifeste des 343 salopes » paraît dans Le Nouvel Observateur. C’est une pétition signée par 343 femmes qui avouent avoir avorté afin de faire évoluer la loi de 1920 interdisant l’avortement en France. Il a été rédigé par Simone de Beauvoir et commence par ces mots : « Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès au moyen anticonceptionnel nous réclamons l’avortement libre ».
Les figures emblématiques
Quelques semaines plus tard, l’avocate Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir créent « Choisir », une association féministe défendant les droits des femmes. L’année suivante, le procès de Bobigny est volontairement très médiatisé par Gisèle Halimi. L’avocate y défend et obtient l’acquittement de Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 17 ans jugée pour avoir avorté à la suite d’un viol.
Le 17 janvier 1975, Simone Veil, en tant que ministre de la santé, parvient à faire voter sa loi autorisant l’avortement. En 1975, la loi Veil est adoptée provisoirement pour une durée de 5 ans, puis adoptée définitivement en 1980. Depuis ce jour, l’avortement est autorisé en France.
Témoignage d'un avortement avant sa légalistion
Témoignage de Monique 89 ans qui souhaite que ses filles et ses petites-filles ne connaissent pas la difficulté de recourir à un IVG dans l’illégalité.
En septembre 1969, Monique est mère au foyer et son mari technicien. A l’époque, ils viennent d’avoir leur quatrième enfant et se voient dans l’incapacité d’en accueillir un nouveau. Ils décident donc d’avoir recours à l’avortement. En raison de la difficulté d’y accéder, ils décident tous les deux d’en parler avec un couple d'amis dont la femme est médecin. Cette dernière les met en contact avec une faiseuse d’ange (femme qui pratiquait l’avortement clandestinement) à Nantes. A cette époque, pratiquer un IVG est illégal : la loi de 1920 l’interdit. Elle a peur car c’est une opération risquée et illégale, mais elle fait confiance à son amie qui l’a conseillée. Elle ne se rappelle pas l’opération en détail, mais se souvient d'avoir beaucoup saigné quelques jours après. Monique pense que l'autorisation de l'IVG est un grand pas pour l'émancipation de la femme.
L'IVG actuellement en Europe
En Europe, la grande majorité des pays a légalisé l’avortement. Le premier d'entre eux a été l’Union Soviétique sous Lénine en 1920. Staline l’a interdit de nouveau afin d’accroître la population en 1936. Le pays au taux d’IVG le plus élevé est le Royaume-Uni avec le plus long délai (jusqu’à 24 semaines de grossesse). 2,2 % des avortements dans le monde y sont pratiqués. Il est suivi de près par la Suisse avec 2,1 %.
Même si la grande majorité des pays d’Europe l’ont légalisé, l’avortement reste interdit dans certains d'entre eux. Les micro-états d'Andorre, du Vatican et de Malte sont les trois pays d'Europe où l'IVG est encore interdite quelle que soit la situation. En Andorre, la loi prévoit des peines de prison pour les femmes qui auraient avorté, ainsi que pour les médecins ayant pratiqué un avortement "clandestin".
En Pologne, où l'avortement était possible entre 1956 et 1993 "en raison des conditions de vie difficiles de la femme enceinte", le droit à l'IVG a été considérablement restreint ces dernières années. Le gouvernement ultra-conservateur a tenté de l'interdire totalement en 2016, avant de le restreindre. Il est désormais impossible d'avorter en cas de malformation grave du fœtus, ce qui représentait 90 % des IVG dans le pays. Les grossesses ne peuvent être interrompues qu'en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la personne enceinte.
La Finlande interdit l’avortement, sauf aux femmes de moins de 17 ans ou de plus de 40 ans, qui ont plus de quatre enfants ou en raison de "difficultés économiques, sociales ou de santé", détaille le site L’Express. Toutefois, en pratique, "elle est aisée à obtenir".Certains pays sont toujours ancrés dans la religion et la mentalité de certains médecins, surtout en campagne, ne facilite pas l’accès à l’avortement.
En Italie, celui-ci est autorisé, mais la religion est tellement prégnante que la plupart des médecins (70 %) refusent de le pratiquer. L’Espagne est aussi un pays où il est très compliqué d’avorter.
En France, l’article L2212-8 du Code de la santé publique précise « qu’un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG », de même « qu’aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir » à cet acte médical.
Ribi OUEDRAOGO-CHARRIER, Rose CHANOINE,
Siobhane LE FAOU
et Julia CHARLES
Une vie de femme : George Sand
Elle fit scandale et marqua le XIXe en dénonçant une société conservatrice.
Sand a ouvert aux femmes le chemin de la modernité
George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, a utilisé ce pseudonyme pour se faire publier. Au prénom « Georges » elle enleva le « s » afin de se démarquer et de garder son identité. Elle peut être considérée comme une femme moderne et indépendante grâce à ce nom, ses tenues vestimentaires masculines non réglementaires, son habitude de fumer le cigare, sa manière de circuler librement, mais aussi sa vie amoureuse mouvementée qui a fait scandale. Elle est avide de liberté et lutte pour trouver sa place dans un monde d’hommes. Grande séductrice, elle n’hésita pas à enjôler les hommes, parfois en usant de lettres à double sens.
Une des premières écrivaines françaises aux engagements politiques marqués
Initialement, la littérature était pour elle un moyen de gagner de l’argent et grâce à cela, elle s'est affranchie financièrement. Elle a ensuite réellement pris goût à l’écriture. En effet, elle a écrit plus de 70 romans et de nombreuses nouvelles, contes, pièces de théâtre et textes politiques. C'était une républicaine et une socialiste utopique. Cependant, elle n'encourageait pas les femmes à faire de la politique, ni même à entrer à l'Assemblée nationale. La Mare au diable, François le Champi, et La Petite Fadette sont quelques unes de ses œuvres.
Sand a écrit : "L'égalité civile, l'égalité dans le mariage, l'égalité dans la famille, voilà ce que vous pouvez, ce que vous devez demander, réclamer."(Correspondance, 1855-1856)
On pourrait dire que c'est une femme d'avant-garde : en effet dans ses romans elle défendait l’égalité dans le mariage, l’émancipation des femmes et dénonçait leurs conditions de vie peu enviables en France. Malgré cela, elle pensait que la femme ne pouvait allier politique et vie de famille.
Léonie D'HOINE
et Youna BRUNEL
Le sport au féminin
Pourquoi tant de critiques et de clichés misogynes vis-à-vis des femmes pratiquant des sports dits masculins ? Nous avons mené l'enquête...
Selon nous, le sport ne correspond à aucun sexe, un garçon peut très bien faire de la danse, et une fille du foot ou du rugby. D’après nous, les filles sont souvent plus délicates et ont un jeu beaucoup plus joli par rapport au jeu des garçons, notamment au rugby. Pourtant un certain état d’esprit demeure encore aujourd’hui, ce qui entrave une égalité hommes-femmes qui devrait aujourd'hui être acquise.
Certains individus restent complètement fermés à la discussion et tiennent des propos sexistes. D’après un questionnaire d’opinion fait dans notre lycée, les réponses sont parfois étonnantes : le sport féminin serait « plus lent » que le masculin qui aurait, lui, un « niveau plus élevé ».
Cela nous questionne : depuis quand une fille serait-elle « trop fragile » pour pratiquer le rugby ? Depuis quand tenue féminine et pratique du foot ou du rugby sont-ils incompatibles ?
Nous pensions écrire un article sur l’égalité des hommes et des femmes dans le domaine sportif. Malheureusement les réponses vont souvent à contre-courant de ce que les médias reflètent. En effet un jeu féminin, le foot ou le rugby, serait « moins bien, moins fun, plus lent » que le jeu masculin. Une femme qui se maquille, porte des robes et fait du rugby est ‘’bizarre’’. A cause de ces clichés, les filles qui aimeraient se lancer dans le rugby, n’osent pas par peur d’être jugées. Encore une fois, une joueuse a été victime, il y a peu, d'un de ces préjugés : « Arrête de jouer aussi bien, ça m’excite ! ». Est-ce une autre façon de dire que son jeu est mauvais ? Quelle preuve d'intelligence !
En raison de ces idées reçues, les joueuses ont parfois honte de faire ce qu’elles aiment. Des remarques sexistes, parfois très déplacées, les poussent à se cacher ou à rester discrètes.
On parle de progrès entre hommes et femmes mais, franchement, a-t-on besoin de progrès ? Ne vaudrait-il pas mieux faire cesser ces a priori inutiles et polluants qu’on entend autour de nous ? Nous apprenons à ignorer le regard des autres, alors qu’il faudrait simplement apprendre à ne pas juger, critiquer.
Un message d'espoir ? Néanmoins, les adolescents sont de plus en plus ouverts d'esprit et trouvent naturel que des filles pratiquent des sports dits masculins. C’est donc la preuve que les opinions changent au cours du temps et progressent de manière positive. Le fait qu’une fille fasse du foot ou du rugby ; ou même qu’un garçon pratique la danse ne choque plus autant qu’avant. Mais il reste vrai que le sport féminin est nettement moins médiatisé.
De nombreuses étapes restent à franchir pour une réelle évolution des mentalités.
Lucie SIMON, Erin LE CARDINAL
& Zoé PIERRE
Les secrets de "La Grande Vadrouille"
Ce film culte, datant de 1966, fait partie du patrimoine français et regorge de secrets.
Record et lieu de tournage
Avec près de 17,3 millions de spectateurs, La Grande Vadrouille reste le film le plus vu en salles en France jusqu’à Titanic en 1998. Mais avant même le premier jour de tournage, il avait déjà battu un premier record du plus gros budget jamais réuni pour un film à l’époque : 14 millions de francs (2,6 millions d'euros).
La chanson du restaurant
Les personnes qui ont vu La Grande Vadrouille ont entendu la chanson « Tea for Two », mais peu connaissent la raison de ce choix. L’équipe technique ne trouvant pas de chanson pour le film décide d’aller au restaurant pour faire une pause dans la rédaction du scénario. Et à l’instant où ils passent la porte, un pianiste se met à jouer la chanson et aucun doute n’est plus permis, leur choix est fait.
Une scène culte
La scène où de Funès grimpe sur les épaules de Bourvil est en réalité une improvisation de Louis de Funès. Celui-ci était censé tomber sur Bourvil qui tenait en laisse des bergers allemands. Gérard Oury, admiratif, en fait l’affiche du film.
Un grand chef d'orchestre
Autre secret, dans la scène où de Funès joue le rôle d’un chef d’orchestre, il dirige réellement les musiciens. En effet, ayant été lui-même pianiste de bar, il avait les notions nécessaires pour diriger. Il lui aura quand même fallu 3 mois pour apprendre les gestes à la perfection en répétant devant son miroir.
L'autorisation d’atterrissage
Pour la scène où Alan MacIntosh, le soldat anglais, atterrit sur le toit de l’Opéra Garnier, le réalisateur avait dû présenter le scénario au ministre de la culture, André Malraux. Celui-ci l’autorisa ainsi à tourner sur le toit de l’Opéra.
La folie des grandeurs
La scène de l’auberge à Meursault était au début prévue avec des lits jumeaux, mais Louis de Funès réussit à convaincre le réalisateur d’utiliser un grand lit dans chaque chambre pour rendre la scène encore plus drôle.
La course poursuite
La scène finale devait être une course poursuite en ski et luge tournée dans la région de Chamonix. Malheureusement, elle était trop difficile à filmer et présentait un risque pour de Funès et Bourvil. Il a donc été décidé de la faire en planeurs.
William RIOU,
Malo LE MOINE FONTAINE,
et Louenn BRY JORQUERA
El Día de los Muertos, une fête à découvrir
Cette fête, classée au Patrimoine de l’Unesco, est très différente des traditions européennes.
Une histoire atypique
Cette fête traditionnelle a vu le jour il y a environ 3000 ans, grâce aux populations aztèques qui célébraient leurs morts deux fois par an. Au XVIème siècle, les dates de la fête ont changé. En effet, l’influence chrétienne a permis l’ancrage de la date au 2 novembre. Ce mélange entre les traditions latino-américaines et celles liées à la religion occidentale, a donné cette fête que nous connaissons aujourd’hui.
"Le jour des morts"
Au Mexique, on célèbre les défunts autrement qu'en Europe. En effet, les Mexicains leur rendent hommage avec joie, pensant que ce jour-là, l’âme des disparus rend visite à sa famille. Pour l’occasion les rues sont décorées, des défilés en musique ont lieu. Les habitants sont vêtus de manière colorée et se griment en squelette. On décore les maisons avec de nombreuses bougies, mais aussi avec « el papel picado » qui est une décoration faite de papier coloré et découpé afin de faire apparaître des dessins typiquement mexicains. Les fleurs de « zempaxúchitl » de couleur orange créent un chemin partant du cimetière afin de guider les défunts jusqu’à l’autel qui se situe dans la résidence familiale. Celui-ci est préparé avec soin par les familles qui le décorent avec des photos des morts. Il est fondamental pour cette fête, car c’est ici que les défunts viennent chercher les offrandes déposées par leur famille. Celles-ci sont multiples : pain des morts originaire du Mexique, « calaveritas » en sucre ou chocolat, boissons... Des objets personnels y sont aussi déposés.
Source de légendes
"La Llorona" ("la Pleureuse") est une chanson traditionnelle mexicaine très connue en Amérique latine, mais surtout au Mexique puisqu’elle est écoutée lors du Día de los Muertos. Ecrite entre la fin du XIXeme siècle et le début du XXeme,on ignore l’identité de son auteur. Ce dernier s’est inspiré de la légende de La Llorona où l’on raconte l’histoire d’une mère accablée par la perte de ses enfants qui irait les pleurer près d’un fleuve afin de les retrouver. Elle a été interprétée par de nombreux artistes, notamment : Chavela Vargas, Angela Aguilar, Carmen Goett...On la retrouve aussi dans le film des studios Disney Coco, inspiré par cette fête.
Gaidig LE HIR
et Lisanna GOARIN
"Just Do Paint" colore Saint-Brieuc
Impossible de passer à côté de ce festival de street art car, depuis quelques années, il orne les façades des maisons et immeubles.
Basé à Saint-Brieuc, en Bretagne, l’association ’’Event Maker’z’’ (EMZ) composée de bénévoles et de professionnels, organise le festival ’’Just Do Paint’’ sur la base de la création de graffitis en direct, afin d’animer la ville et ses alentours tout en réduisant l’impact environnemental.
L'objectif est avant tout de démocratiser l'accès à l'art et à la culture. Il s'agit d'un festival gratuit et l'édition 2022 se déroulera du 30 juin au 3 juillet pour son 5ème anniversaire.
Focus sur certains graffitis engagés...
Actuellement l'association présente 58 œuvres visibles dans toute la ville, dont quelques-unes engagées ! En effet certaines créations de 2021 m'ont paru mettre en relief un certain nombre de convictions fortes, présentes dans ces peintures.
Dans For(r)est, par exemple, le graffiti d'Aero, la nature est symbolisée par les arbres et le cerf. Ceux-ci sont dissimulés par une femme au premier plan qui serait Hazel Graye une mannequin assez connue à travers les réseaux et les pubs qu'elle est amenée à faire.
Dans Le Vent l’emportera, une création de Graffmatt : la femme et l’hirondelle de mer tendent vers deux directions différentes et peuvent laisser penser que la femme ignore la sterne* même si elles semblent en harmonie et en équilibre l’une par rapport à l’autre.
Ici, ces peintures mettent en valeur des constats comme la protection ou l'ignorance de la nature, l'éloignement de la mer... Parfois le simple nom de l'œuvre peut en dire beaucoup sur l'objectif du graffiti.
*hirondelle de mer
Un parcours de fresque en fresque dans la ville
Ces causes, suggérées à travers ces fresques gigantesques, mettent en valeur une réflexion plus profonde auprès des passants, laissant libre cours à leurs interprétations.
Ces problématiques ont pour but de dénoncer, voire de choquer, en cassant les codes de l'art d'aujourd'hui.
Ces peintures embellissent le paysage urbain à travers un parcours bien défini qui laisse transparaître également un certain engagement auprès des habitants de la région briochine pour de longues années.
www.just-do-paint.com
Laura GUERLESQUIN