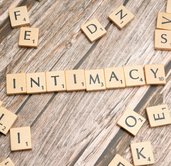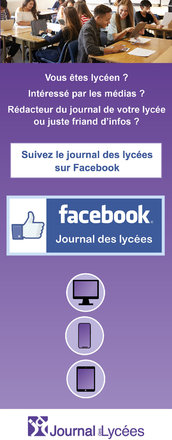Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Un patriarcat revendiqué qui conduit à la violence
page 5
Pour la deuxième année consécutive, le Haut Conseil à l'égalité pointe, dans son baromètre annuel sur le sexisme en France, l'adhésion d'une minorité grandissante de jeunes hommes aux idées masculinistes.

| N° 32 - Juin 2025 | www.lycee-notredame.fr |
Une politique migratoire ultra-restrictive de retour aux États-Unis
Revenu à la Maison Blanche, Donald Trump se lance dans une politique migratoire très stricte, provoquant des réactions multiples.
Déjà remarquable lors de son premier mandat, la politique d’immigration amorcée par Trump s’est durcie, en renforçant les contrôles des flux migratoires.
L’une des premières décisions de son nouveau mandat a été le retour, à la frontière sud, des contrôles multipliés et des expulsions grandissantes. Le retour de cette politique est également caractérisé par la reprise de la construction de la barrière à la frontière avec le Mexique.
L’une des mesures les plus controversées est la suppression du Dream Act, un texte qui permettait de protéger les jeunes migrants arrivés illégalement lorsqu’ils étaient encore enfants. Beaucoup d’entre eux se retrouvent menacés d’expulsion malgré leur participation active dans la société américaine.
Un impact direct sur les immigrés
Ces actions entreprises par le Président ont des répercussions immédiates sur les communautés immigrées, notamment pour les familles à la frontière ou encore les migrants en situation irrégulière. A l’heure actuelle, il n’existe pas de chiffres précis officiels sur les immigrants qui ont été renvoyés dans leur pays d’origine mais plusieurs associations de défense des droits humains dénoncent cependant la croissance des expulsions rapides qui réduisent les chances pour les migrants de recourir légalement à des demandes.
Des avis qui divergent
Cette politique migratoire suscite de vives réactions sur le plan national mais aussi sur la scène internationale. Aux Etats-Unis, les partisans de Trump sont fiers, satisfaits, de retrouver un politique ferme tandis que plusieurs Etats démocrates contestent clairement ces mesures en recourant juridiquement. A l’international, les relations entre les Etats-Unis et les pays d’Amérique latine sont mises sous tensions de par le durcissement des contrôles frontaliers et le retour des expulsions massives.
À l'avenir
De nos jours, les flux migratoires sont la cause de crises qu'elles soient économiques, climatiques ou politiques, la question de l’immigration reste de fait un enjeu majeur pour le gouvernement de Trump qui va devoir faire des compromis pour respecter les droits humains tout en conciliant sécurité nationale.
Cléa Mellerin. T5
Une génération en quête de sens : le retour surprenant de la religion
La mort du pape François marque un tournant pour l’Église catholique. Plutôt étonnamment, de nombreux jeunes lui rendent hommage, notamment sur les réseaux sociaux. Un élan, symbole du retour de la religion dans ces nouvelles générations.
La France a connu une forte sécularisation depuis le XXe siècle, comptant désormais plus d'athées que de personnes croyantes.
Chez les jeunes, la religion est fréquemment considérée comme obsolète, ce qui amplifie leur désengagement, un sentiment intensifié par les controverses affectant certaines entités religieuses.
Des statistiques en nette augmentation
En 2025, les baptêmes, chez les 18-25 ans, bondissent de 45 %. Ils dépassent ceux des 26-40 ans
Cette évolution touche autant les milieux populaires que les étudiants,ainsi que ceux sans traditions religieuses. Selon la Conférence des évêques de France, ce retour vers la foi s’explique par un besoin de repères, d’espérance et d’appartenance à une communauté.
La religion comme réponse à une quête de sens
Dans un monde considéré comme incertain, la religion refait surface comme une référence pour une partie de la jeunesse. Elle offre un cadre précis, des valeurs fondamentales et une certaine stabilité en réponse aux changements sociétaux. Pour ces jeunes, la foi devient une recherche individuelle de sens et de stabilité dans un contexte en constante évolution.
Jules Sorhouet. T3
La robotisation des emplois : entre progrès technologiques et dangers invisibles
La robotisation des emplois façonne l'avenir du travail, promettant de redéfinir les secteurs clés tout en soulevant des interrogations sur son impact à long terme.
Les années 1970-1980 marquent les premières grandes étapes de la robotisation des emplois, principalement dans le secteur automobile, grâce notamment à l’arrivée des premiers robots industriels programmables. La seconde grande vague de robotisation est survenue entre les années 2010 et 2020, avec la démocratisation du numérique et de l’intelligence artificielle.
L'humain et l'économie
Comme toute innovation, il existe des aspects positifs et négatifs : de nombreux métiers disparaissent au profit de machines plus performantes et productives que l’homme (ouvriers d’usines, caissiers…). Certains craignent même une forme de déshumanisation de la société, où les machines remplaceraient non seulement le travail humain, mais aussi la relation humaine à l’exemple des caisses automatiques ou des restaurants où les robots prennent la place des serveurs.
À l’inverse, pour les entreprises, ces robots représentent un gain économique, car en remplaçant l’humain, elles réduisent leurs charges patronales et leurs coûts salariaux.
Une population obsolète ?
Aujourd’hui, le problème de la robotisation des emplois reste un sujet difficile à traiter, car nous manquons encore de recul pour en tirer une conclusion claire. Néanmoins, ce qui est certain, c’est que si le développement de l’IA continue à ce rythme, cela bouleversera dans les années à venir de nombreux domaines, comme on peut déjà le constater avec l’art, l’éducation, les transports…
En France, une majorité de la population exprime des craintes quant aux conséquences de l’IA sur l’emploi. L'intelligence artificielle va-t-elle devenir le cœur de notre économie, ou nous poussera-t-elle à repenser complètement le travail tel que nous le connaissions ? Le futur des emplois est-il déjà écrit, ou avons-nous encore un rôle à jouer dans cette transformation ?
Mathis Giffard. T3
Les robots au Japon : pas sans l'humain
L'intégration des robots dans la société japonaise soulève des questions profondes sur la place de l'humain face à la technologie.
Dans un contexte socio-économique marqué par le vieillissement de la population, la pénurie de main-d’œuvre et la quête d'efficacité industrielle, le Japon investit dans des robots de plus en plus sophistiqués tant dans l'industrie que dans la vie quotidienne.
Une main d’œuvre active
Les robots au Japon jouent un rôle clef pour compenser le manque de travailleurs humains. Dans l'industrie, ils augmentent la productivité, réduisent les coûts et garantissent une précision essentielle pour des produits de haute qualité.
Dans les services à la personne, les robots assistent les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes en offrant mobilité, aide à domicile et compagnie, ce qui soulage les familles et améliore la qualité de vie des séniors.
Économie et empathie
Malgré les avantages indéniables liés à l'utilisation des robots, leur développement au Japon suscite des inquiétudes. Économiquement, l'automatisation entraîne des pertes d'emploi, particulièrement dans les secteurs peu qualifiés. Ce qui ne manque pas d'exacerber les inégalités notamment pour les jeunes générations.
Socialement, même si les robots assistent les personnes âgées, ils ne remplacent ni les interactions humaines, ni l'empathie, ce qui soulève des craintes d'isolement et de déshumanisation des soins.
L'humain face à la machine
Des philosophes, comme Martin Heidegger, ont averti que la machine pourrait réduire l'homme à une simple "ressource", déshumanisant les relations sociales en les transformant en interactions utilitaires. Questionnant la frontière entre le naturel et l'artificiel ainsi que notre désir de dépasser les limites humaines, les robots ouvrent un débat mondial sur l'avenir de l'humanité. Le Japon, leader en robotique, se trouve à l'avant-garde de ce débat.
Tom Gouard. T3
Thomas Deriano. T3
Harcèlement scolaire et numérique : ce que dit la loi en 2025
En 2025, la législation française s'est durcie face au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement, reflétant l’ampleur de ces violences, souvent invisibles mais profondément destructrices.
Depuis la loi de mars 2022, le harcèlement scolaire est un délit à part entière, passible de peines de prison et d’amendes. En 2025, ce cadre a été renforcé pouvant aller de 3 ans de prison et 45 000 € d’amendes à 10 ans et 150 000 € en cas de suicide. Les établissements scolaires ont l’obligation de prévenir, détecter et agir, avec des protocoles clairs et la désignation d’un référent harcèlement, censé être à l’affût de chaque comportement étrange.
Cyberharcèlement : un fléau numérique encadré
Avec la montée des réseaux sociaux, le harcèlement en ligne est devenu une priorité législative. La loi n° 2024-449 impose désormais : une responsabilité accrue des plateformes, des outils de signalement accessibles dans chaque établissement scolaire et des actions judiciaires facilitées afin d'aider les victimes. Les peines étant similaires à celles du harcèlement scolaire.
Quels recours pour les victimes ?
De nombreux numéros ont été mis en place par l’état afin d’aider à libérer la parole : 3020 et 3018. Reconnaître les différents types harcèlements comme des délits aide aussi à libérer la parole. La sensibilisation joue aussi un rôle clé si elle est effectuée tôt et régulièrement durant la scolarité. Un comportement peut en cacher un autre, chaque individu doit être vigilant afin de pouvoir aider les victimes le plus rapidement possible. Les victimes ne doivent pas oublier qu’elles seront écoutées.Jules Sorhouet. T3
Nouvelle réforme : l'éducation sexuelle
À la rentrée 2025, tous les niveaux, de la maternelle au lycée suivront des cours d'éducation sexuelle.
En septembre 2025, dès la maternelle, les élèves assisteront obligatoirement à trois séances de deux heures d'éducation sexuelle par an.
Pour le 1er degré d'apprentissage (maternelle et élémentaire), l’éducation à la vie affective et relationnelle se développe à partir de la considération du corps, des sentiments et des émotions, du respect de l’intimité et de l’égalité entre les filles et les garçons.
L’ensemble des activités et des apprentissages inscrits dans le programme permet aux élèves de découvrir les conditions élémentaires du respect de soi et des autres.
A partir de situations de la vie quotidienne, les séances pour le cycle 1 viseront à faire intégrer une première approche du consentement avec des questions ressemblant à "est-ce que je peux m'assoir à côté de toi ?". Ainsi, la sexualité en elle-même ne sera abordée qu'à partir du collège.
De plus, une attention soutenue est donnée au repérage d’enfants en danger, et plus largement à la protection de l’enfance. La co-animation par des personnels de santé et sociaux est à privilégier pour ces séances. Tous, y compris les enseignants, auront reçu une formation.
Comment est reçue cette initiative ?
Par les parents : Une mère de deux adolescents :"Tant que les propos sont adaptés à chacun, je n'y vois aucun inconvénient". Un père de trois enfants ajoute que cela permettrait peut-être de réduire les drames et faits divers qu'on entend dans les médias. En effet, plus les enfants ont conscience des limites et de leurs intimités, plus ils véhiculeront ces valeurs autour d'eux"."Ce n'est pas forcément facile d'en parler à la maison et le fait d'en parler à l'école, ça libère la parole" pense une mère de deux enfants en bas âges.
Par des enseignants : Une directrice d'école assure que l'âge où le sexe peut être abordé n'est surtout pas en maternelle ou primaire. Elle ajoute que discuter de la diversité des familles, des couples est une excellente idée mais elle se questionne cependant sur les interrogations que les enfants vont avoir à propos de l'homosexualité. Répondre aux questions sur la reproduction par exemple en adaptant à leur maturité peut se révéler comme un challenge.
Par des enfants :"Moi je pense que ça peut m’aider à mieux comprendre les autres et moi-même" pense un collégien en classe de 6ème.
De mes interviews, je conclus que cette réforme est absolument la bienvenue. Nombreux sont ceux qui ont de grandes espérances à progressivement éduquer les nouvelles générations et à ainsi réduire les drames liés à toutes sortes de violence.
Mathilde Huet. T2
Le masculinisme sur les réseaux sociaux, un danger pour l'éducation des garçons ?
Ce mouvement masculin diffuse des contenus sexistes et anti-femmes sur internet.
Pilule rouge ou pilule bleue ? Un concept tout droit tiré du film Matrix. Un choix s’impose aux hommes, "bluepill" : rester opprimé par la société et les femmes, ou "redpill" : considérer les femmes comme elles sont, c’est-à-dire d’après les masculinistes : "vilaines". Le décor est posé.
Cette approche simpliste est une des manières d’aborder facilement le mouvement qui s’apparente comme opposé à celui du féminisme.
Antiféminisme
Sur les réseaux sociaux, ce type de contenu est accessible à tous et surtout aux jeunes, les garçons étant souvent visés. L’idée d’être fort, courageux, de ne pas pleurer, vient souvent titiller nos oreilles dans les cours de récré, en primaire et au collège. Ces "valeurs" sont reprises par les masculinistes, de façon extrême, avec un élément supplémentaire : avoir le dessus sur les femmes.
Ils déclarent que la femme ne « doit pas prendre plus de place que l'homme », doit « répondre aux besoins de l’homme », et autres propos misogynes. L'idéal patriarcal, selon lequel l'homme est supérieur à la femme et que celle-ci doit s'adapter pour asservir leurs envies, est presque devenu la devise des masculinistes.
Leurs propos prônent souvent les agressions sexuelles, le viol, voire le féminicide. Des hommes en quête d'un retour dans le passé où les femmes sont soumises et les hommes sur un piédestal.
Un réel impact sur les jeunes
Énormément d'autres faits énoncés ne sont ni scientifiques, ni prouvés. Néanmoins, un jeune public non-averti peut prendre ces paroles pour acquises et véridiques, tandis qu’elles ne sont absolument pas vérifiées. Cela revient à dire qu’ils diffusent de probables « fake news ».
Au-delà de cela, de jeunes garçons à peine arrivés à l'éveil de leur développement social et personnel, peuvent avoir tendance à boire les paroles de ces hommes confiants, à la carrure imposante. Le problème est là. Ces propos souvent violents vont avoir un impact sur les relations amoureuses et amicales de ces garçons juvéniles. C'est pourquoi il est nécessaire d'encadrer et d'accompagner les jeunes, filles ou garçons, sur tous les contenus à leur portée sur internet.
Madeleine Guettman. T1
Crues et inondations : quelle est l'origine ?
Changement climatique, politique agricole, urbanisation,... qui est responsable ?
Des inondations de plus en plus nombreuses
Depuis quelques années, le nombre de crues et d'inondations en France, est de plus en plus hors norme, notamment en Ille-et-Vilaine. A Rennes, tous les records de pluviométrie ont été battus avec 200 mm de pluie rien que pour le mois de janvier 2025. Mais le changement climatique et ses pluies toujours plus intenses ne sont pas les seuls responsables.
Qui sont les autres responsables ?
Si les crues se limitaient aux campagnes et aux zones inondables, les dommages seraient moindres. Mais, actuellement, les villages et les villes sont aussi fortement touchés. L'une des principales raisons est l'imperméabilisation des sols par les constructions de bâtiments, d’habitats, de routes et de parcs de stationnement. L'eau bloquée en surface ne peut plus être absorbée par le sol. Elle commence donc par s'écouler dans les canalisations qui finissent par déborder devant l'afflux d'eau. Une autre raison est la construction dans des zones inondables. Depuis le milieu du siècle dernier, les constructions se sont multipliées dans des zones jusqu'alors non constructibles concomitamment à l'étalement des villes.
Le remembrement, qu'est-ce que c'est ?
Selon Léandre Mandard, doctorant en histoire qui travaille sur le remembrement en Bretagne, il s'agit d' « une grande politique agricole d’aménagement qui consistait [dans les années 1950-60] à agrandir les champs pour les adapter aux tracteurs ». Cela a été permis par le regroupement des petites parcelles et, dans les régions de bocages comme la Bretagne, par la suppression des arbres et des talus. Le remembrement est également synonyme de "déméandrisation" de rivière et du drainage des zones humides pour les cultiver.
Comment le remembrement peut-il être responsable ?
Moins retenue par la végétation du bocage, l’eau s’écoule directement dans le fossé puis dans le cours d'eau en aval, augmentant les risques de crues.
Le risque de crues n'est pas le seul inconvénient du remembrement et des fortes pluies. Cet écoulement d'eau massif lessive les sols, ce qui veut dire que tous les minéraux essentiels à la croissance des plantes s'en vont avec l'eau.
Éléonore Pineau. T3
Les jeunes et la politique : pourquoi s'y intéresser ?
La politique influence notre vie de tous les jours : l'école, le travail, l'environnement, les droits… Pourtant, beaucoup de jeunes ne s'y intéressent pas, souvent par manque de confiance ou parce qu'ils pensent que cela ne changera rien.
S'intéresser à la polique c'est...
Comprendre notre rôle dans la société. Chaque individu y joue un rôle. S'engager en politique, ce n'est pas juste voter, c'est aussi informer, discuter, défendre ses idées et agir pour faire bouger les choses. Les jeunes ont le pouvoir de changer la société. En s'impliquant dans une cause qui leur tient à cœur.
Lorsque vous vous engagez et que vous comprenez votre rôle, vous pouvez infuencer des décisions en faisant entendre votre voix.
S'intéresser à la polique c'est...
Lutter contre les inégalités sociales et économiques. Vous pouvez rendre la société plus inclusive et juste pour tous en vous impliquant dans des domaines tels que la justice sociale ou les droits civiques.
S'intéresser à la politique c'est préparer l'avenir et faire entendre sa voix. Chaque action compte !
Sarah Gicquel. BTS UCG1
MMA : de l'ombre à la lumière des projecteurs !
Le MMA (Mixed Martial Arts) est devenu en l'espace de quelques années l'un des sports de combat les plus populaires.
Un sport longtemps interdit... Jusqu’en 2020, la France faisait figure d’exception en Europe en interdisant la pratique du MMA en compétition. Jugé trop violent et mal structuré, ce sport souffrait d’une image négative, alimentée par des préjugés et une méconnaissance de ses règles strictes. Les athlètes français étaient alors contraints de s’exiler pour combattre, notamment aux États-Unis ou en Angleterre, où l’UFC (Ultimate Fighting Championship) domine la scène mondiale.
Depuis sa légalisation en 2020, le MMA connaît un essor fulgurant en France.
Un impact sur la culture sportive
Le MMA bouscule les codes des sports de combat en France. Alors que la boxe anglaise et le judo dominaient historiquement, le MMA impose un style plus complet et spectaculaire. Les réseaux sociaux jouent un rôle clef dans cette popularité croissante, offrant une visibilité accrue aux combattants et aux événements majeurs.
Les grandes salles parisiennes accueillent désormais des événements de MMA, attirant des milliers de spectateurs. L’Accor Arena, par exemple, a été le théâtre de plusieurs événements UFC, générant des recettes records, dont 3,4 millions d’euros en billetterie lors d’une seule soirée.
Pourquoi le MMA est-il devenu plus populaire que la boxe aujourd’hui ?
Le MMA s’est imposé comme le sport de combat dominant ces dernières années, surpassant la boxe en popularité.
Contrairement à cette dernière, qui se limite aux coups de poing, le MMA offre une palette technique bien plus large : projections, combats au sol, techniques de soumission. Cette diversité rend les affrontements plus dynamiques, imprévisibles et captivants pour le public.
De plus, le MMA bénéficie d’une stratégie marketing efficace. L’UFC, principale organisation mondiale, a révolutionné la promotion du sport en mettant en avant des combattants au charisme unique et en organisant des événements spectaculaires.
Grâce à une communication maîtrisée et une médiatisation efficace, le MMA a su aussi capter l’attention d’un public jeune et connecté.
Un avenir prometteur
Aujourd’hui, le MMA en France est en plein essor, avec un nombre croissant de licenciés et une structuration qui s’affine d’année en année. L’émergence de nouvelles compétitions nationales et internationales sur le sol français promet de renforcer encore davantage la visibilité du sport.
L’ascension fulgurante du MMA témoigne d’un changement profond de perception et d’un engouement qui ne semble pas près de s’arrêter.
De discipline marginale et controversée, le MMA est devenu un sport légitime et populaire en France, ouvrant la voie à de nouveaux talents et à un avenir radieux pour les amateurs de combat.
Hugo Baumgartner. BTS UCG1

Une société où la violence est en hausse
Comprendre et agir face à une société sous tension. Chacun peut agir !
L’insécurité progresse en France, et les chiffres sont alarmants. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur, les agressions physiques ont augmenté de 12 % par rapport à 2024, tandis que les violences conjugales connaissent une hausse de 15 %. Les féminicides, en particulier, restent un sujet de préoccupation majeure : au moins 120 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, un chiffre en hausse.
Les chiffres de la violence explosent en 2025
Dans les écoles, la situation est tout aussi préoccupante. Le harcèlement scolaire touche désormais un élève sur quatre, et le cyberharcèlement explose avec l’utilisation massive des réseaux sociaux. Face à ce phénomène, enseignants et parents tirent la sonnette d’alarme.
Des causes profondes et multiples
Plusieurs facteurs entrent en jeu. D’abord, la précarité économique avec une inflation persistante et des inégalités sociales qui se creusent, les tensions s’exacerbent dans de nombreux foyers. « Nous voyons de plus en plus de situations où la détresse économique engendre des conflits familiaux violents », explique une travailleuse sociale interrogée à Paris.
Les réseaux sociaux jouent également un rôle clef. La banalisation des contenus violents et la facilité avec laquelle ils circulent favorisent un climat d’agressivité et d’intimidation, notamment chez les jeunes. Les plateformes peinent encore à réguler ces comportements.
Enfin, les confinements successifs ont isolé de nombreuses victimes de violences domestiques, et les conséquences se font encore sentir. « Nous avons assisté à une explosion des signalements post-COVID, et la tendance ne faiblit pas », déplore une responsable d’une association d’aide aux victimes.
Quelles solutions face à l’urgence ?
Des mesures ont été mises en place. En première ligne, les associations redoublent d’efforts pour aider les victimes. Le numéro 3919, destiné aux femmes victimes de violences, est désormais accessible 24h/24 et 7j/7, tandis que de nouveaux dispositifs permettent de signaler les violences en ligne, de manière anonyme.
Du côté des pouvoirs publics, les ordonnances de protection sont délivrées plus rapidement et les récidivistes sont davantage surveillés.« Nous devons aller plus loin en renforçant l’accompagnement psychologique des victimes et en sensibilisant dès le plus jeune âge », plaide une députée engagée dans la lutte contre les violences conjugales.
Dans les écoles, des programmes anti-harcèlement ont été renforcés, avec des cours obligatoires sur la gestion des conflits et le respect des autres.
Réduire les violences ne repose pas uniquement sur l’État et les institutions. Chacun peut agir, en signalant les situations inquiétantes, en aidant les victimes à briser le silence, et en refusant toute forme de banalisation de la violence.
Yasmine LAGAB. BTS UCG1
La voiture autonome : vers un futur sans conducteur
Disponible, pour une minorité d'entre nous car son prix est exorbitant, peut-on confier sa conduite à l'IA ?
Capable de rouler sur la voie publique sans intervention humaine grâce à un système de pilotage automatisé, la voiture autonome est issue du mariage des innovations de la robotique et du monde de l'automobile qui représente la mobilité du futur.
L'IA en action
Ce type de véhicule intègre un programme d'IA qui réalise les manœuvres à l'aide de servocommandes : démarrer, rouler, freiner, tourner... Des capteurs laser, des caméras et des radars interprètent le trafic et modélisent la route.
Sécurité et fiabilité
On compterait moins d'accidents liés aux erreurs humaines ainsi qu'une réduction de la pollution.
Avec un champ de vision de 360° et une rapidité d'exécution de 750 Mo de données traitées par seconde à n'importe quelle vitesse, la voiture autonome permettrait d'éviter tous types d'incidents liés aux déplacements imprévisibles des autres véhicules.
La législation ne permet pas, à l'heure actuelle, la circulation de ce type de véhicule dans tous les États. Confier sa conduite à une IA peut sembler prometteur en terme de sécurité et d'efficacité, cependant ces véhicules peuvent subir des cyberattaques, alors restons vigilants.
Amandine Tual. T3
Kim Legrand. T3
Le télétravail a t-il changé définitivement notre rapport au travail ?
Avec la crise sanitaire du Covid-19, le télétravail s'est de plus en plus développé dans les entreprises.
Les pratiques du télétravail varient selon les entreprises avec pour certaines un modèle 100 % à distance, et pour d'autres seulement la moitié en présentiel ou distanciel, donc des jours au bureau et d'autres à domicile. Le télétravail peut aussi être flexible, permettant aux salariés de choisir leurs horaires selon leurs besoins.
Une meilleure gestion au quotidien
Les avantages attendus pour les salariés avec le télétravail sont une meilleure gestion du quotidien, pas de perte de temps dans les transports ; flexibilité des horaires, une plus grande autonomie dans la gestion des tâches ; une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
Cependant, le télétravail peut aussi comporter certains inconvénients comme l'isolement social. Les télétravailleurs échangent et communiquent moins avec leurs collègues ou leurs supérieurs que les travailleurs "en présentiel". Cela contribue à leur démotivation et certains ont du mal à dissocier vie professionnelle et vie privée.
De nouvelles stratégies de recrutement
Le télétravail impacte également les stratégies de recrutement des entreprises. Comme le mentionne My RH, cette nouvelle organisation permet aux employeurs de recruter des personnes, peu importe où elles se trouvent. Les jeunes générations, en quête de plus de flexibilité, sont particulièrement attirées par cette option. Les recruteurs doivent donc adapter leurs méthodes de gestion et de communication pour travailler efficacement à distance.
Axel Riault. BTS UCG1
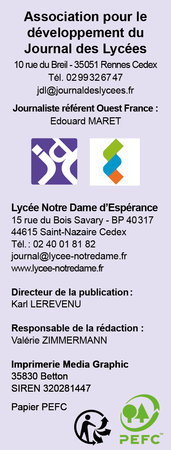
L'évolution des droits de douanes aux USA en 2025
Les droits de douanes sont des impôts qui touchent une marchandise à son entrée sur un territoire et leur pourcentage dépend du pays.
Depuis l'élection de Donald Trump en 2024, les droits de douane augmentent.
L'origine de l'augmentation
Le 5 novembre 2024, Donald Trump a été élu Président des États-Unis d’Amérique. Suite à cette élection, il a comme prévu appliqué son programme en augmentant les droits de douane sur les marchandises importées. Cela a pour objectif de freiner l'entrée des produits étrangers au sein des États-Unis et par la même occasion d'augmenter la productivité des industries américaines pour que le pays ne dépende plus que de lui-même économiquement. Cette indépendance industrielle permettra, en cas de crise économique dans un autre pays, que les États-Unis ne soient pas impactés.
La taxe sur le vin
Le 13 mars 2025, Donald Trump a menacé d'imposer de 200 % la taxe sur les vins et champagnes français. Cela signifie que les citoyens américains qui désirent consommer du vin venant de France doivent dorénavant payer le vin à un prix très élevé.
L'impact est considérable pour nous, dans la mesure où les consommateurs américains risquent de se détourner du vin français, ce qui va forcément ralentir les exportations françaises d'autant plus que c'est notre exportateur principal. Le vin français devient alors un produit de luxe réservé à une classe d’élite qui pourra se permettre de payer le prix fort, cependant cela ne compensera pas. La France ne sera pas la seule perdante sur ces taxes.
La taxe sur les produits agricoles
Le 3 mars 2025, Donald Trump communique également, via les réseaux sociaux, son envie de taxer les produits agricoles qui viendraient de l'étranger et notamment de toute l'Europe. Cette taxe s'élèverait à 25 % et est prévue pour le 2 avril 2025. Les conséquences pourraient être une baisse d'exportation des produits agricoles vers les États-Unis car ils sont trop chers. Et avec cette baisse d'exportation, les États-Unis envisagent donc de produire plus de produits agricoles, ce qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais on comprend l'objectif principal de l'augmentation de ces droits de douane : il est bien d'augmenter son budget économique.
Sacha Menard. BTS UCG1