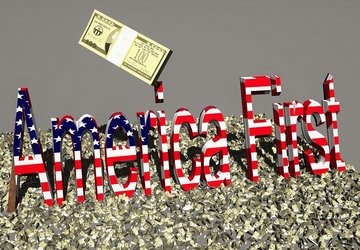Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
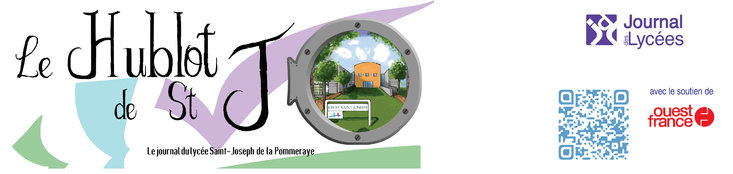
| N° 3 - Juin 2022 - N° spécial 1ères HGGSP | www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr |
Sommaire :
Vous pourrez notamment lire dans ce numéro :
- Page 2 : Les formes et les lieux de la puissance.
- Page 4 : Un colosse aux pieds d'argile ?
- Page 4 : Unilatéralisme ou multilatéralisme ?
- Page 7 ; Une influence planétaire.
Bonne lecture !
Edito
Depuis plus d'un siècle, la puissance américaine est écrasante, à la fois militaire, politique, économique et culturelle. Si aujourd’hui l’expression d’hyperpuissance n’est plus utilisée, il n’en reste pas moins que les États-Unis occupent une place de premier plan dans le concert des nations mondiales.
Mais depuis la crise de 2008, et après quatre années tourmentées de présidence Trump, la puissance américaine paraît de plus en plus émoussée et contestée. Plusieurs pays remettent en cause aujourd’hui l’hégémonie américaine et les États-Unis tentent de conserver leur position face à l’émergence de nouveaux acteurs, dans un monde toujours plus multipolaire.
Quelles sont les manifestations actuelles et les limites de la première puissance mondiale ? Voici les questions auxquelles ce numéro spécial tente de répondre.
Il a été réalisé par les élèves de 1ères HGGSP dont (dans l’ordre des articles) : Ameline Blond, Angélique Romignac, Nathan Lucas, Coline Monnier, Daniela Alvarez-Piragua, Oriane Lepage, Mathis Bernier, Maxime Porrot, Eliot Laurent, Louison Retailleau, Emma Petit, Charly Boré, Lenny Pilet, Noémie Guechaichia, Jeanne Bondu, Ethan Manceau, Antoine Cosneau, Margot Bellanger, Manon Moreau, Maxence Lembaye, Camélie Papin, Mathilde Leduc et Maxence Jarry. Nous les félicitons pour le sérieux du travail réalisé.
Washington, la ville capitale
Comment Washington incarne-t-elle la puissance des Etats-Unis ?
Tout d’abord,Washington est la capitale des Etats-Unis, coeur décisionnel de la puissance politique américaine avec trois pouvoirs réunis dans cette ville.
Cela prouve donc à quel point Washington a une grande puissance politique à travers la politique étasunienne. Washington a aussi une puissance militaire de grande renommée à travers les Etats-Unis avec le Pentagone qui est un grand bâtiment qui reste un symbole avec une grande institution qui est considérée telle une merveille d’ingénierie. Le Pentagone a une fonction de centre nerveux des forces armées du pays.Il accueille le ministère de la Défense, le bureau du ministre de la Défense, le chef d’état-major interarmées et les quartiers généraux des quatre armées. Il exerce donc un commandement mondial sur les forces armées du pays. Washington a un pouvoir militaire et donc une influence majeure. Mais c'est aussi le symbole du militarisme et de la violence et matérialise la force et l’autorité des Etats-Unis.
Washington est largement desservie grâce à des axes majeurs rendant la ville attractive pour les FTN et les universités ce qui nous démontre que Washington est une puissance commerciale, mais aussi intellectuelle. Avec des aéroports, une présence de biotechnologies et des technologies spatiales et militaires, Washington est une grande puissance technologique. Elle contient notamment 3 couloirs technologiques.Géant économique de rang mondial, Washington est un État présent et se développant dans de nombreux secteurs, comme l’agriculture, les industries de haute technologie, les industries culturelles, grâce à des investissements massifs dont une partie relève du capital-risque grâce à de grands systèmes de recherche.
Ville compacte de 700 000 habitants, à la densité élevée comparée à la moyenne américaine (4300 hb/km²), elle est le centre d’une aire métropolitaine de 6 millions d’habitants à l’extrémité sud de la Mégalopolis. C’est une métropole à la fonction politique hypertrophiée, qui incarne la puissance américaine.
Créée ex-nihilo au lendemain de la guerre d’indépendance, Washington est intimement liée à l’histoire des Etats-Unis et de la nation américaine. La capitale est le symbole de l’administration et d’un pouvoir fédéral qui s’affirme.
La Maison-blanche participe au rayonnement de la ville et des Etats-Unis, elle est le lieu le plus médiatisé des Etats-Unis, elle fait partie des lieux qui incarne la puissance américaine. La Maison-blanche est l’empreinte du pouvoir éxécutif et une médiatisation vectrice du soft power qui se définit par la capacité d’un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur.
Pour conclure Washington incarne la puissance étasunienne sur les plans politique, militaire, économique et technologique. Washington est avant tout la capitale des Etats-Unis et c’est ici que l’avenir du monde se joue par son influence sur le monde.
Nathan Lucas
“American Dream” : La puissance du rêve
Les EUA sont indiscutablement une puissance majeure dans tous les domaines.
Une puissance économique
Les Etats-Unis ont depuis longtemps assuré leur domination dans l’économie moderne. Ils accueillent à eux seuls trois des bourses les plus importantes au niveau mondial, ainsi que huit des dix entreprises mondiales. Certaines de ces entreprises se placent au sommet de la hiérarchie : les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Cette capacité économique leur permet de s’assurer une position privilégiée dans les transactions internationales, l’un des exemples flagrants de cette assurance est l’utilisation généralisée du dollar américain.
Une puissance territoriale
Les Etats Unis dominent le monde grâce à l'organisation stratégique des territoires. Le Nord-Est est le centre de la puissance, notamment grâce à la présence de la ville de Washington, capitale politique du pays. Le Sud est une zone attractive qui nourrit le dynamisme économique, grâce au tourisme. Les Grandes Plaines sont le cœur de la puissance agricole, avec des champs à perte de vue, des espaces vierges pouvant être exploités. . L’Ouest principalement touristique, accueille aussi des pôles importants, la Californie par exemple (voir article). Le pays a donc accès à une diversité de territoires importants, ce qui lui donne un équilibre entre agriculture et industrie, entre dynamisme innovateur et tourisme. Cette variété de territoires permet un mélange ethnique et culturel :la population est diverse et nombreuse.
Une puissance culturelleLes Etats-Unis ont une influence dans le monde.Les films sont à eux seuls des armes non négligeables pour une propagande culturelle de grande échelle. Les scripts sont lus et critiqués par les agences de la CIA et du FBI, afin d’éviter des propos négatifs sur l’armée américaine.
La culture américaine se traduit également par ses chaînes de fast-food, sa musique, son cinéma, et son mode de vie.
Les EUA ont une longueur d’avance importante en ce qui concerne la science. Les innovations américaines ont gagné 625 prix Nobels, soit 65 % des prix attribués au total. Les EUA détiennent cinq des six universités les plus importantes, la Ivy League, réputées pour produire des têtes de gouvernement ou des chefs de grandes entreprises.
Une puissance politique
Les Etats-Unis sont profondément impliqués dans les conflits mondiaux, et jouent souvent un rôle diplomatique important dans la résolution de ceux-ci. Ils sont membres d'organisations mondiales ce qui leur donne une place privilégiée dans les prises de décisions communes. Ils jouent aussi un rôle militaire dans le monde, notamment grâce aux opérations extérieures, en Irak ou en Syrie.
Bien que la puissance des Etats-Unis soit une notion indéniable aujourd’hui, son déclin commence déjà. D’autres pays lui font concurrence notamment d'un point de vue économique. La Chine (BATX) présente une économie grandissante et solide qui pourrait faire de l’ombre aux USA dans le futur.
A l'intérieur, la présidence de Trump a porté un coup dur à la démocratie et attisé les tensions au sein de la population.
Angélique Romignac
et Ameline Blond
La Californie. Puissance 8 !
Aujourd’hui, la Californie rivalise économiquement avec les plus grandes puissances.
Qu’est ce que la Californie ? La Californie est l’état le plus grand des États-Unis, le plus riche et le plus peuplé. Situé sur la façade pacifique, à l’ouest des États-Unis, cet Etat de 400 000 km², compte 39 millions d’habitants. Sa capitale administrative est Sacramento.
C’est une puissance à elle toute seule. Si c’était un état indépendant, ce serait la 8ème puissance mondiale. Son PIB (13 % de celui des EUA) équivaut à celui de la France. Elle incarne à elle seule le symbole du rêve américain par excellence. Lorsqu’on pense États-Unis, on pense immédiatement à la Californie, avec ses palmiers, sa grande plage de Santa Monica, Hollywood… Sa popularité et sa domination se traduisent dans de nombreux domaines.
Une localisation idéale
Sur le plan géographique, par sa côte pacifique, elle est tournée vers l’Asie et l’Amérique centrale. Elle peut donc étendre son influence sur ces régions du globe, en exportant plus facilement ses marchandises par exemple. Elle possède aussi les deux premiers ports américains pour le trafic de conteneurs, celui de Long Beach et de Los Angeles. Son climat méditerranéen est propice à l’agriculture puisqu’elle est le premier état agricole des États-Unis, les terres les plus fertiles se trouvent dans « The Central Valley ». La Californie fournit à elle seule 1/3 des légumes, 2/3 des fruits et 90 % de la production de vin pour tout le pays. Le climat et le paysage de la Californie ont favorisé le tourisme, grâce à ses stations balnéaires comme Santa Monica, ses parcs nationaux ou encore ses parcs d'attraction (ex : Universal Studio) ou encore ses grandes villes comme San Francisco. En 2014 la Californie fournissait 20 % du tourisme des EUA. La Californie est aussi connue sur le plan cinématographique, avec le quartier Hollywood de Los Angeles. Le cinéma s'est implanté la-bas grâce au climat propice aux tournages de divers films. On peut y retrouver les plus grandes compagnies du cinéma, comme Universal, Warner Bros pictures ou encore 20th Century Fox. De nombreuses entreprises mondialement connues se sont installées dans la Silicon Valley, près de San Francisco : Apple, Facebook, Twitter, Microscoft...A elle seule, la Silicon Valley crée plus d'un million et demi d'emplois. Cette culture touche tous les secteurs de l'innovation, des énergies renouvelables, de la biotechnologie...
Un Etat avant-gardiste
D'un point de vue plus social, la Californie est à l'origine de nombreux mouvements à portée mondiale, comme le mouvement « Beat Generation » créé en 1950 à North Beach, le mouvement "hippie" créé en 1960 à Haight Ashbary ou encore le mouvement "Black Panther" créé en 1968 à Oakland. Elel en garde encore une réputation avant-gardiste ( ex : la Californie était le deuxième état fédéral à légaliser le mariage homosexuel aux États-Unis). Cette réputation a donc attiré de nombreux migrants, étrangers à la recherche de ce rêve américain. Depuis le XIXe siècle, avec la ruée vers l'or, jusqu'en 1930, avec les fermiers d'Oklahoma qui ont migré vers la Californie à cause de la grande sécheresse, la Californie a largement augmenté son nombre d'habitants. Si on y rajoute la fin du quota d'immigration, plus l'arrivée de migrants d’Amérique latine, d’Asie, on peut donc considérer l'Etat Californien comme l'Etat le plus multiculturel des États-Unis. Cette arrivée de masse s'explique par différents facteurs, mais le plus connu est que les gens viennent chercher une vie qui leur offre un emploi et une vie agréable. C'est ce qui lui fait une réputation à l'échelle internationale, et c'est ce qui donne de l'estime aux États-Unis.
Grâce au dynamisme économique, la créativité, au multiculturalisme et à l'avant-gardisme dans les idées de la Californie, on peut donc considérer la Californie comme un symbole de la puissance étasunienne.
Lepage Oriane
New-York , une capitale mondiale
New-York incarne-t-elle l'image d'une ville modèle ?
New York , capitale économique , diplomatique et culturelle
L’île de Manhattan incarne le poids décisionnel qu’a la ville de New York . Véritable CBD (central business district) , elle est reconnaissable à sa Skyline où résident les sièges des plus grandes FTN mondiales comme Warner par exemple, des quartiers d’affaires qui restent mythiques comme Wall Street.
La ville de New York exerce une fonction diplomatique au rang international puisque y réside le siège des Nations-Unis où sont représentés plus de 193 Etats ainsi que l'UNICEF (organisation mondiale veillant à l'amélioration de la condition des enfants) des véritables icônes du soft power.
New York est également une référence culturelle. En effet, elle concentre de nombreux musées prestigieux : MoMa , Guggenheim… Elle exerce un rayonnement dans l’industrie du spectacle et est à l’origine de nombreux courants artistiques : comédies musicales à Broadway, hip hop, jazz, blues… Sans oublier qu’elle abrite des grands événements sportifs mondiaux comme le Marathon de New York .
La Silicon Alley, un territoire productif au cœur de l’innovation mondiale et un levier de la puissance étasunienne
New York est située dans le nord-est des États-Unis, le centre de pouvoir du pays. Elle possède un quartier appelé Silicon Alley (dérivé de la Silicon Valley en Californie ) qui a pour centre l'IBM (International Business Machines Corporation) et qui est entouré de multiples médias internationaux, de plus de 7500 entreprises et de l'une des universités les plus prestigieuses du monde, l'université Columbia.
Cette métropole mondiale, en plus d'avoir la bourse la plus importante du pays et l'une des plus importantes du monde, possède l'Ivy League, un groupe d'élite de huit universités, dont Yale, Columbia, Harvard et Brown, qui est la principale source de recherche et de développement.
La présence de ce cluster a permis d'augmenter le nombre d’emplois dans la haute technologie de 30 % et ce depuis 2008. Pour autant cette richesse est-elle réellement bien répartie ?
Des inégalités sociales croissantes
Cependant, l'attractivité de la ville provoque une hausse du coût de la vie et conduit à creuser les inégalités sociales qui touchent particulièrement les minorités ethniques, qui ont tendance à vivre dans une zone ou un quartier avec des personnes de même origine ou de même condition qui vivent isolées et marginalisées pour des raisons raciales ou culturelles (Chinatown, Lower East Side à Manhattan). Cela concerne 31 % des Afro-Américains et 33 % des Hispano-Américains de la population new-yorkaise.
La ville de New York concentre presque l'ensemble des fonctions urbaines dans les domaines économique, financier et culturel et jouit d'un rayonnement mondial. Elle est cependant confrontée à des problèmes tels que l'augmentation grandissante des inégalités sociales. Face à ces problèmes, la ville tend à mettre en place des aménagements durables comme le projet One NYC, le projet est prévu pour 2050 et est fondé sur les principes de croissance, d'équité, de durabilité et de résilience.
Coline Monnier
et Daniela Alvarez Piragua
« Un colosse aux pieds d’argile »
Considérés comme la 1ère puissance mondiale, les États-Unis possèdent de grandes qualités mais montre aujourd'hui certaines fragilités.
Les crises économiques
Les États-Unis ont connu 2 crises économiques importantes en 1929 et 2008. La crise des subprimes de 2008 a affaibli les classes moyennes mais aussi a touché fortement le Nord-Est du pays notamment Détroit, la capitale de l'automobile (Ford, General Motors). Cette ville a été très impactée par la crise comme en témoignent les lieux culturels à l'abandon aujourd'hui. La bourse de New-York qui est la plus importante au monde, a été vecteur de ces deux principales crises qui ont touché le monde entier.
Des infrastructures vieillissantesLa pauvreté des infrastructures aux États-Unis est un fléau. L'état général des infrastructures américaines s'est nettement dégradé ces 25 dernières années et se situe à un niveau très faible...avec notamment son 18ème rang mondial dans le domaine des lignes de chemins de fer, ainsi que son 19ème rang mondial dans le domaine des ports, sans oublier son 20ème rang mondial pour les routes.
De plus, le réseau ferroviaire à très grande vitesse est très en retard par rapport à ceux d’Europe et d’Asie. En 2012-2013, certains spécialistes considéraient que le sous-investissement dans ces infrastructures se traduirait, à l'avenir par un manque de compétitivité. Pour pouvoir être à la page face à ses concurrents, il faudrait alors un investissement de 3 600 milliards de dollars pour relever le défi que pose la vieillesse de ces infrastructures.
Un pays profondément divisé
Dans les années 1950-1960, ont lieu des mouvements de droits civiques aux États-Unis qui aboutissent à la fin de la ségrégation raciale . Afin de lutter contre le racisme, des membres de la communauté afro-américaine ont créé en 2013 le mouvement des "Black Lives Matter" que nous connaissons tous aujourd'hui suite à la mort de George Floyd, mort étouffé lors de son arrestation par la police en mai 2020 à Minneapolis. En réponse à cela des manifestations antiracistes ont eu lieu aux États-Unis, notamment à Charlottesville en Virginie.
Il est important de souligner également une fracture créée par l'ancien président Trump. Le 6 janvier 2021, des milliers de militants, incités par le président sortant, prennent d'assaut le Capitole américain pour tenter de bloquer la certification des résultats du Collège électoral des élections présidentielles américaines de 2020 et la victoire du président élu Joe Biden, alors que le 117e Congrès des États-Unis se réunit à Capitol Hill pour achever cette dernière étape du processus électoral. 5 morts ont été à déplorer.
Mathis Bernier/ Maxime Porrot
Une politique étrangère autocentrée
La politique étasunienne a alterné unilatéralisme et multilatéralisme.
Une politique variable...
Au service de leurs propres intérêts, les États-Unis ont toujours eu une politique étrangère oscillant entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme selon les gouvernements. Le multilatéralisme est un concept utilisé dans le champs des relations Internationales. Il se définit comme un mode d'organisation des relations inter-étatiques. Il se traduit par la coopération de trois États au moins dans le but d'instaurer des règles communes. Le terme s'oppose à l'unilatéralisme que l'on définira comme une tendance à agir en fonction de sa volonté et de ses intérêts propres, sans égard pour la souveraineté d'autres États et à l'extérieur des cadres multinationaux.
...entre l'unilatéralisme...
L'unilatéralisme est considéré comme un fondement de la politique américaine depuis la création de la république, en 1787. Cette tendance politique a commencé en 1823 suite à la doctrine de Monroe (alors président des EUA) qui affirmait que les Européens ne devaient plus intervenir sur le continent américain. De même, les Etats-Unis n'interviendront plus dans les affaires européennes ce qui fut brisé en 1917 lors de l’entrée en guerre des Etats-Unis. Bill Clinton président des Etats-Unis entre 1993 et 2001, déclare les Etats-Unis comme la seule nation indispensable bien qu'il fût considéré comme multilatéraliste. Plus récemment, Barack Obama président des Etats-Unis entre 2008 et 2016 avait réussi à faire reculer cet unilatéralisme par des accords avec de nombreux pays et une ouverture sur le monde sans précédent pour une personne occupant son rang. Mais de 2017 à 2020, Donald Trump, président à son tour, avait ramené l’unilatéralisme au premier rang de la politique américaine avec entre autre la fermeture des frontières et la construction du mur au niveau de la frontière mexicaine afin de repousser les Mexicains voulant s'installer dans le pays
...et le multilatéralisme...
Bien que totalement opposé à l'unilatéralisme, le multilatéralisme occupe tout de même une place majeure sur l'échiquier politique étasunien et ce depuis ses débuts. Il commence en. 1917 avec leur entrée dans la Première Guerre mondiale, puis en 1941 (entrée dans la 2ème GM) et 1944 suite aux accords de Bretton Woods qui font du dollar la monnaie internationale. Par la suite ce multilatéralisme s'étendra avec l'ouverture des Etats-Unis sur le reste du monde avec le siège de l'ONU à New-York, le siège de la Banque mondiale à Washington et le siège du Fond monétaire international à Washington également. En 1975, le G6 est créé. Cela montre leur ouverture et leur envie de collaborer avec le reste du monde et l'importance qu'ils veulent prendre sur l'échiquier géopolitique mondial. Barack Obama qui avait ramené le multilatéralisme au premier plan a même gagné en 2009 le prix nobel de la paix ce qui montre l'importance pour lui de s'ouvrir sur le monde et de ne pas restreindre la puissance américaine à son seul territoire.
Eliot Laurent
et Louison Retailleau
Les guerres en Irak : de l’implication mondiale à l'initiative isolée
En 1991, après la guerre du Golfe, les Irakiens restent sous la vigilance des Etats-Unis...
Un nouvel ordre mondial 1991-2001 L’Irak une zone déstabilisée (depuis 1991)
L’invasion du Koweït, également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït, est un conflit majeur entre l'Irak de Saddam Hussein et le Koweït, du 2 au 4 août 1990. Le 2 août, c’est l’invasion : les troupes irakiennes ont commencé à 2h locales à violer les frontières du Nord, et à pénétrer sur le territoire. De violents affrontements à l’arme lourde opposent des unités koweïtiennes à l’armée irakienne dans le centre de Koweït City.
La communauté internationale condamne fermement l’invasion, alors que les cours du pétrole flambent. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l’ONU « exige le retrait immédiat et inconditionnel des forces irakiennes ». Washington gèle tous les avoirs de l’Irak aux Etats-Unis et dans les filiales à l’étranger ainsi que les avoirs koweïtiens pour éviter qu’ils soient repris par des Koweïtiens au service de Bagdad.
Le 8 août, le président américain, George Bush, annonce l’envoi de troupes en Arabie Saoudite. Les premiers soldats de l’opération « Bouclier du désert » arrivent le lendemain. L’Irak proclame, le 8 août, sa fusion « totale et irréversible » avec le Koweït. Fin août, Bagdad annonce un découpage administratif du Koweït, faisant de Koweït-City et ses environs la 19e province irakienne. Le Conseil de sécurité autorise, le 29 novembre, « les Etats membres (…) à user de tous les moyens nécessaires » si l’Irak n’a pas quitté le Koweït avant le 15 janvier 1991. Washington, Moscou, Paris et Londres adjurent Israël de ne pas riposter, et les Etats-Unis déploient, le 20 janvier, des batteries anti-missiles Patriot en Israël. En mars 2003, le Koweït servira de tête de pont pour l’invasion américaine de l’Ira emmenée par George Bush fils, et qui a mené au renversement de Saddam Hussein.
Obama revient sur l'intervention de 2003
Le président américain Barak Obama a prononcé le 4 juin 2009 depuis l'université du Caire un discours intitulé "un nouveau départ", destiné à améliorer les relations américaines avec les musulmans fondé sur « le respect mutuel et sur cette idée que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas ». Dans son discours il va revenir sur la guerre d'Irak, il prononce les mots suivants « contrairement à la guerre avec l’Afghanistan, la guerre d'Irak et le résultat d’un choix ». Pour lui, les événements en Irak ont rappelé à l’Amérique la nécessité de la diplomatie et de construire un consensus international pour résoudre ses problèmes à chaque fois que c’est possible. Pour certains,son discours s’est avéré plutôt décevant car Barak Obama - qui doit sa présidence en grande partie aux sentiments anti-guerre de masse du peuple américain - s'en est servi pour « glorifier » la guerre à laquelle on croyait, par erreur, qu'il s'était opposé.
Emma Petit 12
La géopolitique selon Trump : l'unilatéralisme débridé !
Donald Trump, président des Etats-Unis d'Amérique de 2016 à 2020, renoue avec l'unilatéralisme.
Trump, un président ambitieux
Trump base sa présidence sur deux mots : "America first". Il veut dire par là que les États-Unis doivent passer au premier plan et doivent s'occuper d'eux avant de s'occuper des autres pays. C‘est donc l’unilatéralisme qui est mis sur le devant de la scène. Sa priorité est donc de protéger son peuple et de lui redonner les pleins pouvoirs. Il veut mettre en avant les familles et les travailleurs ce qui lui permet de se faire aimer du peuple et donc d'accéder au pouvoir américain. Il prévoit aussi de renforcer son économie. De ce fait, il augmente les taxes sur les produits chinois. Son idée de première grande puissance voit naître une Amérique qui tente de se construire seule malgré les difficultés liées à la Covid et à la dépendance vis-à-vis d'autres pays dans certains domaines. Cet ancien président a cherché aussi à limiter l’immigration surtout en provenance du Mexique. Il a donc fait construire un mur à la frontière par le Mexique lui-même.
La politique de Trump pose de nombreux problèmes aux autres Etats du monde pour qui le multilatéralisme est indispensable pour faire face aux défis mondiaux.
Des idées qui dérivent et qui ne plaisent pas à tout le monde
Trump s’est attiré l’animosité de nombreux pays par ses actions parfois lourdes de conséquences.
En plus du mur avec le Mexique, Trump décide de se retirer de nombreux accords européens comme l'accord pour le climat de Paris (juin 2017) ou le retrait du conseil des droits de l’homme (juin 2018) ce qui créé un isolement voulu par Trump. Certains pays décident donc de lui tourner le dos car ils trouvent ses actions insensées et infondées. Avec toutes ses envies de première puissance et de pays solitaire, Trump a délaissé totalement son ministère des affaires étrangères.
Après cela, Trump enchaîne les actions à la limite de l'anti-démocratie ce qui le fait perdre en crédibilité. Ce président qui avait promis un bel avenir aux États-Unis n’a finalement pas tenu toutes ses promesses, s’est montré opposé à la politique étrangère d’Obama et il s'est montré comme un enfant capricieux qui agit selon son bon vouloir.
Charly Boré et Lenny Pilet
Obama enterre le « système Bush »
Barack Obama, 44e président des États-Unis, définit sa vision géopolitique
Le président des États-Unis d'Amérique souhaite une politique étrangère plus consensuelle que celle de son prédécesseur Bush. Pour lui, sa vision repose sur une cohésion vers un même objectif entre les États. On définit cela comme le multilatéralisme. Le président des États-Unis, avec l'aide de ses secrétaires et de son gouvernement, agit grâce à une diplomatie de la "puissance intelligente" (smart power) dans leurs relations internationales, c'est à dire une approche qui souligne une nécessité d'une armée forte (hard power), mais aussi d'alliances, de partenariats et d'institutions à tous les niveaux pour étendre cette influence américaine (soft power) et établir la légitimité du pouvoir américain. De plus il se lance dans des messages de paix, d’unité et de respect mutuel entre les Etats. Il s’adresse généralement aux peuples avec une empathie qui rassure les Européens, les Africains, le monde musulman et ses voisins Latino-américains. À tous, il a proposé un « leadership amical » c’est à dire une rupture avec l'arrogance de son prédécesseur. On distingue cela par le fait de se poser comme l'« anti-Bush » absolu. Également, il a fixé un calendrier de retrait d'Irak et défini l'Afghanistan comme le premier « front » de la lutte antiterroriste, signé des traités de libre-échange transpacifiques. Barack Obama a réussi à réinventer le système géopolitique de son pays grâce à son envie et sa détermination au sein du monde. Il a permis de reconstituer des alliances et de définir de nouveaux projets pour son pays et les autres tout en restant une puissance dominante dans un système multilatéral.
Noémie GUECHAICHIA
Joe Biden : multilatéralisme, le retour ?
Le multilatéralisme se définit par l'attitude politique qui privilégie un règlement collectif des problèmes mondiaux.
Dans un premier temps Joe Biden aimerait en tant que président des États Unis renouer avec l'Europe afin de regagner leur position de leader de confiance.De plus le 46e président des Etats-Unis place son pays dans de nombreuses alliances comme le Quad, une alliance avec l'Inde, le Japon et l'Australie perçue comme essentielle pour la stabilité de cette région indo-pacifique. Mais également une alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni qui a laissé la France en colère a cause de son exclusion au sein d'un contrat de plus de 50 milliards d'euros.
Dans un second temps, le nouveau président aimerait tourner la page de la doctrine de Donald Trump "America first" et collaborer à nouveau sur les questions internationales.
Joe Biden rapporte de nouveau le multilatéralisme en se penchant sur les problèmes mondiaux comme l’écologie ou la santé. En effet, le nouveau locatairede la Maison blanche aide les pays en voie de développement pour la vaccination contre la COVID 19 mais également pour combattre les effets du réchauffement climatique et aide ces pays à se tourner vers des énergies renouvelables.
En plus de se soucier des enjeux contemporains mondiaux, Joe Biden défend les régimes politiques démocratiques face aux régimes autocratiques. Sans pour autant désigner la Chine, il déclare explicitement :" Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide.
Concernant la guerre en Ukraine, le président ne change pas d'attitude politique. Les États-Unis restent les premiers soutiens de l'Ukraine. Cela se traduit par une aide massive dèsmars 2022 : le renforcement militaire de l'OTAN (logistique et cybernétique, puis l'envoi d'armes et d'aide humanitaire qui correspondent à une somme de 1 milliard 200 millions de dollars. Un mois plus tard Joe Biden rajoute une aide de plus de 33 milliards de dollars en déclarant : « Le coût de cette guerre est élèvé mais céder à cette agression serait plus coûteux si nous laissons faire. ». Cela nous montre bien les enjeux envisagés par Joe Biden lors de son implication au sein de la guerre en Ukraine.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que, depuis son arrivée, Joe Biden bouleverse complètement la politique de Donald Trump en se rapprochant plus des idées de Barack Obama, le multilatéralisme en est l'exemple même.
Jeanne Bondu 12
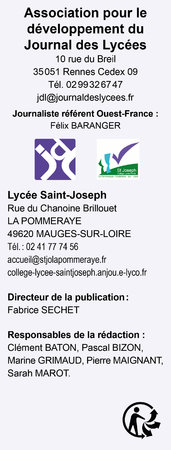
Le monde culturel influencé par les USA ?
Dans notre vie quotidienne, dans nos loisirs, dans nos choix de nourriture, les Etats-Unis ont une influence de plus en plus forte dans le monde sur des milliards d'individus.
Beaucoup d'éléments de la vie aux Etats-Unis se sont répandus à travers le monde, et particulièrement la culture américaine par le biais de flux d'information comme les films de Hollywood, internet, les médias ou encore les téléphones portables.
Dans le domaine de la télévision, les Etats-Unis se trouvent en première place des émissions les plus regardées dans le monde avec quinze émissions américaines sur vingt. De plus, la société Netflix fondée en Californie et spécialisée dans la diffusion de films et de séries, est devenue un acteur majeur de la société au niveau internationale puisque son nombre d'abonnés a quadruplé de 2012 à 2018 et possède plus de la moitié de ses abonnés dans le monde. Même chose pour le cinéma ou les Etats-Unis se situent à la troisième place des pays les plus producteurs de films même si sa part sur le marché est loin d'être la plus importante.
Au niveau des magazines, ils sont vendus partout dans le monde que ce soit au niveau de la circulation ou du nombre de vente, les dix premières places du palmarès des ventes sont dédiées à des entreprises américaines. De plus, ils sont troisième producteur de livres au niveau international après le Brésil et la Chine, mais font trois fois le revenu de leur concurrent principal, la Chine.
"Gastronomie" américaine
Ensuite, dans le secteur de la nourriture, les Etats-Unis sont très influents sur le globe et continue de se propager et de s'étendre dans tous les pays du monde.
Mc Donald's, le restaurant typique et incontournable des Etats-Unis est un bon exemple vu son implantation d'enseignes partout dans le monde. On le retrouve principalement en Amérique avec 14 267 Mc Donald's implantés aux Etats-Unis, en Europe avec environ 20 000 Mc Donald's et enfin en Asie de l'Est avec environ 15 000 Mc Donald's. Cependant, on peut voir que l'Afrique en compte moins de deux mille ce qui est très peu pour la superficie qu'elle possède face aux autres continents qui en ont beaucoup. De même que la firme créée à Seattle appelée Starbucks, leader mondial du café du fait de ses 45 000 enseignes dans le monde dont 3 400 en Chine. Ce géant du café arrive à vendre 127 cafés par seconde au sein du monde. Il est présente dans plus de 55 pays. Par conséquent, les Etats-Unis sont très influents dans le monde et se trouvent partout comme dans le secteur de l'alimentaire, de la télévision, des magazines et bien plus encore. Cependant on observe quand même que leur influence reste dans les pays développés et sont très absents sur le continent africain qui possède principalement des PMA (Pays Moins Avancés).
Margot BELLANGER
Manon MOREAU
Les Etats-Unis, première puissance militaire au monde
Pour Barack Obama, l’armée américaine est semblable à un marteau et tous les conflits étant des clous que les Etats-Unis dominent
Une puissance influente Bien que la Chine et la Russie soient deux États concurrents des EUA , ils restent moins influents que ce dernier . Les États-Unis dominent le marché international de l’armement avec plus d’⅓ des exportations d’armes. Les 6 flottes américaines sont réparties en bases navales partout dans le monde prêtes à intervenir à n'importe quel moment dans un conflit. De plus, l’armée américaine compte 1,3 million de militaires et 816 000 réservistes, ce qui constitue l'une des plus grandes armées du monde devant la Russie et derrière la Chine. Actuellement, les États-Unis se confrontent à une rivalité croissante avec la Chine et la Russie. Dans la situation actuelle du conflit ukrainien, les États-Unis et la Russie sont directement confrontés par le biais du hard power. En effet, les deux États se confrontent sur le plan militaire, les EUA fournissant des armes à l’Ukraine. Dans le cas de la rivalité avec la Chine, le conflit touche au domaine du soft power, les États-Unis ayant une puissance déjà établie tandis que la Chine est une superpuissance grandissante. Pour faire face à cette concurrence, les EUA peuvent compter sur des accords avec d’autres États comme celui de l'OTAN mais aussi celui signé avec l'Australie, le Japon, l'Inde et le Japon.
Les changements militaires
Les menaces chinoises et russes ont forcé les EUA à se préparer militairement parlant. Pour cette raison, Donald Trump, durant son mandat, a fait passer les dépenses des EUA dans le domaine militaire de 430 milliards de dollars en 2000 à 700 milliards de dollars, ce qui représente 40 % des dépenses militaires mondiales. De plus, les EUA ont annoncé en 2018, la réduction du nombre de militaires présents sur le continent africain afin de concentrer leurs forces dans les potentiels conflits à venir contre la Chine ou contre la Russie dans le contexte actuel de guerre en Ukraine.
Ethan Manceau et Antoine Cosneau
La domination maritime des Etats-Unis remise en cause par la Chine ?
Une thalassocratie qui s'impose en Asie
Effectivement, les États-Unis sont une thalassocratie puisqu'il s'agit d'un État dont la puissance est fondée principalement sur la domination de la mer. Il faut tout d'abord savoir que les États Unis sont la première puissance militaire au monde, elle est la seule nation à pouvoir se déployer militairement dans toute la planète. Pour cela elle dispose d'un arsenal naval impressionnant qui est composé de 11 porte-avions (avec le premier porte-avion a propulseur nucléaire). En effet, d'après le commandant en chef d'un des porte-avions "la puissance américaine ne connait pas d'égale" ou encore "le John C. Stennis (porte avions américain) est le symbole ultime de la puissance américaine". En effet c'est l'armée qui a la plus grande capacité de projection (ensemble des moyens qui permettent d'acheminer une force militaire, en très peu de temps et aux quatre coins du monde) ceci s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale afin d'endiguer la menace soviétique à l'heure de la guerre froide. De plus, d'ici 2031 la US Navy veut avoir 12 porte-avions complétement opérationnels sur les mers. Pour la chine leur équipement naval est moins développé en effet elle ne compte que 2 porte avions opérationnels. Cependant,pour rester une puissance influente maritime les États-Unis posent des bases navales qui évoluent en fonction des réalités géopolitiques. De nos jours ces forces navales se trouvent dans la zone Asie pacifique. Dans cette même zone en Asie du sud les États Unis font une lutte d’influence avec la Chine. Cela a pour objectif de gagner des alliés. Dans l'océan indien les deux pays ont des bases ou des facilités militaires ce qui leur permet de contrôler ou d'intervenir militairement. Ces emplacements militaires pour la Chine s'appellent le "collier de perles" et depuis 2006, Washington pense que ce "collier de perles" doit être contenu par un contre "collier de perles" proche afin que la Chine ne remette pas en cause leur domination des mers. Malgré les efforts de la Chine, les Etats-Unis restent la puissance maritime la plus influente de nos jours cependant la Chine renforce petit à petit sa puissance maritime.
Mathilde Leduc et Maxence Jarry
Entre alliances et repli, quelle est leur stratégie ?
Dans un monde multipolaire, les États-Unis conservent et renforcent leurs alliances pour rester les maîtres du jeu.
Les alliances des Etats-Unis avec l'Union Européenne
A la fin de la guerre froide, certains pays de l'ancienne Union Soviétique comme la Pologne ou la Hongrie rejoignent l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, initiée par la France afin de se protéger contre la Russie. Cette alliance dite uniquement défensive a permis aux Etats-Unis de posséder des bases militaires américaines dans les pays d'Europe notamment dans les pays alliés les plus près de la frontière russe comme notamment la Bulgarie et l'Allemagne. De plus, les Etats-Unis ont déployé de nombreux soldats en Europe. Avec le contexte actuel de la guerre en Ukraine, les bataillons militaires aux frontières de l'OTAN ont été renforcés avec 40 000 soldats et de nouveaux vont être créés en Slovaquie, en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie. L'OTAN qui était auparavant divisée, avec des relations difficiles suite à la nouvelle politique du président Donald Trump (vu par la suite) s'est réuni face à la Russie. Ensuite, la puissance, l'influence et la force des Etats-Unis sontégalement montrées à travers le PTCI, le Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement. Ce projet d'accord commercial entre l'Europe et les Etats-Unis favoriserait les grandes entreprises américaines en éliminant les droits de douane.
Un partenariat américano-européen négligé
Néanmoins, les Etats-Unis appliquent également une politique de repli. En effet, ces derniers ont décidé de retirer 35 000 soldats se trouvant en Allemagne, une partie importante étant rapatriée aux Etats-Unis. Il existe également des tensions et désaccords commerciaux. Par exemple, les Etats-Unis ont décidé d'instaurer des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d'aluminium. En réponse à cela, l'Europe a décider de taxer davantage certains produits américains. L'arrivée de Trump au pouvoir a elle aussi impacté l'entente Etats-Unis/Europe. En effet ce dernier a déclaré que l'Europe était "aussi mauvaise que la Chine". Il a également déclaré que selon lui l'OTAN était financée quasiment entièrement par les Etats-Unis, alors qu'en réalité il finance 67 %. Finalement, Trump conclut en expliquant que selon lui, "il n'y a pas d'allié ni d'ennemi, seulement des partenaires ou pas".
En conclusion, les Etats-Unis oscille entre le maintien de leur alliance traditionnelle et une politique de repli, surtout mise en avant par Donald Trump. On peut venir à se demander si le nouveau président Joe Biden suivra cette même politique ou si il préférera les alliances.
Maxence Lembaye
et Camélie Papin