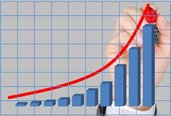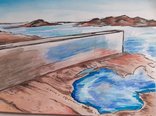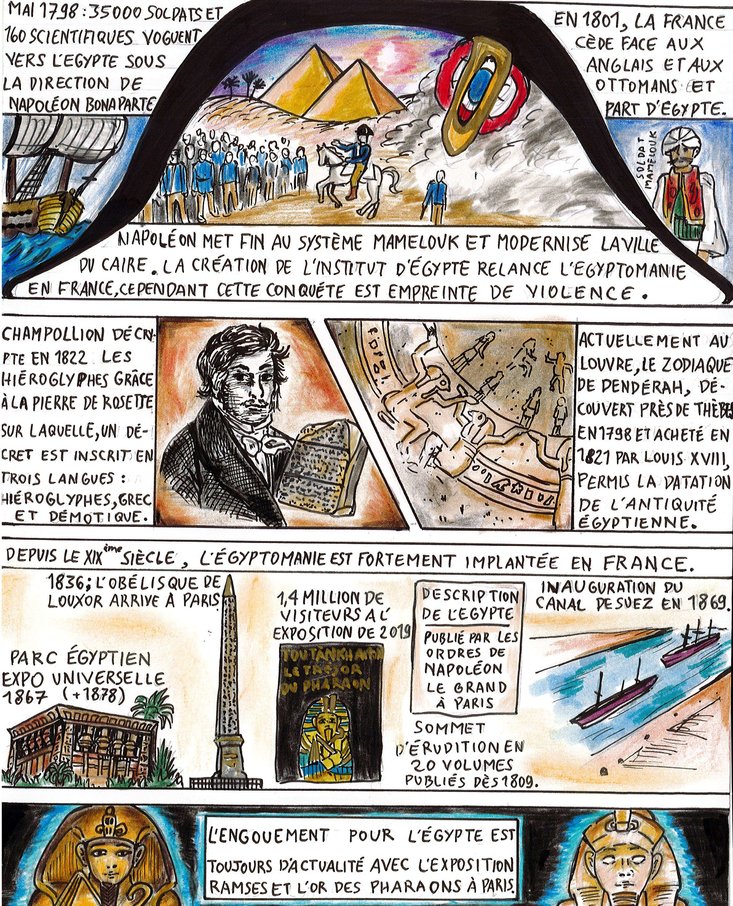Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
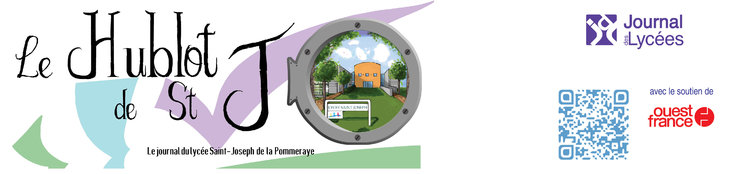
| N° 9 - Mai 2023 | www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr |
"40 ans, ce n'est pas rien !"
1982-1983 : M. NICOU, alors Chef d'établissement, connait le premier échange entre des élèves du Collège Saint-Joseph de La Pommeraye et du Kopernikus-Gymnasium de Rheine (Allemagne du nord).
2022-2023 : nous fêtons ce 40ème anniversaire du partenariat franco-allemand.
Sur le site de l'Armangé à Chalonnes, M. NICOU est revenu saluer M. BAUER, le Chef d'établissement du Kopernikus, arrivé la veille de Rheine. Il avait été de la délégation du 30 ème anniversaire au lycée et son souhait le plus cher, serait sans doute d'être du 50ème ... voire plus !
Lors de la cérémonie, qui a rassemblé tous les élèves de L'Armangé et les germanistes de La Pommeraye, les talents artistiques ont pu s'exprimer sous bien des formes : le logo dessiné par M. DEL RUE, la musique avec le travail du groupe instrumental du collège sous la baguette de M. MALINGE, le théâtre à travers la mise en scène du texte écrit par Mme THOMAS-M., intitulé "40 ans, ce n'est pas rien" ... sans oublier la danse, pilotée par Mmes GATE et BRIAND-G. !
Merci à tous les élèves qui ont participé à ce temps festif où l'émotion était au rendez-vous !
Pour l'occasion, a été planté, à l'entrée du Collège, un chêne de collection, signe de longévité, de fiabilité et de confiance !
Il grandira certainement sous une bonne étoile, celle offerte, certificat à l'appui, par M. BAUER !
Fabrice SECHET
(Chef d'établissement)
À la découverte de la Slovaquie
Dans la nuit du mardi au mercredi 1 février les élèves de seconde volontaires ont quitté leur chez soi durant une semaine pour rejoindre la Slovaquie. Ce voyage était un échange entre les élèves français et les élèves slovaques. Les élèves sont partis du 1er au 10 février, en restant 7 jours en Slovaquie.
Une escale par Budapest
En effet, après avoir pris l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle pour un vol d'approximativement 2 heures, les élèves et leurs professeurs ont fait halte à Budapest, la capitale de la Hongrie dans la soirée du mercredi et jusqu'au jour suivant. Ce passage par la capitale hongroise a permis de visiter la ville et de découvrir les monuments emblématiques de cette ville comme le parlement Hongrois, monument phare de la ville. Suite à cette escale, nous sommes arrivés dans la ville de Banska Bystrica, ancienne ville minière où nous avons passé la semaine chez nos correspondants slovaques. Après être arrivés en Slovaquie, nous avons eu le jeudi soir pour apprendre à connaître nos correspondants et avoir les premiers échanges avec eux et leur famille. Le vendredi, nous avons visité la ville de Banska Bystrica en faisant un jeu de piste pour découvrir la ville. Puis nous avons passé le week-end avec nos correspondants. Ce week-end a été un moment de découverte de la vie dans le pays. Nous avons pu goûter des spécialités slovaques, nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs lieux, et découvrir les paysages enneigés de la Slovaquie.
Arthur Chouviat (21)
L'échange franco-finlandais des secondes
Une trentaine d'élèves du lycée de St-Joseph sont partis à la découverte de la Finlande où ils ont été accueillis par leurs correspondants. Pendant ce voyage de 10 jours, les élèves ont pu découvrir un nouveau mode de vie... les pieds dans la neige.
Après un voyage en bus jusqu'à Paris où les élèves ont pris l'avion pour la Finlande, les participants à l'échange sont arrivés à l'auberge de jeunesse. Le lendemain, ils ont pu arpenter la ville d'Helsinki, visiter son vieux marché ainsi que ses églises protestante et orthodoxe.
Puis, ils ont pris le départ vers Joutsa, en Finlande centrale, où ils ont retrouvé leurs correspondants et sont allés chez eux pour rencontrer leurs familles : le meilleur moyen pour découvrir la vie quotidienne et les coutumes locales de manière plus approfondie.
Une immersion dans le mode de vie finlandais
Durant la semaine à Joutsa, les élèves ont passé un week-end dans les familles et ont pu s'addoner à des activités nouvelles pour eux, comme le ski, la motoneige, la pêche ou encore les saunas à haute température ! Les élèves ont passé du temps dans le lycée où ils ont expérimenté les différences entre le système scolaire français et le très réputé système finlandais ! Ils sont aussi passés dans les classes de maternelle afin de répondre aux questions des enfants et ont présenté la France à des collégiens et lycéens. Enfin, les élèves ont visité des villes comme Jyväskylä ou Joutsa.
Grâce à cet échange, les élèves ont découvert la vie scandinave et ont tissé des liens forts avec les correspondants et leurs familles. Ce voyage restera gravé dans leur mémoire pour toujours et leur laissera des souvenirs impérissables de leur expérience en Finlande.
Les élèves ont eu le plaisir de retrouver leurs correspondants en mai pour leur faire découvrir à leur tour, la culture et la vie en France.
Naël Cheignon (22)
Reise nach Deutschland : un double anniversaire
L'échange entre les lycées de La Pommeraye et de Rheine : un exemple durable de solides liens franco-allemands.
Le Traité de l’amitié franco-allemand, dit Traité de l’Elysée, a été signé le 22 janvier 1963 par Adenauer et De Gaulle. Il définit le cadre d’une coopération entre l’Allemagne et la France dans divers domaines : relations internationales, éducation, défense, etc. De là sont nés par exemple les jumelages et les subventions des échanges scolaires.
Un bel anniversaire de mariage
Cette année, on a fêté le 60ème anniversaire de cet engagement.
Le collège-lycée Saint-Joseph de La Pommeraye, quant à lui, est heureux de fêter le 40ème anniversaire de son partenariat avec le Kopernikus-Gymnasium de Rheine. L’anniversaire a été fêté l’an passé à Rheine ; cette année l’établissement a le plaisir de recevoir la visite du directeur du Kopernikus-Gymnasium, Monsieur Bauer, du directeur adjoint, Monsieur Brünning, et de la coordinatrice du collège, Madame Strecke. Vendredi 5 mai a eu lieu une cérémonie sur le site de l'Armangé pour fêter cet évènement auquel étaient conviés tous les germanistes !
Après avoir été reçus par les correspondants de Rheine du 1er au 10 février, nous avons pris plaisir à les accueillir à notre tour du 2 au 9 mai pour tisser des liens !
L’équipe d’allemand
Les Terminales aux Pays-Bas
Nos chers terminales ont eu le plaisir de visiter les Pays-Bas pour leur voyage de fin d’année ! Et de « découvrir les profs sous un jour nouveau ».
Le départ s’est fait le mardi 11 avril à 1h30 du matin, direction Bruges. Au programme : une visite guidée de la ville. Puis reprise de la route vers Rotterdam avec petite escapade par Kinderdijk, renommée pour ses nombreux moulins.
Le lendemain, les Terminales ont pu visiter le centre des visiteurs du Palais de la Paix situé à la Haye, ville reconnue internationalement comme la cité de la paix et de la justice. Après un pique nique en bord de mer et une visite en bateau de Rotterdam, ce fut l'heure de la visite libre : de quoi s’adonner à du shopping ! Le jeudi, direction Amsterdam, avec un petit détour par les champs de tulipes ! Visite des musées Van Gogh et Rijksmuseum. Grande étape : le parcours des déportés, avec des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale : maison d’Anne Frank, le Namen Monument, la synagogue portugaise. Une visite en bateau des canaux d’Amsterdam a conclu cette belle journée.
Pour le dernier jour, visite du barrage anti-tempête, le Maeslantkering, qui est l’un des plus importants systèmes de lutte contre les inondations. L’après-midi, direction la ville d’Anvers pour visiter le musée maritime et ethnographique.
"Une très bonne ambiance"
"L'auberge était cool même avec le peu de douches ça s'est bien fait en tout cas chez les garçons.
Pour les visites elles étaient bien aussi sauf le musée à Anvers. Le voyage était par contre un peu court je trouve quand on sait que les autres années c'était plus long. Mais quand même une note positive" raconte Maxence Lembaye élève en T2.
"Malgré une arrivée à bout de nerf, je me suis senti plutôt à l'aise durant ce voyage. L'auberge n'était pas trop mal, on y a bien mangé et les lits étaient plutôt confortables, même si les douches peu nombreuses étaient un peu capricieuses... Les visites étaient dans l'ensemble intéressantes et variées ce qui a permis à chacun d'apprécier celles-ci ! Le seul point négatif de ce voyage serait le trop de bus. Mais dans l'ensemble ce voyage m'a rempli de plein de bon souvenirs et m'a permis de mieux apprendre à connaître mes camarades ainsi que les profs présents" révèle Lenny Pilet, élève en T2.
"Pour le voyage, j'ai été agréablement surpris par l'auberge, tant pour les repas que pour les bâtiments. Les villes visitées ont toutes été intéressantes ce qui reflète d'un bon choix de la part des professeurs, les activités de même, mais petit bémol avec le musée d’Anvers. Les profs ont été agréables, ça faisait plaisir de les découvrir en dehors des cours. Les temps libres ont été très appréciables" explique Enzo Rahard, élève en T2.
Coline Monnier (T1)
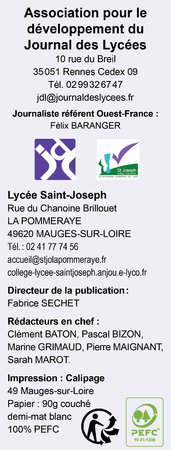
Retour sur le temps fort contre les discriminations
Le vendredi 16 décembre, un temps fort a été organisé au lycée pour parler des différentes discriminations. Les élèves ont pu participer à 3 ateliers de leurs choix animés par 9 associations, sur des thèmes tels que le sexisme, le handicap, le racisme.... Suite à cet après-midi, les opinions des lycéens ont été récoltés.
Certains sondés ont trouvé que quelques ateliers manquaient de dynamisme. D'autres considéraient que ces interventions étaient plus répétitives qu'informatives : "Certains ateliers ne faisait que reprendre des choses que l'on connaissait déjà" (Jeanne).
A l'inverse, de nombreux élèves ont montré de l'optimisme quant à cet après midi, qu'ils ont trouvé instructive et intéressante : "C'était bien pour s'informer, pour se rendre compte des problèmes sociaux entre les gens" (Bastien). Les nombreuses données chiffrées sur les discriminations ont également été appréciées par plusieurs élèves, permettant de prendre conscience de l'ampleur des phénomènes.
Enfin, l'atelier qui à le plus marqué les lycéens reste celui de Mme Boullot de Sabran, venue témoigner de son vécu. Mère d'une fille en situation de handicap, elle a pu constater le manque de mesure pour intégrer correctement les personnes dans cette situation en France. Les interrogés ont affirmé qu'il serait intéressant de refaire un tel après-midi d'échanges sur ces questions, qui traversent la société et la mette en question.Mélyne Delaunay (13)
Une génération sous tension
À l’aube des examens de fin d’année, le stress est un phénomène qui revient souvent chez les élèves. On parle en effet d’un jeune sur quatre anxieux à l’école, selon une étude de l’association SynLab. Ainsi, même au sein de notre petit lycée de campagne, ces réactions naturelles face à des situations qualifiées de stressantes sévissent.
Quelques témoignages
Afin de connaître l’ampleur de ce stress dans notre établissement, nous avons souhaité interroger des élèves de niveaux différents, mais tous plus ou moins touchés par ce sujet : “Toute la pression qu’on nous met pour le bac, c’est une année avec énormément de choses : le permis, les cours, les jobs d’été ; l’anxiété scolaire est un phénomène qui m’est déjà arrivé”, explique un élève de terminale. Un élève de première rajoute : “À partir de la première, c’est à ce moment que la pression augmente, tu arrives à l'événement où on te prépare depuis presque 15 ans. La pression des notes peut engendrer l’angoisse de l’école.”
Mais alors, comment
le gérer ?
Si le stress survient régulièrement, il existe néanmoins des solutions pour lutter contre celui-ci. L’organisation, du temps pour soi et la combinaison sport/alimentation saine et sommeil en font partie. Mais il faut surtout trouver sa propre manière de vaincre ce mal qui se répand au sein d’une génération entière de jeunes, et qui nous joue parfois des tours.
Coline Monnier (T1)
et Juliette Macé (T2)
« Tous migrants » : une expo engagée
En quoi cette initiative consiste-t-elle ?
Dernièrement le lycée de la Pommeraye a accueilli l’exposition Cartooning for peace intitulée « Tous migrants ». Cette association née en 2006 a pour but de « Désapprendre l’intolérance ». Cette expression nous montre que l'objectif est de promouvoir un respect entre les différentes communautés. Il s'agit de casser les codes des expositions traditionnelles en incluant des caricatures et des dessins de presse sur les kakemonos.
Ces affiches retracent les parcours complexes des migrants à travers des dessins de presse du monde entier. L'objectif est de montrer les raisons du départ jusqu'à l'intégration dans le pays d'accueil, en abordant également les difficultés rencontrées lors de leur périple.
Pourquoi utiliser le dessin de presse ?
Le dessin de presse a pour fonction de donner un point de vue sur l’actualité en y incluant un plus grand public parce qu’il traduit, en une seule image, ce qu’un article de presse peut développer sur plusieurs dizaines de lignes. Ces œuvres sont généralement satiriques donc plus attrayantes pour les lecteurs. Merci Mme Marot pour cette initiative !
Izan Muhammad (23)
Un reporter de guerre s'invite au lycée Saint Joseph
Le 8 février 2023 au lycée Saint Joseph, les Premières et Terminales ont eu la chance d'écouter le témoignage d'un journaliste de guerre : Gérard Grizbec.
Il a pu éclairer les élèves de spécialité Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques sur ce qu’est son métier, ses dangers, son utilité.
Au cours de l’échange, ce reporter de guerre travaillant pour France 2 a expliqué les coulisses de son métier. Il a couvert de nombreuses guerres, généralement au Moyen-Orient, et a évoqué son métier de journaliste en deux temps : tout d’abord en expliquant sa profession et la place importante que tient l’information en général ; en abordant ensuite son métier en lien avec la situation politique du territoire.
Ayant fait des études d'histoire, Gérard Grizbec a développé un goût certain pour cette discipline, et entame une carrière d'enseignant pendant 7 ans. Quelques années plus tard, il commence à rédiger pour les quotidiens Le Monde ou Libération. Il se spécialise ensuite dans la presse audiovisuelle, notamment en travaillant en tant que reporter de guerre, sur France 2.
Gérard Grizbec a su prendre un certain recul sur sa profession, et a notamment averti les élèves sur le partage d'informations fausses : "Faites toujours attention à ce que vous dites, n'affirmez jamais une information en commençant par « je crois »." La croyance est en effet ce qui n'est pas vérifié, ce qui est donc mal informé.
Suzanne Baranger (12)
La justice est-elle équitable ?
Le système judiciaire français est censé garantir l'égalité devant la loi pour tous les citoyens. Mais des inégalités persistent…
En ce qui concerne le genre, les femmes continuent de faire face à des inégalités judiciaires. Les femmes peuvent être confrontées à des stéréotypes de genre et à des préjugés lorsqu'elles sont impliquées dans des affaires judiciaires en tant que victimes, témoins ou accusées. Par exemple, les femmes victimes de violence domestique peuvent faire face à des obstacles pour obtenir des mesures de protection efficaces, et les agressions sexuelles peuvent être minimisées ou stigmatisées dans certains cas. De plus, les femmes peuvent être confrontées à des inégalités dans le traitement judiciaire lié à la garde des enfants et aux pensions alimentaires lors de divorces ou de séparations. Les écarts de salaire entre les sexes et les rôles traditionnels de genre peuvent également influencer les décisions judiciaires, notamment en matière de pension alimentaire et de partage des biens.
Classes sociales et genre
En ce qui concerne les classes sociales, les inégalités économiques et sociales peuvent également se refléter dans le système judiciaire. Les individus issus de milieux sociaux défavorisés peuvent être confrontés à des obstacles dans leur accès à la justice, tels que les coûts élevés des procédures judiciaires, les difficultés pour trouver des avocats et les ressources limitées pour défendre leurs droits. Les personnes de classes sociales défavorisées peuvent également être confrontées à des discriminations systémiques dans le système judiciaire, notamment en matière de profilage racial ou de traitement disproportionné dans les affaires pénales.
Les inégalités judiciaires en France liées au sexe et aux classes sociales sont des défis importants qui persistent dans le système judiciaire. Il est essentiel de reconnaître ces disparités et de prendre des mesures pour garantir une justice équitable et égalitaire pour tous les citoyens, indépendamment de leur genre ou de leur origine sociale.
Louison Retailleau (T3)
Retraites : une réforme impopulaire
Depuis les premières discussions sur la réforme des retraites jusqu'au recours à l'article 49.3 de la Constitution, la France a connu de multiples tensions et a dû faire face à des manifestants en colère. Mais pourquoi une telle réaction à l'égard du gouvernement ?
Il y a quelques mois, le gouvernement, poussé par des motivations économiques, a lancé un nouveau projet de réforme consistant à faire reculer l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Dans un contexte économique fragile et face à l'endettement public, reculer l’âge de départ à la retraite permettrait ainsi à la population de cotiser plus longtemps (impôts) pour permettre aux générations futures d’avoir une pension de retraite suffisante. Cependant cette réforme a provoqué une grande révolte chez une partie des Français.
Une contestation vaste et durable
En effet, depuis son annonce, de nombreuses manifestations et protestations ont eu lieu contre le projet de réforme. Considérant l'âge de départ à la retraite trop élevé, de nombreuses personnes ont souhaité exprimer leur avis à travers des rassemblements, des grèves ou encore à travers la presse. Selon l'opinion directe et plusieurs chaines d'informations telles que BFM TV, entre 60 % et 75 % des Français sont contre cette réforme, soit presque les 3/4 de la population.
Aujourd'hui, deux opinions s'opposent en France. Il y a d'un côté les opposants à cette réforme, comme cet ingénieur : « Je suis contre car c'est un recul par rapport à l'évolution de l'Homme au travail. » À l'inverse, on en trouve également qui réfutent l'opposition à la réforme, comme ce retraité : « Dans la plupart des autres pays européens, l'âge de départ à la retraite est plus élevé que chez nous. Nous n'avons pas à nous plaindre. De plus, avant la retraite était à 65 ans et il n'y avait pas autant de débats. »
On observe donc des avis très variés à propos de cette réforme qui divise les personnes aux opinions différentes et qui unit également les Français dans la rue. Mais l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme, amène un nouveau débat aujourd'hui : cet article de la Constitution ne porte-t-il pas atteinte aux libertés en France ?
Suzanne (12) et Mélyne (13)
Le système éducatif français est en panne !
L'avis sur le système scolaire français actuel est très ambivalent. En effet, 46 % estiment qu’il fonctionne « bien », contre 54 % « mal ». Ce pourcentage révèle un système possiblement défectueux dans lequel beaucoup d'individus ne se reconnaissent plus, n'y trouvant plus autant d'utilité qu'auparavant. Les personnes qui défendent l'avis d'un mauvais cadre institutionnel appuient leurs arguments avec des chiffres sur les réussites scolaires des élèves par rapports aux autres nations. En effet,15 % des élèves français atteignaient le niveau avancé en mathématiques en 1995, contre 1 % en 2015 selon l'étude internationale TIMMS.
Baisse du niveau scolaire
On constate donc une réduction du niveau scolaire des élèves français depuis quelques décennies. De plus, ce sont également les étudiants qui sont directement concernés, et 83 % pensent que le système éducatif est en décalage complet avec les enjeux de l’époque. On le remarque par de grandes difficultés à s'insérer sur le monde du travail avec 16 % des 15-24 ans qui ne sont pas en étude et qui sont aujourd’hui au chômage. Ensuite les jeunes pensent qu'ils devraient être davantage accompagnés et guidés sur un projet professionnel visé dès la seconde afin d'éliminer certaines matières inutiles pour différents domaines.
Cela nous amène au mal-être des jeunes en raison d'une surcharge mentale. Au collège et au lycée, les élèves sont soumis à de nombreux facteurs de stress : pression de la part des parents et des enseignants, charge de travail personnel. C'est en effet 8 heures de cours du lundi au vendredi, avec lesquelles il faut compter, en moyenne, deux heures de devoirs le soir et les activités extrascolaires. La Corée et la Finlande obtiennent par exemple de meilleurs résultats en étant beaucoup plus économes que la France. Chacun de ces facteurs ont des répercussions sur la qualité de vie d'un étudiant et font que le système scolaire se voit être obsolète depuis peu.
Jade LEBRUN (T1)
Coupe du monde 2022 : l'heure du bilan
Le Mondial au Qatar avait fait l'objet d'annonces de boycott. Mais qu'en est-il dans la réalité ?
Très décriée depuis son attribution en 2010 au Qatar, la 22ème édition de la Coupe du monde de football s'annonçait assez terne. En effet, les impacts environnementaux (climatisation des stades) et humains (conditions de travail infernales pour les ouvriers, droits réprimés des personnes LGBT) ont provoqué un désintérêt du public pour l'évènement. Un boycott d'envergure mondiale s'est donc installé durant la période pré-Coupe du monde. Mais, quatre mois plus tard, il est temps de dresser le bilan : le boycott a-t-il tenu, ou a-t-il été oublié par la beauté du jeu et du sport ? Le Qatar a-t-il réussi à séduire un public jusqu'alors indifférent à l'évènement ?
Une édition réussie...
Dès le 20 novembre, un premier élément de réponse a été apporté. Effectivement, lors de la cérémonie d'ouverture, TF1 a enregistré 5,13 millions de téléspectateurs, soit 1,15 million de plus que lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. De même, dans les stades, les supporters ont répondu présent. Selon la FIFA, ils étaient 2,45 millions, contre 2,17 millions en Russie. Pour Gianni Infantino, président de la FIFA, il s'agit tout simplement de "la meilleure Coupe du monde de tous les temps". La bonne organisation générale du Qatar (accueil chaleureux, stades faciles d'accès...) est l'une des clés de cette réussite.
De plus, cet évènement mondial a révélé la présence de la première femme à arbitrer un match (la Française Stéphanie Frappart lors de Costa Rica-Allemagne), ce qui constitue une avancée supplémentaire dans la lutte pour l'égalité des sexes. Aussi, la qualification de l'ensemble des continents suite à la phase de poules a-t-elle permis une ouverture d'esprit sur les nations les moins habituées à atteindre ce niveau de la compétition (Maroc, Corée du Sud...). Finalement, la Coupe du monde 2022 a permis au Qatar de travailler sa diplomatie, par la mise en lumière du pays ainsi que sa capacité à organiser un évènement d'une telle envergure. Sur le plan sportif, cette édition a livré un spectacle exceptionnel sur les terrains, notamment la finale opposant la France et l'Argentine (3-3 / 2-4 aux tirs aux but) qui restera gravée à jamais dans l'histoire du football mondial. Ce match a d'ailleurs conduit au sacre de l'Albiceleste de Lionel Messi, malgré une équipe de France forte en caractère portée par Kylian Mbappé.
… qui continuera
à faire parler
Cependant, le pari réussi du Qatar, qui a su rendre cette Coupe du monde normale, ne veut pas dire que les polémiques initiales ont disparu. En effet, en plus de représenter une aberration écologique, les stades climatisés ont été accusés d'être à l'origine de coups de froid chez certains joueurs et supporters. Concernant les personnes LGBT, l'organisation qatarie a interdit de porter le brassard "One Love", ce qui n'a pas échappé à l'équipe d'Allemagne qui s'est tout de suite manifestée contre cette décision. Enfin, l'indignation face à la mort de travailleurs sur les chantiers laisse une mauvaise image du Qatar. Les associations de défense des droits de l'Homme ne manquent pas de rappeler qu'encore aujourd'hui, près de deux millions de travailleurs migrants sont victimes de violation de leurs droits.
Quoi qu'il en soit, cette Coupe du monde 2022 aura marqué les esprits, par son succès mais également par son organisation atypique qui continuera à faire débat dans le futur.
Jules Cohu (T1)
Des fédérations en crise
Le comportement des présidents ont plongé les fédérations sportives dans la tourmente.
La Fédération Française de Football (FFF) a traversé une crise institutionnelle sans précédent : Noël le Graët a récemment démissionné de son poste à la direction de la FFF. Réputé pour avoir eu de nombreuses déclarations déplacées tout au long de sa carrière, Le Graët déclarait qu'il n'aurait même pas appelé Zinédine Zidane en cas de non-prolongation de Didier Deschamps, ce qui a déclenché une crise début janvier. Ces propos ont fait fortement réagir dans le monde du football français, avec entre autre Mbappé dont la déclaration a pesé dans l'opinion public : "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça".
En plus de ses déclarations, l'ex-dirigeant de la FFF était également accusé de propos et de comportements inadaptés vis-à-vis de ses collègues féminines. La première à prendre parole fut Sonia Souid début janvier sur le plateau de BFMTV : "Mon président me voit comme deux seins et un cul." Pourtant, cette connaissance des agissements de Noël le Graët n'est pas récente. En septembre dernier, le magazine So Foot titrait "Ma fédé a craqué" et publiait dans ce même numéro une enquête dans laquelle des collaboratrices actuelles ou passées de Noël le Graët déclaraient (anonymement) avoir reçu à plusieurs reprises des messages à caractère sexuel de leur supérieur. Le 28 février, le désormais ex-président de la FFF présentait sa démission devant le comité exécutif, tout en continuant de plaider son innocence.
"On manque pas de respect à la légende"
À quelques mois de la Coupe du monde organisée en France, la Fédération Française de Rugby (FFR) était plongée en pleine tourmente. Bernard Laporte, en poste à la tête de la FFR, s'est mis en retrait, ce 27 janvier, de son poste sous la pression des autres membres de la Fédération. Alors qu'il avait déjà été confronté à la justice en 2005 et en 2007, le dirigeant a, le 22 septembre 2020, été placé en garde à vue en companie de Mohed Altrad, alors président du Montpellier Hérault Rugby, pour corruption. M. Altrad aurait notamment versé 180 000 € à Bernard Laporte afin que celui-ci intervienne auprès de la commission d'appel de la FFR, pour que les sanctions à l'encontre du club de Montpellier soient allégées. Bien que les deux hommes n'aient pas été mis en examen pour cette affaire, le sponsoring des maillots des Bleus par Altrad fait également débat, puisque cette attribution serait possiblement due à des accords entre les deux hommes. De plus, en janvier 2023, Bernard Laporte a de nouveau été placé en garde à vue pour blanchiment d'argent et fraude fiscale aggravée.
Foot, rugby, handball…
Même du côté du handball, la Fédération Française est en pleine tourmente. Bruno Martini, ancien gardien de but de l’équipe de France, champion du monde et président de la Ligue nationale, a été condamné en janvier à un an de prison avec sursis, 2 500 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. Une condamnation en raison des chefs d'inculpation le concernant, c'est-à-dire corruption de mineurs et détentions d'images pédopornographiques.
Louison Retailleau (T3)

En L1, triste bilan pour le SCO d'Angers
Un naufrage sur tous les points ? Cette saison 2022-2023 semble un long cauchemar pour le club angevin. Tant pour le sportif que sur les affaires extra-sportives…
Le club de football angevin, le SCO d’Angers vit une saison bien compliquée sur de nombreux points pour sa 8ème saison consécutive en Ligue 1. Tout d’abord un bilan dans l’élite catastrophique avec une dernière place, 22 défaites, 4 nuls et 2 victoires soit 10 points sur les 84 possibles à la trêve internationale du mois de mars (journée 28) et des records de défaites qui s’enchaînent. Avec 4 descentes cette année pour valoriser la Ligue 1 et la Ligue 2 en prévision du prochain cycle de commercialisation des droits TV post-2024 , le SCO risque de descendre en Ligue 2. Le club s’est également fait éliminer en 1/8 de finale de la Coupe de France au Stade Raymond Kopa contre le FC Nantes au tirs aux buts (1-1) puis (2-4), le FC Nantes est actuel finaliste.
Supporters en colère
Les supporters sont en colère, ils l’ont fait savoir en lançant des fumigènes sur le terrain lors du match face à Toulouse et ont déployé de nombreuses banderoles dans le stade. De plus, le stade est à moitié plein avec une affluence moyenne de 10 361 personnes pour une capacité maximale de 19 800 places. Enfin, les problèmes d’entraîneurs font beaucoup parler. Après le licenciement de Gérald Baticle, c’est le nouvel entraîneur Abdel Bouhazama qui, en plus de résultats catastrophiques a déclaré : « C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles » suite à une autre affaire qui lui à value un licenciement. C’est actuellement Alexandre Dujeux l’entraîneur, qui est en intérim.
Sauver l'honneur
Les problèmes sportifs et internes n’en finissent plus au SCO, sans parler de Saïd Chabane. Les supporters angevins réclamaient le départ de leur président depuis longtemps, celui-ci a démissionner le 29 mars, remplacé par son fils Romain. Sportivement catastrophique mais financièrement dans de meilleures conditions, après un déficit de presque 20M€ sur l’exercice 2021, le solde final sur 2022, après impôts, est positif de 8,74M€ au 30 juin 2022 grâce aux droits TV, recettes commerciales, billetterie, abonnements, merchandisings et autres produits. Malgré les nombreux problèmes extra-sportifs et les résultats décevants, le bilan du SCO reste mitigé. Avec beaucoup de défaites et certaines humiliations (5-0 contre Montpellier...), il y a des bonnes choses dans le jeu angevin et l’élimination en Coupe de France reste frustrante ; elle a marquée un tournant dans la saison angevine. Aujourd’hui, la descente en Ligue 2 est actée. Espérons que le club relève la tête dès la saison prochaine et remonte le plus rapidement possible en Ligue 1. Le dernier défi pour l’honneur du club est d’éviter de finir avec le plus faible total de points de L1 qui est de 17, détenu par le RC Lens (1988-1989). Le SCO est actuellement à 14 pts, il reste 4 journées pour sauver l’honneur !
Maxime Porrot (T3)
L'inflation actuelle : qu'est-ce que c'est ?
Tout d’abord, cette notion « d’inflation » doit parler aux élèves de la spécialité SES, mais peut-être pas à toutes et tous. Alors pour rappel, l’inflation est une augmentation générale des prix des biens et services dans une économie. L’inflation que connaît la France en 2023 est d’environ 7 %.
Les entreprises responsables ?
Celle-ci est due à la réouverture après la pandémie. Depuis la reprise de l'activité après la crise Covid, les consommateurs rattrapent une partie de leur demande reportée, ainsi il est assez facile pour les entreprises d'augmenter un peu les prix sans perdre de clients.
La guerre en Ukraine
et la crise du Covid
La guerre en Ukraine liée à la crise du Covid ont fait monter les prix de nombreuses matières premières (pétrole, gaz, huile, blé). La baisse des exportations ukrainiennes tarit l'offre sur les marchés et pousse les prix à la hausse.
Les politiques de relance
et l'Euro perd de la valeur
Certains pays ont mis en place des programmes de relance exceptionnels, ces dépenses publiques stimulent la demande et accentuent la pression inflationniste. De plus, l’Euro s’est déprécié, cette baisse renchérit le prix des importations, dont notamment le prix des énergies fossiles et renforce ainsi l'effet d'inflation importée.
Les conséquences
L’inflation actuelle est donc responsable de la baisse du pouvoir d’achat des citoyens.
Maxime Porrot (T3)
La Chine dit stop au zéro Covid
Après de longs mois de souffrances dues au virus, le gouvernement chinois a mis un terme à sa politique zéro Covid.
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Chine a mis en place une approche de "zéro Covid" pour contenir la propagation du virus sur son territoire. Cette approche se caractérise par des mesures strictes de confinement, de quarantaine, de tests massifs et de traçage des contacts, ainsi que par des restrictions de voyage et des fermetures temporaires des entreprises et des lieux publics. La politique "zéro Covid" en Chine a été largement appliquée dans plusieurs provinces du pays, notamment à Wuhan, où le virus a été identifié pour la première fois en décembre 2019.
Une politique lourde de conséquences...
Cependant, cette politique en Chine a également eu des conséquences économiques et sociales. Les fermetures temporaires des entreprises et des lieux publics, ainsi que les restrictions de voyage, ont entraîné des perturbations économiques, avec des pertes d'emplois, des faillites d'entreprises et une baisse de la consommation. Les travailleurs migrants, qui sont nombreux en Chine, ont été particulièrement touchés, car ils ont perdu leur emploi dans les villes et ont été contraints de retourner dans leurs régions d'origine. Par ailleurs, de telles mesures ne sont pas sans inspirer des inquiétudes concernant le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Les critiques ont souligné que les mesures de confinement et de quarantaine ont parfois été imposées de manière coercitive avec la surveillance des citoyens, la limitation de la liberté de mouvement et la répression de la liberté d'expression. Néanmoins, la politique "zéro Covid" en Chine a également été saluée pour son efficacité dans la lutte contre la propagation du virus et pour la protection de la santé publique.
...dont le bilan est mitigé
Cette politique en Chine a été mise en place pour contenir la propagation du virus et protéger la santé publique, mais elle a également eu des conséquences économiques, sociales et sur les droits de l'homme. Son efficacité dans la lutte contre la pandémie a été saluée, mais les critiques ont soulevé des préoccupations concernant les droits individuels. L'équilibre entre la gestion de la pandémie et le respect des droits de l'homme reste donc un défi pour la Chine.
Louison Retailleau (T3)
La Zone 51 : alien ou pas alien ?
La Zone 51, en proie à des légendes sur les extra-terrestres.
Il était une fois, en 1955, une personne nommé Richard M. Bissel Jr., officier dans les services secrets américains. Durant un vol d'essai d'avion espion dans le Nevada, il repéra le terrain où a été constuit la Zone 51. C'est une zone millitaire ultra secrète engagée dans l'aviation et l'espionnage américain. Cette base millitaire est maintenant très connue pour toutes ces théories mettant en cause des extraterrestres, mais d'ou viennent-elle ?
La naissance du mythe
C'est en 1989 que cette théorie voit le jour, à la suite d'une interview de Robert Lazar, un homme qui y travaillait. Il affirme qu'il travaillait sur des engins spatiaux et à la reproduction de technologies extra-terrestres à des fins millitaires. Quelques jours plus tard, certaines personnes ont découvert que Lazar mentait, mais il était déjà trop tard et la théorie s'est éparpillée, jusqu'à devenir un véritable phénomène mondial.
Le "rush" qui a "flop"
Comme la Zone 51 est sujette à de nombreuses théories, certains voulaient voir par eux-mêmes si c'était vraiment une base ultra-secrète abritant des technologies extra-terrestres, ou même si elle abritait des extra-terrestres. C'est l'idée de Matty Roberts, un étudiant, qui déclenche l'évènement du nom de "Storm Area 51, They can't stop all of us" ("Prenons d'assaut la Zone 51, il ne peuvent pas tous nous arrêter"). Cette évènement a eu lieu le 20 septembre 2019 et 2 100 000 était intéressé pour participer mais seulement une cinquantaine de personnes se sont finalement rassemblées à l'entrée de la Zone 51. Au final, cet évènement n'a pas eu lieu et sera donc abandonné.
Cette zone sera donc encore secrète et de nombreuses théories peuvent encore voir le jour dans l'avenir...
Ethan Leboulenger 22
The Line : utopie ou dystopie ?
Le projet architectural et urbaniste The Line est présenté par la société NEOM comme "un miracle pour le monde" tel une nouvelle merveille du monde. NEOM est l'entreprise en charge de la construction soutenue par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. The Line serait une ville intelligente sous la forme d'une gigantesque barrière de 170 km de long, 200 m de large et 500 m de haut aux parois revêtues de miroirs pour refléter l'environnement.
Cette ville vise le 100 % durable en rendant tout accessible à pied et en utilisant uniquement des énergies renouvelables. L'eau deviendrait inépuisable et le taux de délinquance atteindrait 0 % grâce aux caméras de surveillance omniprésentes et à une justice menée par des I.A.(Intelligence artificielle). Avec 9 millions d'habitants (surtout des étudiants et des scientifiques), cette ville serait un pôle de la connaissance.
Cependant, sa construction implique la destruction des écosystèmes, l'expropriation violente des minorités (4 morts dans la tribu des Howeitat) et la génération de grandes quantités de CO². Une fois construite, cette gigantesque barrière va bouleverser les écosystèmes (au moins 90 espèces menacées) et les parois faites de miroir vont refléter la chaleur sur l'environnement adjacent. The Line va accentuer la fracture sociale et la surveillance deviendra quasi permanente. Commencé en 2021, ce projet devrait être achevé en 2030. Pour le géographe Alain Musset, il s'agit d'une utopie qui va se révéler être une dystopie.
Mattéo Etzel (T1)
L'Ukraine à portée de coeur
Le 3 avril, l'association UKR'NGO est intervenue au lycée Saint-Joseph afin de présenter l'association et l'ensemble des actions réalisées en faveur de l'Ukraine. Tout a commencé en 1996, par des spectacles de danses folkloriques de jeunes Ukrainiens organisés en Anjou. Les familles qui accueillaient ces jeunes ont souhaité faire davantage pour eux en apportant leur aide au pays. Ainsi est née en 2008 l'association UKR’NGO. Très vite, un ensemble d'actions ont été mises en place.
Des convois déjà organisés avant la guerre
Un premier convoi a été organisé en direction de l’Ukraine pour venir en aide aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux orphelinats… Cette association vient exclusivement en aide à l’Ukraine et plus particulièrement dans la région de Lviv. Avant la guerre, les membres organisaient des événements tels que des lotos, des concours de belote, des ventes de jus de pommes, etc… dans l’unique but d'aider la population ainsi que de financer diverses infrastructures. Depuis la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie, l’association achemine de nombreux convois, composés en majeure partie de médicaments, de vêtements… L'association récolte des nombreux dons (matériels et financiers) qu'elle stocke dans un local prêté par une entreprise de transport de La Pommeraye. Aujourd'hui, l'association se déplace dans les établissements pour faire connaître ses actions et encourager les jeunes à s'investir dans différentes activités. Vous pouvez retrouver leurs actions, leurs partenaires ainsi que leurs actualités sur le site : https://www.ukrngo.com. Pour adhérer à l'association, il suffit de se connecter à ce site et de s'inscrire.
Ilona Marques
et Elina Ravain (13)
Des femmes inventent l’industrie du futur
Huit lycéennes de St-Jo se sont particulièrement illustrées au challenge « Innovatech »
Jeudi 2 mars 2023, trois premières et trois terminales ayant choisi la spécialité physique-chimie se sont rendues à l’école d’ingénieur Polytech d’Angers dans le cadre du challenge Innovatech organisé par l’association Elles bougent afin de promouvoir les métiers des sciences et de l’ingénierie auprès des femmes. Après l’accueil qui leur a été réservé, elles ont pu rejoindre leur groupe composé de 2 lycéennes, 2 étudiantes de Polytech ainsi que de 2 marraines de l’association. Cette diversité au sein du groupe a été riche car cela a permis d’avoir une variété de points de vue. Elles ont disposé de 5h avec leur groupe pour « inventer l’industrie du futur ».
« Une journée très intéressante »
Les étapes du concours :
Pour autant cela n’a pas été si simple et le temps était élément à ne pas négliger. En effet, il fallait tout d’abord trouver un persona, c’est-à-dire une personne type à laquelle le produit ou service inventé par la suite allait convenir parfaitement, puis collecter un maximum d’idées pour ensuite sélectionner la meilleure, tester et améliorer le concept, avant de pouvoir finalement préparer le pitch pour convaincre le jury. Au bout de ces 5h, les sept groupes ont donc défilé devant le jury et les autres groupes. Elles avaient alors 10 minutes pour présenter leur projet et répondre aux questions d’un jury, composé de professionnels, ceux-ci exercent dans le milieu de l’ingénierie ou des ressources humaines.
L'oral pour convaincre
Lors de cet oral l’objectif était d’être le plus crédible, concis, cohérent et claire afin de convaincre au mieux. Chaque projet présenté était très différent les uns des autres et reposait sur des domaines divers et variés comme l’alimentation intelligente, la ville durable, la médecine du futur, les objets intelligents et connectés, l’école de demain, etc. Après délibération du jury, le groupe de Salomé Dilé (élève en terminale) a finalement remporté le prix coup de cœur et un second projet, « l’arbre à soucoupe », élu vainqueur ira disputer la finale à Paris le 31 mai 2023. Ce projet avait pour objectif de développer une ville durable à partir d’arbre avec des soucoupes au niveau des branches faisant office de bâtiments.
Une expérience riche
Ce challenge fut pour toutes les concurrentes une expérience très enrichissante qui leur a permis une approche sur le monde des sciences à l’échelle professionnelle comme le témoigne Anaëlle Boucher (élève en première) : « Une journée très intéressante qui permet de mieux visualiser les métiers d’ingénieurs avec certains projets que nous avons mis en place, c’est toujours un plus pour plus tard et ça reste une superbe expérience ! ». De plus, la confrontation à un jury tel que celui-ci apprend à défendre ses idées le plus justement possible. Finalement, ce challenge encourage les vocations scientifiques chez les filles tout en déconstruisant les stéréotypes.
Fleur Jolivet (13)
Avatar 2 : le film évènement !
Avatar, la voie de l'eau est le film tant attendu du grand public. Ce deuxième volet a suscité des avis divers et a partagé l'opinion publique.
Un film aimé
du grand public…
Avatar la voie de l’eau est la suite d’Avatar créé par le réalisateur américain James Cameron. Avatar 2 est sorti le 14 décembre 2022, ce long métrage de 3h12 est un film de science-fiction et d’aventure. C'est la suite du premier film qui raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie...
Après le succès considérable du premier film, James Cameron annonce en 2010 une suite, ce qui a attisé la curiosité des spectateurs. Ce film était très attendu du grand public de par l'ampleur de son budget, 350 millions de dollars, et par son synopsis. Le deuxième film fut également un succès considérable, il a dépassé les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde (selon lesechos.fr). Ce qui le classe à la quatrième place des films les plus vus au monde. Ce film a énormément plu grâce à son magnifique et unique univers, mais également grâce à l'incroyable performance cinématographique, mobilisantdes effets spéciaux toujours plus ambitieux.C'est enfin l'atmosphère familiale qui donne un côté touchant et complètement neuf à la saga.
… mais qui suscite
quelques critiques
Ce film a néanmoins soulevé quelques critiques. En effet, de nombreux spectateurs ont souligné certains thèmes évoqués dans le film. Par exemple, l'aspect environnemental qui a été dénigré, l'incitation à la violence... Pour certains, le film montrerait la folie destructrice de l'homme, son avidité et son égoïsme, ce qui était déjà présent dans le premier volet. Le film est vu comme visuellement impressionnant, son scénario croise les mentalités écologiques de notre époque. Le film montre le massacre d'une population aquatique par l'homme pour un seul objectif : l'argent. Certains pourtant restent déçus d'avoir attendu aussi longtemps un film pour un résultat aussi décevant !
Oriane (T3)
Les théâtreux s'initient à la mise en scène à Angers
Les secondes participent à la troisième édition du DESC, une expérience qui les tient en haleine !
Qu’est-ce que le DESC ?
Le Département d’Ecriture pour la Scène Contemporaine (DESC) a pour but de mettre en valeur de nouvelles pièces de théâtre et de nouveaux metteurs/metteuses en scène différent(e)s. Cet évènement, dont c'est la troisième édition, a été initié par les deux metteurs en scène Thomas Jolly et Damien Gabriac. Cette année, l'édition « ado » a permis à plusieurs classes du Maine-et-Loire de participer et voter pour leur pièce préférée. Le DESC a lieu au Quai, à Angers.
Une représentation privée et des débats houleux
Les secondes ont découvert cinq pièces de théâtre, aux thèmes complètement différents. Pour les guider, ils ont eu l’aide de trois comédiens qui sont venus au lycée pour lire des extraits de chaque pièce avec des intonations, pour réussir à s’imaginer ce que cela pourrait rendre sur scène. Un beau moment privilégié. Puis en février, ils ont débattu - non sans de sacrés désaccords - sur les cinq pièces et voté pour leur préférée. La pièce choisie par la troupe du lycée Saint Joseph est donc La Malédiction du Revenge, qui est une aventure inclusive de pirates anglais au XVIIIème siècle.
Sur les planches, comme des pros
Le 23 mars, les secondes ont été invités au Quai, afin de faire un projet de mini-spectacle sur leur pièce favorite. Il y avait un comédien avec le groupe afin d'aider à mettre en place le projet. En effet, ils ont constitué leur petit spectacle en plusieurs parties : une partie qui devait réfléchir à la disposition des décors, une partie qui devait réfléchir aux costumes, une partie qui devait faire une critique de la pièce et une partie best-of des meilleurs répliques de la pièce. Enfin, ils ont mis en scène deux scènes de la pièce La Malédiction du Revenge. Quand ils ont fini, les élèves ont présenté leur projet à deux autres classes qui ont aussi jouéles leurs sur deux pièces différentes. Cette journée était très enrichissante car ils ont appris à travailler sous « pression » et avec l’aide d’un comédien.
Bientôt la fin du suspense
Le résultat du vote se fera le 23 mai, lors d’une cérémonie pendant laquelle les secondes vont découvrir la pièce gagnante, son auteur(e) (pour le moment c'est un secret !) et une mise en scène exclusive.
Elisa Bieller (23)