
Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
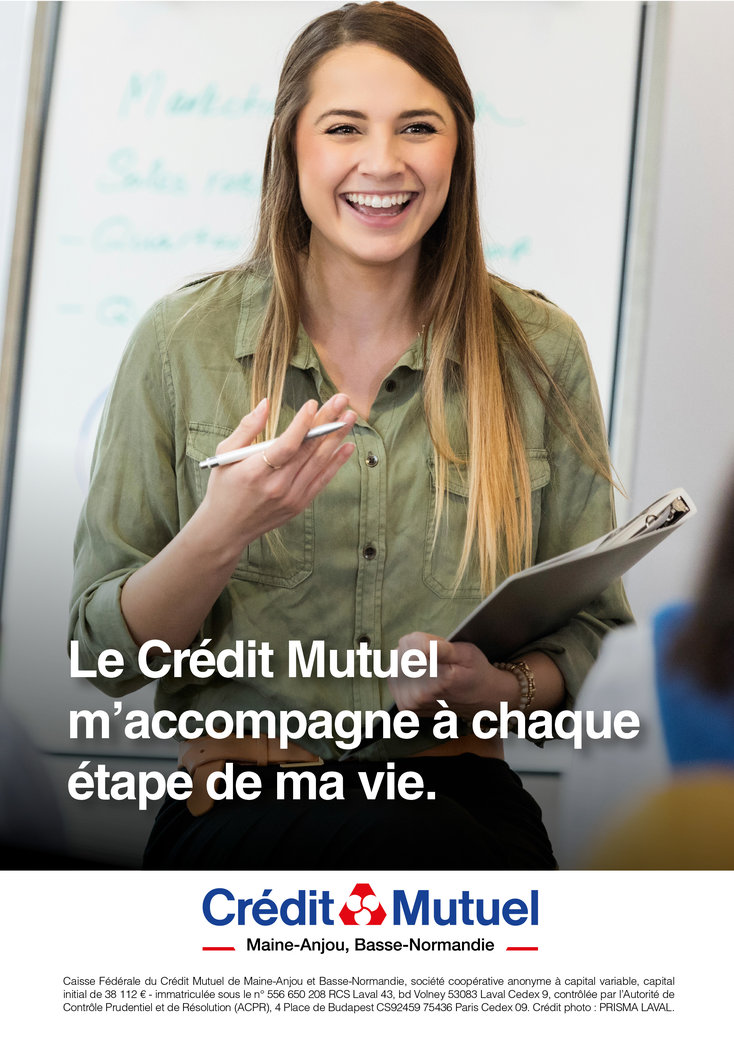
Éduquons aux mondes et aux autres
Pour que les jeunes s'engagent dans le respect des autres, la MFR défend l'Education aux mondes et aux autres (EMA).
Au-delà de la transmission de savoirs dans les cours théoriques et les mises en situation pour les aspects pratiques, confortées par l’alternance, les MFR ont une mission d’Education aux mondes et aux autres (EMA).
L’EMA regroupe de nombreuses thématiques autour du « vivre ensemble » (citoyenneté, interculturalité, etc.), du droit humain (éducation, santé, handicaps…), autour du thème de ce journal « environnement, climat » (transition écologique, biodiversité, ressources naturelles, eau…) et des modèles de consommation (économie sociale et solidaire, économie circulaire, alimentation et agriculture durable).
Sur le principe d’agir pour mieux comprendre et construire son savoir, chaque MFR sensibilise et invite les apprenants à s’engager sur des projets, grandeur nature. Plutôt que de proposer des projets construits pour les jeunes, la volonté est de mobiliser les apprenants de la réflexion jusqu’à la mise en place d’une action dans une stratégie de protection des valeurs et des causes défendues. Une façon de devenir consom’acteur : une arme efficace pour entrer dans la vie active. Vous découvrirez dans les pages de ce journal quelques cas concrets parmi une multitude d’actions réalisées dans chaque MFR.
Françoise COURTEILLE
Assistante de direction à la Fédération MFR
Temps forts dans le réseau des MFR
Rendez-vous pour les MFR de la Mayenne, lors des prochains temps forts du premier semestre 2025 :
Vendredi 17 et samedi 18 janvier 2025
Participation au Forum de l'Enseignement supérieur et des métiers à l'Espace Mayenne, à Laval.
Samedi 25 janvier (9h-17h), vendredi 21 mars (17h-20h) et samedi 22 mars 2025 (9h-13h)
Journées Portes ouvertes, dans toutes les MFR CFP de la Mayenne.
Mardi 6 mai 2025
Assemblée générale de la Fédération des MFR de la Mayenne, à la Maison des Agriculteurs, à Changé.
Jeudi 15 mai 2025
Journée sportive départementale des MFR 53, à Saint Berthevin.

Les maîtres de maison des MFR 53 formés sur la loi Egalim
Le 5 novembre dernier, des maîtres de maison des MFR de la Mayenne se sont réunis à la Pignerie pour un temps de formation afin de mieux comprendre les principales dispositions de la loi Egalim et leurs applications en restauration collective. Cette loi a été instaurée pour permettre une meilleure rémunération des producteurs de proximité en privilégiant les produits de qualité pour permettre une alimentation saine, sûre et durable.
La présentation du site gratuit EMApp a permis de découvrir une aide pour l’élaboration de menus en respectant les règles nutritionnelles, tout en répondant aux obligations règlementaires, en veillant à la gestion de la saisonnalité et en favorisant l’approvisionnement de proximité.
La formation a permis également de conforter les pratiques de chacun pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un atelier pratique en cuisine permettait de concocter un menu et de concrétiser les acquis théoriques. Les membres du Conseil d’administration de la Fédération, réunis ce même jour, à la Pignerie ont pu apprécier le repas préparé.
Françoise COURTEILLE
Assistante de direction à la Fédération MFR
Se former, durablement
Trois questions à...
Valérie Lelièvre, de L’Huisserie (53), et Ludovic Jarry, de Marsac-sur-Don (44), en formation Chargé de Projet Énergie et Bâtiment Durables, depuis 4 novembre 2024.
Vous vous orientez vers quel secteur professionnel ?
Valérie : Je vais intégrer l’association SOLIHA à Laval pour contribuer à l’amélioration de l'habitat des propriétaires occupants et bailleurs.
Ludovic : J'espère pouvoir intégrer un bureau d'étude thermique dans l'agglomération nantaise.
En quoi ceci est-il lié au développement durable ?
Valérie : L’objectif est d’informer et de sensibiliser les citoyens sur les possibilités d’effectuer la rénovation de leurs logements : améliorer le confort et faire des économies d’énergie.
Ludovic : Je voudrais pouvoir participer à l'efficience de nos constructions représentant plus de 40 % de notre consommation d'énergie en France.
Au quotidien, quelles actions faites-vous ?
Valérie : En famille, nous pratiquons le tri des déchets, nous sommes vigilants sur les consommations d’eau et d'énergie. Au niveau alimentaire, je privilégie les circuits courts.
Ludovic : Diminuer nos consomations d’énergie, réparer avant de jeter… Des petits gestes simples, pour plus d'économies ! Je vous conseille aussi de vous autoévaluer avec « nosgestesclimat.fr ». A vous de jouer !
Valérie Lelièvre
et Ludovic Jarry
Des plantations pour les futurs professionnels du paysage
Avec notre groupe, nous débutons une formation Ouvrier Paysagiste ou Technicien Jardin Espace Paysager, rythmée par des parties théoriques et la pratique sur terrain. C'est d'ailleurs la période de plantation des végétaux. .
Un projet concret
La commune de Port-Brillet souhaite planter des végétaux afin d’intégrer sa nouvelle structure d'ombrières solaires. Ces brises-vues végétaux s’inspirent du contexte : nous plantons des essences que nous trouvons dans les forêts environnantes pour créer de la continuité avec le bois à l’arrière de la structure. Nous intégrons des arbres de haut jet et des arbustes de bourrage ou en cépée. Ces strates arborées et arbustives composent un brise vue dense.
Nous utilisons une toile biodégradable qui évite que les adventices rentrent en compétition avec les végétaux plantés. Nous recouvrons cette toile avec du paillage en plaquettes de bois issues de la filière Mayenne Bois Énergie. Cela permet de conserver l’humidité dans le sol, de limiter les stress hydriques et, à terme, d’être composté afin de fournir les éléments nutritifs aux végétaux.
Ces chantiers nous permettent de rencontrer des partenaires professionnels du paysage. Nous allons reproduire cette approche sur le terrain quand nous allons aborder le fonctionnement du végétal et les techniques de taille qui suivent.
Le groupe OP / JEP
Une maintenance responsable
Tous les membres de la session Agents Maintenance du Bâtiment (AMB) 2024-2025 se mobilisent, dans une démarche écoresponsable, afin de réduire leurs déchets et l’impact sur l’environnement. Ils privilégient la revalorisation des matières premières, la réutilisation des matériaux et l’achat de matériaux locaux.
En menuiserie, le groupe a réalisé des bacs de tri sélectif. Ainsi, chacun participe à la gestion des déchets.
« Adopter un mode de vie durable aujourd’hui, c’est garantir une planète habitable et prospère pour les générations à venir. Agissons ensemble pour un avenir meilleur ! »
La session AMB 2024-2025
Du méteil pour nourrir les vaches
Le soja, légumineuse principalement utilisée dans l’alimentation des bovins, est très coûteux : 430 € la tonne, en octobre 2024, ce qui augmente le coût d’alimentation des animaux.
En plus de son prix, le soja a un coût environnemental élevé : il vient du Brésil principalement. Le transport en bateau provoque la pollution de l’air (gaz à effet de serre) et de l’eau des océans. On sait, par ailleurs, que la culture du soja participe à la destruction de la forêt tropicale, piège à CO2 et refuge de la biodiversité.
Du méteil
pour remplacer le soja ?
Il existe donc des alternatives au soja plus ou moins coûteuses. Le méteil en fait partie .
Le méteil est très intéressant, notamment car il est moins coûteux à produire, avec plus de rendement, et aussi car il diminuerait le coût de production et le coût d’alimentation.
e méteil est une culture qui contient des céréales : blé,orge, avoine et seigle, sorgho... et des légumineuses : pois fourrager ou encore féverole et vesce.
Il se sème entre le 15 octobre et le 10 novembre et se récolte de fin avril jusqu’au 15 mai, chaque année.
Il peut s’utiliser en ensilage et remplace le maïs. Il est très riche en énergie et en azote. S’il est utilisé seul, il peut remplacer une ration complète. S’il est utilisé avec du maïs, il est assez riche pour compléter une ration.
Si le méteil peut être très intéressant économiquement, il l'est aussi d'un point de vue environnemental.
Peut-être ne reste-t-il plus qu’à résonner tous les agriculteurs d’Europe ? En tout cas, la formation Technicien Entrepreneur Agricole (TEA) nous forme à ces démarches.
Yanis Treton, Théophile Sevin,
Corentin Montembault
et Nathan Bridier
Groupe TEA1
Vincent, cuisinier éco-responsable
Quatre élèves ont rencontré Vincent Besnier, maître de maison à la MFR depuis 7 ans.
Interview
Quel a été votre parcours et quelles sont vos missions ?
Je suis arrivé à la MFR en 2017, en tant que maître de maison. Avant cela, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la restauration d'entreprise. Mes missions sont toutes en lien avec la restauration : établir les menus en tenant compte des allergies ou intolérances alimentaires, passer les commandes aux fournisseurs en essayant d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix, en accord avec la directrice Karine Bougeard, prévoir le bon nombre de menus en fonction des absences, gérer l'aspect financier (coût par repas et par élève), gérer les déchets… Des fonctions diverses et variées.
Avez-vous une journée type ?
Je travaille de 7h30 à 16h30 et le rituel est toujours un peu le même. Généralement, je passe mes commandes le lundi, je gère tout l'aspect administratif le mardi…
Avec quels fournisseurs travaillez-vous ?
Je travaille essentiellement avec des entreprises locales : Mayon'court, la Légumerie 53, la SIRF, Pro à pro frais, Maine fruits… mais aussi les deux boulangeries de Craon et la ferme Colas. J'essaie de privilégier au maximum les circuits courts. Ensuite, tout est cuisiné à la MFR, c'est essentiel pour moi.
Pouvez-vous expliquer le principe de tri des déchets mis en place à la MFR ?
Après chaque repas, les élèves de service trient les déchets recyclables (du type pots de yaourt), les déchets alimentaires et le reste qui va directement à la poubelle. Sinon, au niveau de la MFR, les papiers et cartons sont triés pour aider à financer des voyages scolaires.
Comment réussissez-vous à éviter le gaspillage des produits ?
En effectuant un grammage par élève, en fonction des élèves qui mangent plus ou moins, on évite le gaspillage. Les restes sont réchauffés pour le lendemain ou réutilisés dans d'autres plats si le protocole d'hygiène est respecté.
Pensez-vous qu'il y ait encore des choses à améliorer ?
Bien sûr, rien n'est jamais parfait. Je suis ouvert à toute proposition, c'est pourquoi les élèves ont à leur disposition une boîte à idées pour me proposer de nouvelles choses.
Jade, Chloé, Léo et Lubin
Classe de 3ème
Tous à vos outils !
À Craon, les jeunes de la MFR ont agi avec les collectivités territoriales.
Témoignage
« Avec notre classe, et dans le cadre d'un EIE (Enseignement à l'initiative de l’établissement), nous avons réalisé un projet « plantation de haies ». Ce projet était en lien avec le territoire (associations, collectivités…). Nous avons choisi de replanter des haies au bord de l'Oudon, sur un sentier de randonnée à Craon. La MFR a créé un partenariat avec le syndicat du bassin de l'Oudon, la communauté de communes du Pays de Craon et la ville de Craon.
Créer du lien
avec les cours
Nous avons planté une centaine d'arbres et arbustes pour recréer un sentier arboré entre la voie verte et les jardins familiaux, voie de communication piétonne et cyclable entre le centre-ville de Craon et la voie verte Laval/Renazé.
Cette activité, en adéquation avec différents cours proposés à la MFR comme l'éducation socio-culturelle, la biologie-écologie mais aussi l'agronomie, nous a permis de découvrir le rôle des haies ainsi que leur entretien, découvrir la filière bois, régénérer la ripisylve (végétation en bord de cours d'eau…). Pour préparer l'activité, nous avons d'abord rencontré Charlotte Rebulard (Pays de Craon), Vincent Guillet (élu municipal) et Benjamin Creach (bassin de l'Oudon) qui sont venus présenter ce projet à la classe.
Différents groupes avaient été constitués avec une mission précise à mener, selon les différentes espèces à planter. Car le choix des espèces se devait d'être très large pour éviter la propagation de différentes maladies. Chaque groupe avait des objectifs précis tels que creuser, mettre en plant, mettre en protection…
Cette activité nous a permis de prendre conscience de l'importance de l'écologie et de la biodiversité dans une zone telle que le bassin de l'Oudon. Elle a aussi fait l'objet d'un CCF (Contrôle en cours de formation), épreuve orale comptant pour le bac. »
Juliette, Kenza, Pierre et Dany
Classe de Terminale
On avait tous la pomme !
Les élèves de l'option cuisine se sont transformés en petits ramasseurs de pommes.
Dans le cadre de l'option Cuisine et produits du terroir proposée aux élèves de 4ème et 3ème de notre établissement, Kenzo, Audran, Yohann et Théo sont partis à la recherche de pommes pour préparer des tartes aux... pommes ! Elles seront destinées à tous les élèves de la MFR de l'Oudon de Craon et à l'ESAT du Ponceau. Ces tartes aux pommes seront servies, pour le dessert du soir, aux classes présentes dans l'établissement.
Nos camarades ont aussi fait des affiches pour chaque saison, durant les cours de dévelopement durable, avec l'aide des autres élèves et de Marianne Helbert, leur monitrice. Ces affiches ont été accrochées dans le refectoire pour que tout le monde puisse y jeter un oeil, sur le temps du repas.
Ils sont également allés à la ferme du Pressoir, à Craon, pour goûter du jus de pommes et en ramener à la MFR pour le repas. Ce jus de pommes a accompagné un repas breton, avec crêpes et galettes. C'était un moment convivial que tous ont apprécié.
Sur ce temps fort, tous les élèves ont pu manger les pommes, directement à l'ESAT. Ils ont aussi pu goûter d'autres variantes de pommes, et se sont régalés.
C'est en fin de journée qu'ils ont pu manger leurs propres tartes aux pommes faîtes avec le chef cuisinier, Samuel Moyon, maître de maison de notre établissement. Ils étaient fiers de leur travail.
Kenzo, Audran, Yohan et Théo
Elèves de 4ème
Ça coule de source pas loin de l'Oudon !
Pour son travail mené sur l'eau, la Maison familiale rurale de l'Oudon a obtenu le label éco-école, en juin 2024.
L’année dernière, la MFR de l’Oudon, à Craon, et plus particulièrement la classe de première SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) a œuvré pour que notre maison et nos apprenants deviennent plus respectueux de l’environnement, à travers une démarche d’engagement écocitoyen. « J’ai pu découvrir de nombreuses choses sur le développement durable ou l’écologie », relève Yanis, élève de la classe de première SAPAT.
Car ensemble, les élèves ont pu participer à une collecte de déchets, une visite de station de potabilisation. « Nous avons créé des affiches de sensibilisation, participé à une dégustation d’eaux à l’aveugle, une veillée peinture végétale, reprend Yanis. Et nous avons même mis en place un projet territorial avec une école dans mon groupe. »
Et Telyo, un des deux éco-délégués, notamment présent lors des comités réalisés avec les partenaires, élus, équipes et élèves, d'ajouter : « J’ai beaucoup aimé mon expérience d’éco délégué, cela m’a apporté beaucoup. J’ai pu avoir un œil plus critique sur ma façon d’agir. Je me pose beaucoup plus de questions sur mon quotidien et mes actes. Cela m’a permis d’évoluer et d’être beaucoup plus éco responsable aujourd’hui. »
Un label couleur argent
« Tout cela nous a permis d’avoir des connaissances sur le développement durable et nos impacts sur l’environnement. L’obtention du label argent éco-école a été une joie pour ma classe, grâce à notre investissement et le travail mené durant l’année », se félicite Yanis.
C’est ainsi qu’en juin 2024, la MFR de l’Oudon a reçu, pour sa première année, la labélisation éco-école, qui permet de valoriser un projet commun d’éducation au développement durable en mobilisant plusieurs acteurs sur un territoire. Et si l'an passé, la MFR de l'Oudon avait travaillé sur le thème de la sauvegarde et de la protection de l’eau, cette année, c’est au tour de l’alimentation de se placer au cœur de notre démarche, tout en pérennisant les actions menées précédemment.
Yanis et Télyo
1ère BacPro SAPAT
Et si vous faisiez vos propres produits ménagers ?
Dans le cadre de la formation Entretien du cadre de vie auprès de l’association ADMR (Aide à domicile en milieu rural), la MFR propose des ateliers de fabrication de produits ménagers pour la maison. Le projet permet de répondre aux préoccupations du public et également de sensibiliser les apprenants aux impacts économiques, écologiques et environnementaux. Cela permet de réfléchir aux pratiques, à la gestion des déchets, tout en encourageant la satisfaction de faire soi-même.Vous souhaitez vous aussi réaliser votre nettoyant multi-usage ?
Voici la recette :
Dans un litre d'eau chaude, diluer dans un premier temps 4 cuillières à soupe de bicarbonate de soude, puis ajouter simplement 8 cuillières à soupe de vinaigre blanc et 20 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse.
Pour finir, verser le mélange dans une bouteille ou un vaporisateur.
Et voilà ! Ce produit sera efficace pour faire briller les surfaces en tout genre !
Véronique et Clémence
Agent de restauration et monitrice
Méthanisation : une solution d'avenir ?
Qu'est-ce que la méthanisation ? Explications avec les élèves de Terminale Agroéquipement de la MFR de la Pignerie.
La méthanisation est un processus biologique naturel qui décompose des matières organiques (déchets agricoles, alimentaires ou urbains). Le biogaz produit est purifié en biométhane, utilisé pour générer de l’électricité, de la chaleur ou être injecté dans le réseau. Le digestat, un sous-produit riche en nutriments, remplace les engrais chimiques.
Cependant, bien que le processus ait beaucoup de sens, la mise en place d’une unité de méthanisation est complexe et coûteuse. Ce type de projet peut nécessiter plusieurs années, du fait des études de faisabilité, des démarches administratives et des financements.
Le pour et le contre
Dans le cadre d'un projet, nous avons étudié l’une des plus grandes unités de méthanisation d’Europe, située à proximité de Laval, ce qui a permis de comprendre les enjeux techniques et logistiques, à savoir la gestion des flux de déchets, le transport du digestat et les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Nous avons réfléchi aux impacts pour les riverains : les nuisances olfactives, ainsi que le bruit des machines représentent des désagréments. Ainsi, il est crucial de choisir un emplacement éloigné des habitations !
Le transport des différentes matières constitue un défi supplémentaire, car il génère des nuisances sonores et une usure accrue des routes. Une mauvaise gestion des installations peut aussi entraîner des fuites de biogaz ou des pollutions des sols et des nappes phréatiques. Ces unités doivent donc respecter des normes strictes pour éviter de tels incidents.
Malgré ces défis, nous avons relevé de nombreux avantages économiques et environnementaux : les agriculteurs peuvent valoriser leurs déchets organiques, diversifier leurs revenus et réduire l’usage d’engrais chimiques.
Ce projet nous a permis de saisir les enjeux techniques, économiques et sociaux de la méthanisation. Nous avons été sensibles à l’importance de l’équilibre entre les coûts de production et la rentabilité, tout en prenant en compte les impacts pour les riverains et l’environnement.
La Terminale Agroéquipement
Silence, ça glousse !
À la MFR de la Pignerie, des poules et des moutons participent à l’écologie.
Dès l’arrivée à la MFR, les moutons nous accueillent...
Depuis 2021, le projet d'initiatives de communication mené par les BTS GDEA (gestion des équipements agricoles) a permis l’accueil de moutons dans une pâture. Cela vise à un entretien écoresponsable. May’Pature, partenaire du projet, gère les moutons et les étudiants sont responsables de leur environnement. Un projet bénéfique puisque son coût est équivalent à celui d’un entretien manuel, bien plus polluant. De plus, nos tondeuses sur pattes font peu de bruit : conflit de voisinage évité.
Quant aux poules…
Dans une démarche d'être un établissement écoresponsable, une autre idée de projet a émergé à la suite du visionnage du film Les givrés. Un poulailler a donc été créé, en début d’année 2024. Aujourd’hui, l’intégralité des déchets biodégradables de la cuisine est valorisée au poulailler et au composteur. Les œufs sont vendus aux salariés, ce qui produit un cercle vertueux.
Dans la continuité de ce projet, la cuisine souhaite installer un chariot de tri, afin que les apprenants deviennent des acteurs face aux enjeux environnementaux.
Cassandra, Alexandra, Lucas,
Pauline, Eva, Kim,
Cécile et Salomé
BTS Économie Sociale Familiale
« Les moteurs thermiques sont en voie d'extinction »
Chaque année, les matériels à batterie se développent de plus en plus pour le futur. Comment la MFR s’adapte-t-elle ?
La transition climatique est au cœur de tous les secteurs d’activité et le monde des paysagistes n’y échappe pas. En témoignent les questionnements au sujet de la pollution dégagée par les outils thermiques. En effet, les moteurs thermiques offrent de nombreux avantages : autonomie, durabilité, efficacité... Les professionnels se posent donc beaucoup de questions : durabilité du matériel, autonomie, poids, entretien, puissance, batterie, carte mère...
Mais qu'en est-il à la MFR de Pré-en-Pail ?
La MFR de Pré-En-Pail dispose de plus en plus de matériels à batterie comme des sécateurs, des tronçonneuses...Guillaume Faucon, moniteur technique à la MFR de Pré-en-Pail, l'annonce :« Les moteurs thermiques sont en voie d’extinction. Les ressources utilisées vont diminuer dans le temps. Le thermique est extrêmement polluant. La majorité des états se dirigent vers l’électrique. En plus, les matériels à batterie sont plus légers et plus écologiques. » Le passage à l'électrique est donc pour demain ? « Les appareils à batterie ne sont pas aussi performants que les appareils thermiques, contraste Guillaume Faucon. Ils ont moins d'autonomie, ce qui, pour un professionnel, est contraignant. Imaginez que vous tombiez en panne pendant un chantier ! Que dire aux clients ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir avant que l'électrique ne prenne le pas sur le thermique. »
Après avoir interrogé G.Faucon, le doute persiste. L’électrique ne semble donc pas encore répondre au attente des professionnels... Quand l’électrique sera t-il au point ?
Les 2nde NJPF et CPH
De nouvelles locataires à la MFR
À la MFR de Pré-en-Pail, une installation de ruches est en projet. Mais comment faire pour accueillir au mieux ces nouvelles amies ?
Entretien
Eva Schneider, Anaïs Rioult et Sören Lechat, moniteurs à la MFR et dirigeants du projet.
Qui mène ce projet de ruches ?
Ce sont les élèves de BP AP1 (Brevet professionnel aménagements paysagers 1ère année) qui ont eu l’idée d'installer des ruches, à la MFR. Ils sont accompagnés par trois moniteurs. Le projet est également soutenu par la Fédération des Maisons familiales rurales des Pays-de-la-Loire, dans le cadre du Projet Jeunesse, financé par le programme ERASMUS+. Le projet répondra à un ou plusieurs objectifs sur le développement durable. L’installation des ruches améliorera la biodiversité au sein de l’établissement.
Quel en est le coût ? Cela en vaut-il la peine ?
Les ruches ont été installées, durant la semaine du 18 novembre 2024, par un apiculteur. De leur côté, les apprentis, organisateurs du projet, ont mis en place des clôtures autour de ces ruches. C’est principalement l’apiculteur qui s’occupe des ruches. Elles sont installées dans un lieu stratégique. Le coût du projet est d’environ 1000 €, ce qui est un coût certain mais l’installation des ruches améliorera la biodiversité au sein de l’établissement, ce qui aidera à la pollinisation. De plus, du miel pourra être récolté pour la vente, afin de permettre le financement d’un séjour pédagogique pour les apprentis, et pourra servir en cuisine.
L’un des principaux avantages de la MFR est son milieu naturel, avec une végétation variée, plantée par des élèves suivant des formations proposées au sein de l’établissement. La MFR de Pré-en-Pail est donc le lieu d’accueil idéal pour les abeilles. Espérons que ce projet inspire d’autres MFR !
Propos reccueillis par les élèves de Seconde NJPF et CPH
Les ours polaires en péril
Les plantigrades de l'Arctique sont devenus un symbole des espèces menacées. Zoom sur ces animaux en danger de disparition.
Actuellement, environ 26 000 ours polaires vivent dans le monde, dont 16 000 au Canada. Le réchauffement climatique constitue la principale menace pour ces animaux. Avec la fonte des glaces, leur milieu naturel disparait progressivement. Cela réduit aussi la superficie de leurs terrains de chasse, rendant plus difficile la recherche de nourriture.
La France participe
à leur sauvegarde
La surface de leur habitat estival pourrait se réduire de plus de 40 %, d’ici le milieu du 21e siècle, ce qui impacterait sévèrement la population. La disparition de deux tiers des ours blancs est à craindre d'ici 2050. Il est donc urgent d’identifier et de protéger les zones clés de leur habitat, comme les aires de nourrissage, les tanières et les routes migratoires. La conservation de l'espèce passe également par des programmes internationaux.
Flocke et Raspoutine, deux ours polaires, ont ainsi été accueillis au Marineland d’Antibes (Alpes Maritimes), en 2010, dans le cadre du programme européen d'élevage des espèces menacées. Dans un espace adapté et spécialement créé pour eux, ils ont donné naissance à une oursonne nommée Hope, en 2014. Devenue adulte, elle a pu rejoindre d’autres ours blancs à Orsa Rovdjurspark, une réserve animalière suédoise.
En 2019, Flocke, âgée de 13 ans, a mis au monde une portée de trois bébés ours, deux mâles et une femelle. Une magnifique réussite et un formidable espoir pour la sauvegarde de cette espèce menacée.
Ilan, Noah, Ewen et Yann
Crise climatique : l’agriculture mayennaise impactée
Le changement climatique impacte-t-il l'agriculture locale ? Réponse avec M. Leprêtre, moniteur en matières techniques et agricoles.
Entretien
Quels sont les effets du changement climatique sur les terres agricoles et les animaux ?
Pour les terres, les fortes pluies entraînent l’érosion des sols, qui se dégradent. Cela provoque un lessivage des nutriments et donc une pollution des rivières par effet de ruissellement.
Les animaux, eux, souffrent de la chaleur. Pour y pallier, les agriculteurs installent parfois des ventilateurs dans les bâtiments. Ce qui augmente leurs coûts énergétiques de façon significative.
Comment évoluent les récoltes avec les changements climatiques ?
La vraie difficulté vient d’une perturbation du cycle de l’eau. Si le maïs a besoin d’eau, les sols détrempés rendent le travail dans les champs difficile.
De plus, on note une baisse des rendements due à trop d’eau sur la saison, notamment sur les semis et les récoltes. Les rendements ont diminué de 80 à 50 quintaux par hectare.
Observe-t-on une évolution des maladies due au dérèglement du climat ?
Le climat mayennais, humide et doux, permet le développement important de champignons sur les végétaux. Les récoltes sont également attaquées par des ravageurs venus d’autres régions, qui se déplacent en fonction du climat.
Par ailleurs, en période sèche, les vaches laitières se regroupent à l’ombre, provoquant une plus forte pression sanitaire sur le troupeau.
Propos recueillis par Chloé, Romane, Théo,
Manon et Marin
Elèves en 1ère TCVA
(Technicien conseil
vente en alimentation)


























