
Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Tous unis contre le harcèlement
Paris, mon amour
Nous sommes le 13 novembre 2015. La soirée s'annonce radieuse pour un mois de novembre. La météo a décidé de faire une faveur à la capitale, il fait bon, les terrasses parisiennes sont pleines. Au stade de France, la Marseillaise retentit, l'équipe de Didier Deschamps reçoit l'équipe d'Allemagne. Au Bataclan, le groupe Eagles of Death Metal accorde pour la dernière fois ses guitares avant de retrouver ses fans dans la salle qui est pleine. Paris est Paris, elle brille dans la nuit. Ce vendredi est un vendredi normal dans les rues de Paname, les gens sont heureux, se retrouvent entre amis autour d'un verre, d'un concert ou d'un match. Pourtant, ce vendredi de 2015 restera à jamais marqué dans l'esprit des français. Il est non loin de 22 heures quand les premières alertes tombent dans les rédactions. Une fusillade en cours dans une rue de Paris, puis une deuxième, puis au fil des minutes, les rues de Paris défilent sur les écrans. On relate également une explosion près du Stade de France. C'est le choc pour tous les Français. Dans les rues parisiennes, la panique règne, les pompiers reçoivent des centaines d'appels, des gens accueillent les blessés, chez eux, à même le sol. Pendant ce temps, on apprend qu'une prise d'otage est en cours au Bataclan. Les Français découvrent des images lointaines, les policiers ont bouclés le secteur, le RAID est sur place. L'assaut est donné aux alentours de minuit. Le cauchemar semble fini mais vient en réalité seulement de commencer. Durant la nuit, les dépêches tombent, actualisant au fil des heures le nombre de décès. Paris se réveille avec la gueule de bois. Les yeux du monde sont tournés vers la capitale de la liberté, les hommages affluent. Pour la première fois, la ville lumière s'est éteinte dans la nuit. "Fluctuat Nec Mergitur".
La rédaction de Franklin's

| N° 2 - Décembre 2020 | www.lyceefranklinauray.fr |
Bientôt, tous en bleu contre le harcèlement*
Rencontres - À Benjamin Franklin, les Ambassadeurs aident les gens harcelés.
Les ambassadeurs, c'est quoi ?
Les Ambassadeurs sont un groupe de personnes formé pour accompagner les élèves harcelés ou les élèves harceleurs. L'intervention des Ambassadeurs ne nécessite pas automatiquement celle des adultes du lycée. L'association a été crée en 2018 par un élève de première, Titouan Falc'hun, aujourd'hui parti du lycée. Cette année, treize personnes constituent l'équipe.
Quelles mesures au sein du lycée ?
Dans l'année, une journée sera organisée au lycée avec pour but de remplir le lycée de la couleur bleue. Vêtements, décoration, nourriture au self, tout le lycée sera paré de bleu.
Un studio photo va être mis en place pour montrer l'union des personnes.
En outre, des interventions seront menées dans les classes, quand la situation sanitaire sera plus clémente, pour sensibiliser et parler de ce qu'est le harcèlement.
Et évidemment, les ambassadeurs sont là pour aider les élèves harcélés.
Témoignage d'une membre de l'association.
Maëlys, membre depuis 2018, nous a confié pourquoi elle a choisi de s'engager dans l'association "J'ai voulu m'engager dans l'association car je trouve cela important d'aider les personnes qui en ont besoin. Cette association me semblait être très importante pour le lycée. C'est pour cela que je me suis engagée dès le départ dans l'aventure. Mon principal rôle dans l'association cette année est la communication entre le personnel et les élèves. Je suis ravie de faire partie de ce groupe soudé autour d'un même objectif : aider les gens."
Témoignage d'un ancien harceleur.
Nous avons interrogé un ancien élève de BF, qui a été durant ses années au collège dans un groupe de harceleurs. Il a accepté de témoigner afin de partager son expérience en matière de harcèlement. « Si je devais définir mon comportement, je dirais que j'ai volontairement humilié quelqu'un publiquement. J'avais très peu conscience des conséquences. Je savais que c'était mal mais la volonté de vouloir rejoindre la mouvance du groupe était plus forte je pense. » M. s’est arrêté en 5eme, « j’avais d’autres choses à faire mais je ne me rendais pas compte à ce moment là de mes actes. Je fermais les yeux, je n’y prêtais pas attention et à cette époque, je me voyais mal condamner les actes que j’ai pu moi même effectuer. »
Aujourd’hui, M. regrette bien sûr ses agissements, d’autant plus qu’ils ont eu de graves conséquences sur la victime. « Je ne pense pas que sensibiliser davantage les étudiants soit la meilleure des solutions, du moins pas comme actuellement où on continue de dire que harceler c’est mal et qu’il faut être gentil mais plus dans le sens où si on est harcelé il faut en parler et l’école est là pour accompagner. » Quant à l’action des ambassadeurs, il pense qu’il serait bon de créer ce genre de groupe avec ce genre d’actions dans les collèges, afin d’agir auprès des plus jeunes parce que « au lycée je trouve qu’on a quand même plus de facilité à parler aux adultes, ce qui n’est pas forcément le cas au collège. »
Quelles mesures à l'échelle nationale pour lutter contre le harcèlement ?
Le journal Le Monde a relaté les faits à l'échelle nationale le 14 octobre dernier. Il nous apprend que l'Education nationale a décidé d'agir et c'est ainsi que le 13 octobre, le député du Finistère Erwan Balanant (MoDem) a remis les conclusions de son rapport Comprendre et combattre le harcèlement scolaire aux ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et de la Justice Éric Dupont-Moretti. Le rapport fait un constat : les violences continuent. Le député propose d'aller voir ce qu'il se passe devant les écoles ou derrière les écrans, car le harcèlement n'est plus seulement en réel. Pour toucher et montrer l'urgence de la situation, il relève que « un quart des victimes a déjà envisagé le suicide. Il n'est malheureusement pas rare qu'elles franchissent le pas. ». Selon les enseignants, 700 000 élèves sont harcelés chaque année.
Le harcèlement n'est plus exercé uniquement par les élèves, mais aussi directement ou indirectement par les enseignants. Le sujet est tabou dans les salles des professeurs. Le papa d'Evaëlle, collégienne de 11 ans qui s'est suicidée en 2019 dans le Val-d'Oise, témoigne dans le rapport. Suite à l'enquête, une enseignante a été mise en examen.
Le député propose de créer une loi, où le harcèlement scolaire deviendrait un délit condamné au maximum de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende avec une prise en charge psychologique.
Vous êtes victime de harcèlement
Vous n'êtes pas seuls, une plateforme téléphonique a été mise en place, "NON AU HARCELEMENT" au 3020 (appel gratuit), des professionnels vous répondront du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.
Au lycée, vous pouvez contacter les ambassadeurs sur Instagram ambassadeurs_bf ou par mail ambassadeurs.bf@gmail.com.
*à l'heure où nous écrivons ces lignes, une nouvelle date n'a pas encore été fixée.
Margot C., Lucile G., Donatien C.T01, T07, T04
Vêtements & environnement, une avancée au lycée
Pour atteindre les objectifs de production importants engendrés par l’essor de la surconsommation, les marques usent de moyens certes efficaces mais néfastes pour l'environnement. A nous, consommateurs, d'agir aujourd'hui.
La production : une phase destructrice
Entre émissions de CO2 et surconsommation d'eau, la production des textiles d’habillement est loin d’être exemplaire. Selon WWF, 1,7 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année par cette industrie, soit plus que le trafic maritime et les vols internationaux réunis. Nos vêtements sont aussi très gourmands en eau, qui sert aux teintures et produits de traitement. D’après un rapport des Nations Unies, il faut 7500 litres d’eau pour la fabrication d’un jean, ce qui représente en moyenne la quantité d’eau bue par une personne en 7 ans. Cette eau devient alors vectrice des produits chimiques vers la nature, à son tour polluée.
Et ça ne s'arrête pas après l'achat
Aujourd’hui, les fibres synthétiques sont massivement utilisées dans la conception de vêtements. Mais lors de leur lavage en machine, des microparticules de plastique s’échappent, et alimentent les quelque 8 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année. Un vrai danger pour notre planète. En parallèle, le gaspillage vestimentaire se développe, allant de pair avec la montée de la « fast-fashion ». Ce phénomène récent se traduit par un renouvellement fréquent des collections par les marques pour créer des micro-tendances éphémères. Les vêtements proposés sont peu chers et de mauvaise qualité, car destinés à avoir une durée de vie réduite pour être ensuite oubliés et rapidement remplacés. Se normalise alors un gaspillage important chez les consommateurs.
Comment agir ?
En sachant que nous avons notre part de responsabilité dans ce système, il suffit de changer notre comportement en tant que consommateur en privilégiant certaines matières à d’autres, mais surtout, en apprenant à se raisonner au maximum. Éviter tout achat compulsif, essayer de réparer plutôt que de jeter, acheter moins mais mieux, donner une seconde vie à ses vêtements. sont autant de pistes que l’on peut suivre.
Une friperie gratuite au lycée
Lison, Maya et Justine, toutes les trois en terminale, ont décidé de lancer leur projet de ressourcerie au lycée afin de prendre action dans cette cause écologique. Dans l’optique de « donner sans prendre et prendre sans donner », le principe est de pouvoir offrir une seconde vie aux vêtements qui ne servent plus. Il est aussi bien possible de déposer que de récupérer, et cela dans un esprit solidaire. C'est un pas vers une consommation plus durable et respectueuse de la planète. Pour plus d'informations, voici leur compte instagram : @green__socks
Clara GARAUD
Partagez vos passions !
Échanges - Afin de vous connaître entre vous et peut-être tisser des liens, nous partageons vos talents ! Vous voulez partager votre passion ? Contactez-nous !
Ewan Saby
D’abord joueur pendant 5 ans, il a choisi cette année de se consacrer à sa passion : l’arbitrage.
Le jeune arbitre nous explique qu’il est encore en cours de formation, et a suivi un stage durant lequel il a passé un test d’aptitudes physiques et approfondi les règles au maximum « grâce à de nombreux modules », nous dévoile-t-il. Sa formation en poche, il arbitre désormais les rencontres de fin d’entraînement ainsi que des matchs officiels interclubs. Ewan nous confie qu’il « adore la sensation de neutralité » que lui procure l’arbitrage mais aussi le respect dans les conversations dans les clubs. « Au risque de passer pour un mégalo, j’aime avoir l’autorité, avoir raison, utiliser le sifflet et me balader en costard », nous confesse-t-il avec humour. En fin d’année, Ewan passera un examen pour être promu d’"arbitre en cours de formation" à stagiaire. Nous lui souhaitons bonne chance !
Kassy Nguyen
Sa passion c’est le dessin de style manga. Elle dessine un petit peu tous les jours.« Mais pour les dessins plus élaborés et en couleurs je dirais une fois par mois », indique-t-elle Pour elle, le plus important est de ne jamais se forcer. C’est pour cette raison qu’elle ne veut pas entamer d’études d'art. « Je n'aime pas qu'on me dise quoi dessiner », assure celle qui n’a jamais pris de cours. Ils peuvent être utiles mais ne sont pas obligatoires. On peut aussi regarder des tutos sur internet ». N'ayant pas d'artistes modèles, elle puise son inspiration dans ce qui l’entoure mais aussi sur Instagram. « D'autres gens qui font des Fanart ou des dessins manga comme moi ». Pour ses dessins, Kassy utilise le crayon à papier, "pour pouvoir dessiner partout". Elle utilise aussi des crayons de couleurs et parfois de la peinture. Elle s’est également essayée au dessin numérique (sur téléphone). Le conseil que Kassy donnerait à un débutant est le suivant : "Le meilleur moyen de progresser c'est de pratiquer souvent. Il ne faut pas avoir peur de rater : même si c'est moche au début on ne peut que progresser. C'est important d'observer les choses qui nous entourent pour mieux les retranscrire sur papier. Mais l'important c'est de s'amuser !" Si vous souhaitez jeter un coup d’œil au travail de Kassy, elle partage ses dessins sur son compte Instagram : @syssy.k Lucile G. et Margot C.
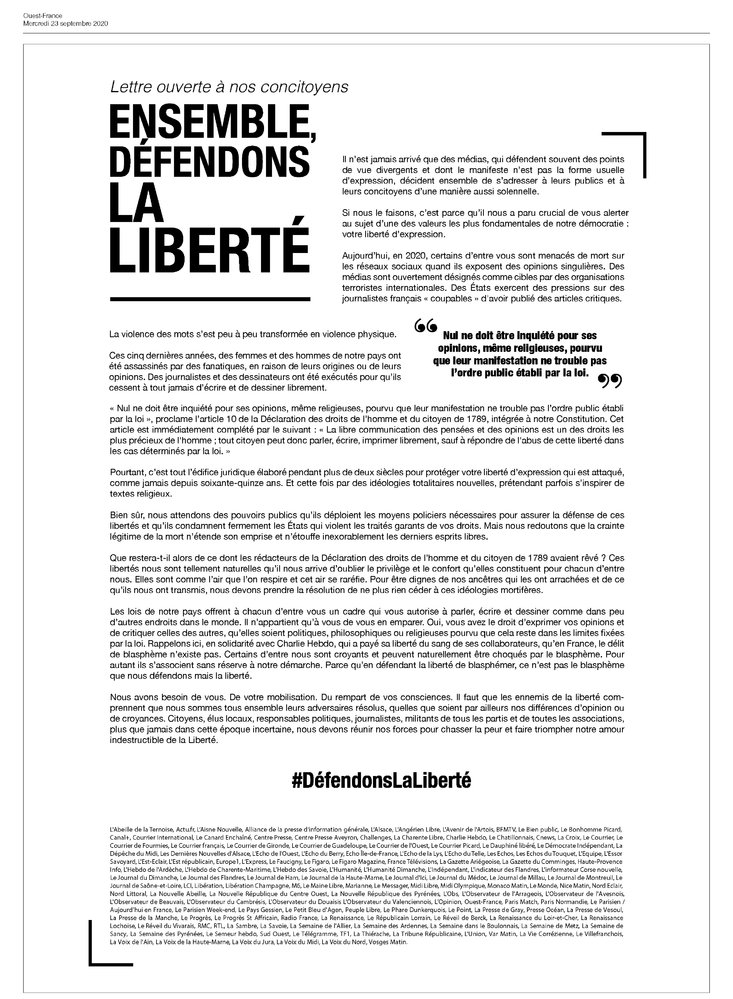

Quand la liberté d'expression est menacée
Le 16 octobre 2020, la liberté d’expression a été une nouvelle fois attaquée, cinq ans après l’attentat visant Charlie Hebdo. La France entière avait alors revendiqué le droit à la liberté d’expression, à coup de dessins et de « Je suis Charlie ». Ce droit étant toujours ménacé, des journalistes issus de 90 médias différents se sont alliés pour écrire une lettre ouverte, partagée dans notre journal à la page précédente.
Cette lettre ouverte, publiée le 23 septembre 2020, a été écrite lors du procès de l’attentat de Charlie Hebdo. Nous avons décidé, quelques semaines plus tard, lors de la conférence de rédaction de ce journal, de la partager dans ce numéro. L’atteinte à ce droit dénoncée dans cette lettre ouverte fait écho à l’assassinat de Samuel Paty. Ce professeur d’histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine a été décapité le 16 octobre dernier pour avoir enseigné la liberté d’expression. Dix jours plus tôt il avait en effet montré deux caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. L'une d'entre eux, qui était pourtant absente lors du cours, en a parlé à son père, qui a alors réalisé une vidéo attaquant le professeur. Cette vidéo s’est répandue sur les réseaux sociaux jusqu’à Abdoullakh Anzorov, qui a assassiné Samuel Paty, le 16 octobre.
Profondément émus par ce double crime, touchant à la fois Samuel Paty et la liberté d’expression, nous nous sommes rappelés de la lettre ouverte qui disait juste. La liberté d’expression est plus que jamais en danger et nous devons la protéger. C’est pourquoi nous vous appelons à lire attentivement la lettre ouverte, à continuer à exprimer vos opinions et à ne pas avoir peur de dire haut et fort ce que vous pensez.
La rédaction de Franklin's News
Simone Veil, la force d'une femme
13 juillet 1927 à Nice, Simone naît dans la famille juive des Jacob. En 1944, âgée de seulement 16 ans, elle est déportée au camp d’Auschwitz-Birkenau. C’est en avril 1945 qu’elle est libérée de l’horreur des camps, chance que n'ont pas eu ses parents et son frère. À Paris, elle est l’une des rares femmes de l’époque à se lancer dans des études de droit et sciences politiques. En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing la nomme ministre de la Santé. Le 17 janvier 1975, elle fait voter la loi Veil visant à dépénaliser l’IVG (interruption volontaire de grossesse), loi qu’elle a défendue devant une assemblée à 98 % masculine. À 52 ans, elle est la 1ère femme élue présidente du Conseil Européen. Après avoir été ministre d’État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, entre autres, elle fait son entrée à l’Académie française. Elle fait partie des "Immortels" et prend place au 13ᵉ fauteuil, antérieurement occupé par Jean Racine. Sur son épée d’académicienne, elle fait graver le numéro 78 651, qu’elle aura porté toute sa vie, tatoué sur son bras gauche. Le 30 juin 2017, Simone Veil s’éteint. Elle est inhumée au Panthéon aux côtés de son époux Antoine Veil, et devient la 5ᵉ femme à y entrer. Figure illustre, elle aura marqué les esprits par son intelligence et sa force de caractère à toute épreuve, et restera gravée dans l'Histoire Clara Garaud
Pologne : L'avortement quasi interdit
Le 22 octobre, le tribunal constitutionnel a décidé de pénaliser l'IVG, ce qui provoque une immense colère du peuple polonais.
Depuis le 30 octobre, de nombreuses manifestations sont organisées à Varsovie, réunissant des centaines de milliers de personnes, malgré les interdictions dues à la crise sanitaire. Des associations de défense des droits des femmes sont à l'origine de ce mouvement, suite à l'annonce du tribunal constitutionnel, soutenue par le parti ultra catholique Droit et Justice au pouvoir, de l'interdiction du recours à l'IVG en cas de malformation grave du fœtus, statuant qu'elle est incompatible avec la constitution.
Une fois publiée au journal officiel, la décision de la Cour constitutionnelle de Pologne aboutira à l'interdiction de tout avortement, excepté en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Les associations féministes s'insurgent.
Selon les chiffres officiels, il y aurait moins de 2 000 avortements légaux réalisés au sein du pays chaque année. Les associations féministes estiment de leur côté que plus de 200 000 avortements sont effectués illégalement sur le territoire national ou à l'étranger. Depuis le début des mouvements de contestation, la capitale polonaise est aussi spectatrice de grands affrontements entre protestataires et militants d'extrême droite.
Dans ce contexte de tensions politiques et de crise sanitaire, les forces de l'ordre ont été massivement déployées.
Pour le moment le peuple polonais ne peut pas crier victoire, mais depuis le 4 novembre dernier des discussions sont en cours au sein du gouvernement. La révolte des manifestants portera peut être ses fruits.
La situation actuelle dans le pays fait écho à d'autres exemples récents d'atteinte aux droits des femmes et nous rappelle cette citation de Simone de Beauvoir :
"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en questions. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant."
Lilia LE GALLIC.
P07
Joe Biden : grand vainqueur
Le 3 novembre, après 4 jours de longue attente, Joe Biden a remporté l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump, avec 51 % des voix.
Qui sont Joe Biden et sa vice présidente Kamala Harris ?
Joe Biden est un sénateur américain. Il vient d’être élu, à 77 ans, le 46ème président des États-Unis. Il a notamment été le vice-président de Barack Obama dans le passé, ce qui lui procure une certaine légitimité pour assumer aujourd’hui ses nouvelles responsabilités.
Le 7 novembre, Joe Biden a résumé les grands principes de la politique qu’il prévoit de mener :
« Les Américains nous ont appelés à rassembler les forces de la décence et les forces de l’équité. Rassembler les forces de la science et les forces de l’espérance dans les grandes batailles de notre temps. La bataille pour contrôler le virus. La bataille pour construire la prospérité. La bataille pour garantir les soins de santé de votre famille. La bataille pour obtenir la justice raciale et éradiquer le racisme systémique dans ce pays. La bataille pour sauver le climat. La bataille pour restaurer la décence, défendre la démocratie et donner à tout le monde dans ce pays une chance équitable. »
Un changement radical avec les idées conservatrices que défendait son prédécesseur.
Sa colistière se nomme Kamala Harris. Née en Californie d’une mère indienne et d’un père jamaïcain, elle est la première femme de couleur a occuper le poste de vice-présidente. Cet événement exceptionnel dans l’histoire des États-Unis marque le début d’une nouvelle génération de femmes qui osent dorénavant assumer haut et fort leurs ambitions : « Je suis la première mais certainement pas la dernière » décrète-t-elle avec espoir lors de son discours le 8 novembre. Elle s’adresse également aux jeunes filles en les encourageant à se faire confiance même si la société cherche constamment à les rabaisser. La nouvelle vice-présidente rend également hommage aux nombreuses femmes de couleur. Personne ne l’avait jamais fait auparavant.Les tensions suite aux résultats
Beaucoup de votes par correspondance ont été effectués, à cause du contexte de crise sanitaire, ce qui constitue une « fraude » selon les contestataires de l’issue des élections, les républicains, niant la défaite de leur candidat .En effet, Joe Biden ne commencera à diriger les États-Unis qu’à partir du 20 janvier mais, avant cela, il doit partager le pouvoir avec le président sortant, Donald Trump. Seulement cette période de transition s’avère très compliquée puisque Donald Trump conteste avec véhémence lui aussi les résultats des élections. Notamment sur Twitter, où il a fini par être censuré.
Malgré cela, Joe Biden prendra bien la tête des Etats-Unis fin janvier, annonçant de nombreux changements à venir.
Marianne RAULTT05
Trump et la Covid-19 : Un virus sous-estimé
La Crise en Général :
En janvier 2020, les États-Unis sont touchés par la Covid-19 et deviennent l'un des pays les plus atteints par la pandémie avec l'Inde et le Brésil. Chaque jour, le pays recense plus de 120 000 cas et compte actuellement environ 15 millions de cas et 283 835 morts (le 7 décembre 2020) , selon le Monde. Malgré ces chiffres plus qu'alarmants, Trump avait montré à plusieurs reprises un manque de volonté pour la lutte contre le virus.
Un président qui sous-estime le virus :
En effet, en février dernier, Trump avait suggéré que le virus disparaitrait lorsque l'été arriverait. De plus, on peut voir dans de nombreux clichés, son refus de porter le masque car Trump se vantait d'être immunisé au Covid-19. Il fut infecté par le virus début octobre, comme sa femme. Cette sous-estimation du virus va de pair avec le manque de moyen mis en place pour la lutte contre le virus de la part de Trump, obligeant les états fédérés à lutter sans l'aide du gouvernement fédéral.
Le vaccin : Un allié pour sa campagne
Il fit de cette lutte et de l'élaboration du vaccin contre la Covid-19, un enjeu majeur de sa campagne en promettant qu'il serait prêt pour début novembre. Trump a utilisé cet enjeu sanitaire pour tenter de remporter les présidentielles.
Arnaud PEDRAZZANI
T02
Les États-Unis divisés entre progressistes et conservateurs
L’élection présidentielle américaine, très médiatisée, a ravivé les tensions entre les progressistes et les conservateurs, divisant plus que jamais les États-Unis. Même si on retrouve dans le monde entier des conservateurs et des progressistes, la démarcation entre les deux est bien plus forte aux États-Unis qu’ailleurs.
Les conservateurs, souvent républicains, et les progressistes, majoritairement démocrates, ont des avis très opposés sur des sujets comme l'immigration ou l'avortement. La différence entre les progressistes et les conservateurs est avant tout politique, mais aussi géographique et culturelle. En effet, on remarque que les villes sont surtout progressistes tandis que les campagnes sont conservatrices. Beaucoup d'états sont également soit démocrates, soit républicains. Ainsi les Américains n’ont pas beaucoup l’occasion de discuter avec des personnes ayant des opinions différentes d’eux.
Le clivage entre les conservateurs et les progressistes aux États-Unis a toujours existé, mais il est bien plus visible ces derniers mois, notamment depuis l'élection présidentielle, mais aussi lors de la réémergence du mouvement Black Lives Matter, progressiste, ou celui pro-life, conservateur. Donald Trump joue de cette division pour mettre de son côté tous les conservateurs. Joe Biden, au contraire, a déclaré lors de son discours le 7 novembre 2020 : « Je m’engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Qui ne voit pas les États rouges et bleus, mais les États-Unis. » La division étant déjà très marquée, la réunification promise par Joe Biden risque d'être compliquée à atteindre.
Lucie TORTELLIER
T05
La harpe, une étoile montante dans le monde musical
A l'heure où les musiciens peinent à partager leurs talents avec leur public, il est temps de vous faire connaitre un instrument au style universel, presque disparu de Bretagne jusqu'à son utilisation, dans les années 50, par le musicien Alan Stivell qui a contribué à la populariser massivement : la harpe.
D'abord délaissé par les musiciens à cause de sa transportabilité difficile, on observe depuis les années 80 un retour en force de cet instrument, favorisé par les nombreux harpistes ayant, au fil des années, facilité l'accès à cette pratique musicale. C'est par exemple le cas des trois recueils de compositions et d'arrangements traditionnels pour la harpe, récoltés auprès des harpistes par Tristan Le Govic, lui même joueur professionnel. Les cours pour tous les âges dispensés par des harpistes professionnels, la possibilité de louer des harpes et la baisse des prix des instruments grâce à la fabrication en série, favorisent aujourd'hui la pratique de cet instrument. C'est pourquoi la harpe est un instrument de plus en plus convoité dans le monde de la musique.
Un instrument aux pratiques diverses
Si la harpe est souvent reliée à la musique celtique, son répertoire s'étend bien au-delà. En effet, la diversité des techniques et des styles qui lui sont accessibles offrent une compatibilité avec une grande palette d'instruments de musique. Il existe des collaborations musicales nouvelles entre la harpe et d'autres instruments, comme la batterie et la guitare électrique, mais aussi un intérêt nouveau pour les harpes électriques.. La harpe est donc un accord parfait entre tradition et modernité.
Sterennig MEVEL LE DARZT05
Pour l'amour de la musique
Nous avons posé quelques questions à deux jeunes lycéens, tous deux en terminale : Elouen et Noan. Elouen a commencé à jouer de la batterie très jeune grâce à un ami de son père qui en était professeur. C'est ce qui lui a donné envie de faire de la musique. “Pouvoir simplement jouer devant des gens, je trouve ça génial, explique-t-il. C’est pour ça que je n’ai jamais lâché la musique.” Noan est joueur de bombarde depuis 11 ans et de deux autres instruments. “Je n’ai pas eu des parents qui écoutaient de la musique ou qui m’ont poussé à en faire, indique-t-il C’est en écoutant le Bagad de Camors que je me suis dit : “C’est ce que j’ai envie de faire”. Et il ajoute :”Ce qui me plaît dans la musique, ce sont les projets que l’on peut mener, le fait de jouer avec les autres, rencontrer de nouvelles personnes… En bref, s’éclater !”. Elouen et Noan vont se lancer dans des études de musique. Ils nous expliquent que le lycée Fénelon à Brest propose un bac technologique S2TMD et que plusieurs facs offrent un cursus de musicologie. Enfin, les garçons donnent des conseils à ceux qui souhaitent faire de la musique : “Je pense qu’il ne faut pas trop se forcer. Commencez par essayer de jouer seul les morceaux que vous aimez. L’important, c’est de jouer ce que l’on aime. Il ne sert à rien de se prendre la tête.Si l’on n'arrive pas à jouer un morceau, on le simplifie. Dans tous les cas, si vous faites des erreurs, personne n’en saura rien !”, assure Elouen. “Foncez car la musique est un monde qui ne demande qu’à être exploré ! Peu importe l’âge, il ne faut jamais se dire qu’il est trop tard pour commencer. De plus, la musique est un excellent moyen de s’exprimer dans la vie et de faire de magnifiques rencontres !”, résume Noan.
Enora CLOAREC T05
« Magic Lewis » : Puissance 7
En novembre, le britannique est devenu septuple champion du monde de Formule 1.
Quand Michael Schumacher a quitté Ferrari en 2006, on pensait impensable que ses records soit battus. Pourtant, à 35 ans, Lewis Hamilton l'a fait. Depuis son arrivée en 2007, il n'a cessé d'impressionner. Il a signé son 1er podium dès sa 1ère course. Pour sa 2e saison, il s'offre le titre avec un final inédit. Il a en effet acquis son titre dans le dernier virage du dernier tour, du dernier grand prix. Cette année, son pilotage était au sommet de son art, allant jusqu'à gagner sur 3 roues en Grande-Bretagne. Le 25 octobre, il a empoché sa 92e victoire, battant les 91 succès de Schumi. Le 15 novembre, en Turquie, Lewis a encore plus rejoint le Baron Rouge en empochant son 7e titre, lors d'une magistrale 94e victoire. Pourtant, cette course ne lui était pas promise. Il n'avait pas la meilleure auto depuis le vendredi sur une piste très glissante. La pluie s'est invitée dès le samedi. Durant la qualification, le britannique ne signe que le 6e temps. Le dimanche, Lewis réalise un bon départ, se retrouvant 3e. Après les arrêts aux stands, il bataille avec Vettel durant une bonne partie de la course. Au volant de sa Mercedes, il est seul au monde, déroulant le pilotage complet qui a forgé sa légende : une intelligence de course impressionnante, délicat avec ses gommes, une patience et le talent d'un funambule sous la pluie. Il prend la tête au 37e tour avant de remporter son 7e titre de champion du monde. Grâce à ce titre, la reine Elizabeth II a décidé d'anoblir le pilote. Il faudra, en 2021, l'appeler Sir Lewis Hamilton. Coup de tonnerre après sa 95e victoire marquée par le grave accident de Romain Grosjean, Lewis Hamilton a été testé positif à la Covid-19 et a déclaré forfait à la course de Sahkir ce 6 décembre. N'ayant manqué aucun départ depuis son arrivée en 2007, son record de 265 grands prix disputés d'affilées s'est figé dimanche. Il est remplacé par George Russell. Son écurie habituelle, Williams, a décidé de le libérer. Il a finit 9e après avoir dominé l'épreuve, mais victime d'une erreur de l'écurie aux stands. À noter que Checo Perez a signé sa première victoire et que le normand Esteban Ocon a marqué son premier podium en finissant 2e. Sa participation à la dernière épreuve de la saison à Abu Dhabi, n'a, à l'heure où nous écrivons ses lignes, pas été confirmée. Lewis est un travailleur acharné, toujours en quête d'excellence. Un système de travail qu'il a adopté bien avant ses débuts en Formule 1. Mais cette année, le pilote a pris la tête du combat contre le racisme. Discret sur le sujet avant cette année, il confiait tout de même le racisme qu'il a subi à ses débuts. Il affiche son soutien au mouvement "Black Lives Matter". Son écurie le soutiendra en affichant une peinture noire sur ses monoplaces. Il est également investi dans la sensibilisation pour l'écologie, il est d'ailleurs devenu végan. Dans le tour d'honneur en Turquie, il lance un message, en larmes, à la jeunesse : "Pour tous les enfants qui rêvent de l'impossible. Tes rêves sont possibles. Tu peux le faire aussi, je crois en toi !"
Donatien COMPEYRON.
Comment les lycéens se sentent dans le milieu scolaire ?
La crise sanitaire que nous vivons actuellement nous amène à nous poser beaucoup de questions sur le bien-être des lycéens.
Pendant cette pandémie, les lycéens n'apprécient globalement pas cet enseignement hybride entre cours au lycée et cours à la maison car cela complique leurs études. Travailler en distanciel n'est pas facile pour tout le monde, il peut y avoir du décrochage en visioconférence, mais aussi des complications avec Internet ; ce qui crée des inégalités entre élèves.
Selon un sondage réalisé sur le compte Instagram @franklinsnews auprès de 110 élèves du lycée Benjamin Franklin, 72,5 % disent se sentir bien à l'école contre 27,5 % qui se sentent mal. Les élèves qui apprécient le lycée ont répondu, pour la plupart, que le partage avec leurs amis et leurs professeurs est la chose qu'ils préfèrent. Ces réponses sont majoritairement mises en lien avec les relations sociales, qui deviennent compliquées à cause des nouvelles mesures sanitaires mises en place. Globalement, les lycéens ont également confié qu'ils trouvaient que dans notre lycée, les gens étaient plus ouverts d'esprits.
En revanche, ceux qui disent se sentir mal ont répondu de manière générale que les cours leur mettaient la pression, qu’ils recherchaient toujours l’excellence via leurs notes et qu’il y avait une surcharge de travail donnée, malgré eux, par les enseignants. C’est donc une grande source de stress. Plus rarement, ces élèves ont avoué leur peur de se retrouver seul au lycée notamment à cause de l'organisation une semaine sur deux. Enfin, pour certains, le fait que certaines personnes mettent mal leur masque, vu les conditions, est également une des raisons du mal-être.
Un mal-être en situation de crise qui différe de celui qui peut exister par ailleurs dans les lycées généraux, technologiques et professionnels français. Selon les enquêtes nationales de victimation réalisées en France par la Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP), 94 % des lycéens en 2017 disaient se sentir bien dans leur établissement.
Mais qu'en est-il en 2020 ? Une augmentation de la cyberviolence a été enregistrée cette année. En effet, on en comptait 18 % en 2018 contre plus de 30 % pour cette année 2020 selon la plateforme d'écoute de l'Association e-Enfant (Net Ecoute). Les élèves passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux ou Internet en général depuis le premier confinement du mois de mars. Ce qui a entraîné l’augmentation à haute intensité de la cyberviolence et du cyberharcèlement. Cela peut peut-être expliquer le fait qu'un jeune sur 3 fait état d'un trouble dépressif, selon le rapport de Santé Publique France.
Pour conclure sur du positif, en tant que lycéens, nous sommes tous dans les mêmes conditions. On se doit de se soutenir et de s'entraider pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans notre établissement.
Marine SEVENO S05











