
Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Sommaire
Les nouveaux murs en Europe
(Page 3)
La ligne Oder-Neisse
(Page 4)
Le 38e parallèle
(Page 5)
Frontières aéroportuaires
(Page 6)
La frontière Mexique/Etats-Unis
(Page 7)
Les GAFAM
(Page 8)
Édito
Le franchissement par les forces militaires russes de la frontière ukrainienne domine le contexte international. Le troisième et dernier numéro du JDL des élèves de 1re H2GSP du lycée Colbert aborde justement la notion de frontière.
Elle délimite l’exercice de souveraineté des États. Frontière défensive dès l’Antiquité, Rome se protège des peuples « barbares » derrière sa « Limes ». La frontière Mexique/États-Unis est « mur de protection » contre les migrations économiques, et les maquiladoras exploitent cet espace frontalier original. La frontière peut aussi délimiter deux idéologies, comme la frontière nord-coréenne qui sépare le peuple d'un Nord autarcique et totalitaire, d'une démocratie libérale au Sud.
Elle peuvent présenter d’autres dynamiques. La construction européenne propose une intégration des peuples dans un territoire où les frontières s’effacent. L’espace Schengen est celui de la libre circulation entre 26 États de l’Union. Les frontières internes deviennent de nouveaux territoires « transfrontaliers » et créent de nouvelles solidarités. Mais si les frontières internes s’estompent, les frontières externes de l’UE se referment avec des murs et des fils barbelés. Des « hotspot » regroupent à nos frontières les migrants qui fuient la guerre ou ont l'espoir d'une vie meilleure.
L’enseignement d’H2GSP est une nouvelle fois ancré dans l’actualité et ce numéro, comme les précédents, alimente notre réflexion sur les principaux enjeux du monde contemporain. Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture.
Angélique MANGENOT,
Proviseure du lycée Colbert
La frontière, une histoire complexe

| N° 3 - Juin 2022 | www.lycee-colbert-lorient.com |
Repères - Ses dates clés
2007. Le couple s'installe à Port-Louis puis à Lorient.
2022. En février au début du conflit, plusieurs femmes ukrainiennes du Morbihan fondent l'association pour aider la population ukrainienne.
Famille
Yana est mère de quatre enfants et vit à Lorient, mais ses parents vivent à Poltava près de Kharkiv, la plus grande ville russophone d'Ukraine. Elle prend des nouvelles de sa famille tous les jours via des appels téléphoniques et les réseaux sociaux.
Contacts
Adresse mail :
unispourlukraine@gmail.com
Page facebook : Unis pour l'Ukraine 56
On peut aussi contacter l'association auprès de Marin'Accueil, 30 boulevard Jacques-Cartier. Les locaux se situent sur les quais du port de commerce de Lorient.
A Lorient, Yana agit pour l'Ukraine
Nous avons rencontré Yana Ganuchaud, la porte-parole et secrétaire de l’association Unis pour l’Ukraine 56. Cette franco-ukrainienne nous a expliqué son parcours et ses actions en faveur de son pays d’origine.
Traductrice bénévole dans un orphelinat en Ukraine, elle y a rencontré son mari en 2003 lors de la tournée de son association « Le tour du monde de Théo ». Ils se sont installés en Bretagne en 2007. Elle dit : « La déclaration de guerre a été un choc pour nous les Ukrainiens. Nous étions inquiets pour nos proches restés en Ukraine. Nous avions un sentiment de culpabilité et de frustration. Nos amis ne souhaitent pas quitter notre pays car c’est un honneur de le défendre. »
Quel est l’objectif premier de votre association ?
Avec plusieurs femmes ukrainiennes, nous avons décidé de former une association pour aider notre pays à gagner la guerre et à survivre. Nous organisons des collectes auprès de supermarchés, hôpitaux, entreprises, pharmacies, particuliers...
Quels types de dons privilégier ?
Il y a un besoin énorme de médicaments, d’aliments, de produits pour bébé... Mais actuellement les aides financières sont prioritaires. Elles sont plus simples pour cibler les achats. En outre, les transports routiers pour acheminer les dons matériels coûtent cher.
Avez-vous des soutiens du pays de Lorient ?
Nous avons été profondément touchés par les élans de générosité. Tant des particuliers que des entreprises et des mairies : collectes de produits de première nécessité, organisations de manifestations culturelles. Il y a eu un concert au Conservatoire de Lorient. Le 16 avril a eu lieu un récital de chants de marins avec la violoniste ukrainienne Maria Kravtsova, actuellement hébergée à Guidel avec sa fille et sa mère. Certaines mairies et associations nous ont envoyé des chèques.
Quelle logistique avez-vous mise en place ?
Tous les dons collectés sont triés par catégories dans les locaux de Marin'Accueil (accueil des marins en escale) situés au port de commerce de Lorient. Quarante bénévoles se relaient pour trier et mettre en cartons. Nous prévoyons un nouvel entrepôt plus vaste. Les dons sont acheminés aux frontières de l'Ukraine, en Pologne et en Roumanie. Le transporteur Bruneel a financé un camion de 80 m3 à 100 %. Cela nous aurait coûté 6 500 €.
Combien de camions sont partis ?
A ce jour, sept semi-remorques, trois fourgons, une fourgonnette et des voitures de particuliers chargées à ras bord ont rallié les frontières. Les convoyeurs savent exactement qui sont les destinataires des dons. Nous pensons maintenant qu'il serait plus efficace de faire acheter les produits en Pologne et en Roumanie. Nous recherchons des associations fiables dans ces deux pays pour leur envoyer de l'argent.
L'association prend-elle en charge des hébergements ?
Certains d'entre nous prennent en charge les hébergements de réfugiés ukrainiens. J'accueille, moi-même, une amie et ses deux enfants. Elle résidait à Zaporijja, ma ville natale. C'est une amie d'enfance qui était coiffeuse. Sa ville a été bombardée. En tant qu'Ukrainiennes, nous sommes solidaires et prêtes à héberger dans la mesure de nos moyens. C'est la préfecture qui met en relation demandeurs d'hébergement et offres de particuliers.
Comment ressentez-vous personnellement ce conflit ?
Ma famille et mes amis sont restés en Ukraine pour défendre notre pays. Nous sommes très soudés. La plupart des hommes sont restés combattre. Certains font partie de l'armée régulière tandis que d'autre se sont engagés dans la "teroborona". Cette défense civile recrute des personnes qui ne savent pas forcément tirer mais qui savent souder, faire des barrages, fabriquer des cocktails molotov. Elles peuvent également rechercher des victimes dans les décombres, livrer des médicaments, récupérer des dons à la frontière. Ce sont des hommes et des femmes dans le mouvement. Mes amis ukrainiens ont une devise : « Les bombes ne voleront jamais jusqu’à chez vous car nous les aurons arrêtées ici. »
Juliette GARRIGUE, Assoh MIAN
et Garance HOLOWENKO.
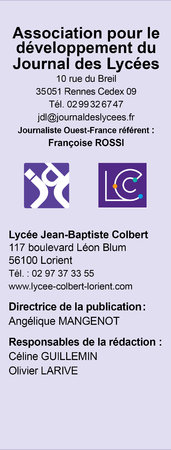
De nouveaux murs en Europe ?
Territoire de libre circulation, l'Union Européenne se ferme à ses frontières externes.
L’Union européenne (UE) est un espace de libre circulation pour toute personne qui entre dans l’un des 22 pays signataires des Accords de Schengen en 1985, ce qui implique le libre franchissement des frontières. Les contrôles augmentent aux frontières qui séparent un État membre de l’UE d’un Etat non membre. Ils passent par la coopération policière des Etats membres et de Frontex, l’agence européenne de gardes chargée de surveiller les frontières extérieures de l’UE sur terre et sur mer.
Les frontières de l'UE ne sont pas uniquement européennes, elles existent également entre la Guyane et le Brésil ou entre l'Espagne et le Maroc.
Fermeture des frontières ?
La frontière extérieure de l’espace Schengen se ferme de plus en plus, en général entre les pays où il y a des tensions politiques et une intensification des migrations clandestines vers l’UE. L’Europe se referme en renforçant ses contrôles à partir de pays comme l’Italie et la Grèce où sont installés des hotspots, ("centres" chargés d’identifier les nouveaux arrivants et de séparer les demandeurs d’asiles des migrants économiques) ou des murs et barrières anti-migrants en Espagne, en Bulgarie.
Les décisions d'Erdogan
Le vendredi 28 février 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan décidait unilatéralement de suspendre l’accord UE-Turquie de 2016, qui, en quatre ans, a transformé cinq îles grecques de la mer Égée en prisons à ciel ouvert pour les exilés, les fameux « hotspots ».
Les gouvernements européens critiques
A de nombreuses reprises déjà, la Turquie s’était servie de cet accord comme instrument de chantage auprès de l’Union européenne, en menaçant de rouvrir ses frontières. Les critiques des gouvernants européens face à l’offensive turque en Syrie et la perte d’une trentaine de soldats turcs dans un bombardement russe ont été le prétexte pour mettre à exécution cette menace. Mais ce renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne menace-t-il le principe de libre circulation ?
Loïcia CORLAY
et Shana LOMBARDI.
Les frontières irlandaises à l'épreuve du Brexit
Une des principales questions soulevées par le Brexit, la frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord britannique, avait été réglée il y a vingt ans. Mais elle pose à nouveau problème aujourd'hui.
"Brexit" est la contraction de "British exit". Plus de trente millions de personnes ont participé au référendum organisé en 2016. 51,9 % des Britanniques ont voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. L'Ecosse et l'Irlande du Nord ont soutenu le maintien du pays dans l'Union
Frontière créée en 1921
La frontière nord-irlandaise remonte à la création de l'État libre à la fin de 1921 après la guerre d'indépendance. De 1968 à 1998 surviennent des conflits, violences et attaques, en particulier dans les zones frontalières. Les jeunes Nord-Irlandais souffrent des conséquences du passé de leur pays, qui entrave les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne aujourd'hui.
Premier accord en 2018
Après des mois de négociations avec l'Europe, Theresa May dépose son premier accord de divorce le 14 novembre 2018. Malheureusement, le backstop, cette solution au problème de la frontière irlandaise, ne plaît pas aux députés britanniques. Le 15 juin 2019, l'entente a été rejetée par la Chambre des communes tout comme les 12 et 29 mars 2019.
Les frontières irlandaises ont posé et posent encore un problème pendant le Brexit.
Enjeux sociaux
C’est une question qui allie intérêts économiques et commerciaux mais aussi des enjeux sociaux importants. Face à une paix et à l’unité du Royaume-Uni fragiles, trouver une solution qui satisfera les deux parties nécessitera davantage de souplesse dans les relations diplomatiques qu’entretiennent l’Union européenne et le gouvernement de Boris Johnson. Quand on pense au Sunday Bloody Sunday on pense à la musique de U2. La chanson a été écrite par The Edge en 1982 et remasterisée par Bono. Pour protéger le groupe, de nombreuses phrases ont été supprimées de la version originale, plus intense. Malgré les changements, certains ont critiqué l'approche de U2 et les ont accusés d'être proches de l'IRA. À ce jour, le groupe a donné plus de 600 représentations de "Bloody Sunday" et a pris l'habitude de hisser le drapeau blanc de la paix devant la scène.
Maïlys CHANOIR
et Lola LE BOULCH.
La ligne Oder-Neisse, un tournant décisif
La frontière germano-polonaise a subi de multiples changements et transformations. Elle a fluctué à partir de 1945 pour aboutir à son tracé définitif en 1990.
La frontière
C’est une séparation contrôlée entre deux ou plusieurs états, ici entre l'Allemagne et la Pologne. Elle se marque par un tracé, souvent on utilise un élément naturel telle qu’une chaîne de montagnes pour le définir. La frontière germano-polonaise est marquée par un fleuve, l'Oder rejoint par la rivière Neisse. Cependant l’élément naturel ne représente jamais une frontière. Actuellement, elle passe nettement à l'ouest de la frontière précédente, réduisant le territoire allemand.
La frontière
germano-polonaise
Tout débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, où à l'origine la "frontière" était une ligne de démarcation provisoire entre les régions sous administration allemande, et celles sous administration polonaise. Au fil des années elle s’est renouvelée et a été modifiée. Les Alliés, les trois chefs des gouvernements anglais, américain puis russe, à l'heure où l'URSS est encore présente mais chutera en 1991, se réunissent lors de la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945 , afin de régler les litiges frontaliers, posés par la défaite allemande. En 1950, la RDA "République démocratique allemande" reconnaît la frontière sur la ligne Oder-Neisse, mais la RFA « République fédérale d'Allemagne », réclame sa révision.
La ligne Oder-Neisse, frontière de l'amitié
Parmi les différents litiges, se pose la question de la frontière germano-polonaise et la ligne « Oder-Neisse », qui mesure 472 km et longe donc pour l’essentiel les rivières Oder et Neisse et rencontre la mer Baltique au nord. Les Alliés statuent alors sur ce sujet lors de la conférence. Après discussion, ils acceptent que ces transferts s'effectuent de façon ordonnée mais aussi humaine. Des déplacements ont lieu tout au long des années 1939-1990 entre populations allemande et polonaise.
Finalement, c'est en 1990 que la RFA accepte le tracé de la frontière et renonce à toutes revendications territoriales en Pologne. Deux séries d'accords internationaux sont signés : le traité de Moscou (aussi appelé Deux plus-Quatre) du 12 septembre qui fait office de traité de paix entre l'Allemagne et les Alliés, et les accords germano-polonais du 14 novembre 1990.
Lilou LE NADANT
et Anna LE BECHENNEC.
L'Europe et ses frontières
Faut-t-il réformer le principe de l'espace Schengen ?
L’espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes, des biens et des marchandises. Tout individu peut entrer librement sur le territoire d’un des États membres , signataires des accords de Schengen de 1985. Il concerne désormais près de 420 millions d’habitants dans 26 pays membres.
La libre circulation
Ce principe, très apprécié des Européens, favorise leur intégration culturelle. De plus, l’immigration des Européens au sein de la zone a un effet immédiat sur les échanges entre leur pays d’origine et le pays hôte. Selon une étude, en 2014, plus de 218 millions de voyages ont eu lieu pour une durée d’une nuit ou plus, dans un autre pays d’Europe. Cependant, cette ouverture des frontières pose problème : l’immigration clandestine induit une crainte du terrorisme transnational, trafic d’armes, de drogue, etc. Certains États souhaitent restaurer les contrôles à l’intérieur de l’espace Schengen.
Divisions internes
En effet, les flux migratoires ont altéré la cohésion interne. La pression des demandeurs d’asile étant forte, certains pays, comme la Grèce, n’ont pas les moyens d’assurer le contrôle des frontières. Un groupe se démarque, le Groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie). Il défend une politique commune : restriction de l’immigration, renforcement des souverainetés nationales et refus des accords de Dublin.
Conséquences d'une sortie
Le Covid-19 a aussi bouleversé les normes et législation de l’espace. D’un côté, une liberté fondamentale de l’identité européenne, de l’autre, une menace sanitaire sans précédent dans l’histoire contemporaine. Elle a dû en effet revenir sur la suppression des contrôles. La sortie de cet espace aurait un coût particulièrement élevé pour les États. Économiquement, l'abandon de Schengen aurait des incidences lourdes, notamment sur le tourisme et sur le transport de marchandises. On estime un coût annuel français à 1,15 milliard d’euros et un impact de moins 10 milliards sur les échanges internationaux. De plus, le quitter signifierait renoncer à la coopération policière européenne.
L'avis des spécialistes
De nombreux spécialistes désapprouvent une sortie de Schengen mais proposent plutôt une réforme des accords en place, avec une étude plus poussée des crises actuelles.
Cela viserait à améliorer le contrôle aux frontières extérieures de l’Europe, à améliorer et renforcer la coopération entre les États-membres. Elle prévoit de faciliter le renvoi d'un migrant en situation irrégulière vers l'État voisin, s'il a été contrôlé dans une zone frontalière.
Mathilde FURET
et Colline BRUEL.
L'accélération de la colonisation africaine
La conférence de Berlin en 1885 a scellé les contours des pays africains.
La Conférence de Berlin est généralement perçue comme l'accélérateur de la colonisation du territoire africain. En 1885, le chancelier allemand Otto Von Bismark organise une conférence qui réunit les quatorze puissances coloniales européennes. Cette conférence découpe l'Afrique en territoires sous influence européennes. les puissances tracent les frontières de l'Afrique, dont certaines encore aujourd'hui restent inchangées.
Un enjeu géopolitique
La France et la Grande-Bretagne sont les principaux bénéficiaires de ces accords. La répartition du territoire s'est faite de manière inégale. En effet, la France a hérité de tout l'Occident africain, tandis que la Grande-Bretagne s'approprie une ligne de territoires reliant le nord au sud de l'Afrique. Les puissances européennes vont projeter leurs rivalités dans la conquête de l'Afrique.
Un enjeu économique
Cette colonisation permet aussi d'étendre sa zone d'influence respective à travers ses propres frontières, elle permet surtout une domination du territoire africain et du pillage de ses ressources. L'Afrique est réputée pour la richesse de ses ressources minières. Effectivement l'intérêt très prononcé pour les terres africaines est à but lucratif. Par exemple les mines d'or et de diamant du Traansval sont convoitées.
Un enjeu idéologique
Les Européens organisent la Conférence de Berlin sans inviter les personnalités politiques africaines. Dans le contexte colonial du XIXe siècle, les Européens projettent "d'apporter la civilisation aux peuples africains", sans leur consentement ni préoccupation des cultures africaines. Les frontières seront tracées "au cordeau", séparant les peuples d'une même ethnie.
Thibault CATALOGNE
et Tristan CHARVIN.
Le 38e parallèle, une frontière idéologique
En Extrême-Orient, la frontière du 38e parallèle nord sépare un peuple et deux idéologies.
Le Japon annexe la péninsule coréenne après la guerre russo-japonaise de 1905. C’est le début de l’expansion coloniale du Japon. Cette zone géographique deviendra un enjeu de puissance et d'idéologie durant la Guerre froide.
En 1945 lors de la conférence de Potsdam, le Japon est défait et la péninsule est partagée entre les vainqueurs, les États-Unis et l’URSS. La limite d’influence des deux puissances est définie au 38e parallèle. Au nord, Kim Il-Sung est désigné comme chef du gouvernement provisoire.
La guerre éclate
En 1945 les États-Unis envahissent le sud de la Corée. Les deux blocs se rencontrent pour entrevoir l'avenir de la Corée en 1946. Le bloc de l’Ouest est favorable à une nation coréenne que l’Est refuse. En 1948 la Corée organise des élections, la Corée du Sud devient une république libérale. Dans le même temps, l’URSS proclame la République populaire de Corée. En 1950, dans le contexte de la Guerre froide, la guerre éclate entre la Corée du Sud sous influence occidentale, soutenue par l’ONU, et la Corée du Nord sous influence de la Chine et de l'URSS. Après trois ans de guerre où la péninsule est contrôlée par le Nord puis reconquise par le Sud, le front stagne au 38e parallèle. En 1953 un armistice est signé entre la Corée du Nord, la Chine et l’ONU mais la paix n'est pas acceptée, les deux camps se font toujours face. Cette guerre particulièrement violente mènera à la division des deux Corée.
Depuis cinquante ans la Corée du Nord est une dictature militaire communiste influencée par la pensée Juche, idéologie d’indépendance totale. Tous les membres pro-russes ou pro-chinois du gouvernements sont alors renvoyés. La Corée du Sud en s'inspirant des régimes occidentaux, est un régime démocratique, libéral et capitaliste.
Une frontière marquée
La frontière, marquée physiquement par une zone démilitarisée de quatre kilomètres, la DMZ, est surveillée en permanence par 1 110 000 soldats coréens. Elle est régulièrement transgressée ou est le théâtre d'incidents. Aujourd'hui, cette frontière est un enjeu économique devant laquelle des touristes du monde entier se font photographier.
Julian DABZAT
et Arsène LAMY.
Grèce : îles "grillages" aux portes de l'Union
Iles frontières de l'Union européenne, elles sont un passage prisé pour l'immigration.
Depuis le début du XXe siècle, la Grèce et la Turquie entretiennent une relation conflictuelle, que ce soit pour l’indépendance de la Turquie, des frontières maritimes ou le partage des ressources naturelles.
Une guerre évitée
Après avoir frôlé la guerre en 1996 en raison de la revendication de deux îlots inhabités en mer Egée, les tensions semblaient apaisées. Cependant, c’était sans compter l’ampleur que prendrait le phénomène de l’immigration ces dernières décennies.
Pic migratoire
On observe un pic migratoire en 2015, mais début 2016, l’OIM estime que 31 244 migrants sont arrivés en Grèce par la mer, soit 21 fois plus que les 1 472 recensés par les garde-côtes grecs pour tout le mois de janvier 2015. Les chiffres ne cessent d'augmenter, notamment sur des îles comme Lesbos, Samos ou Chios, qui comptaient à elles trois réunies, 83 % des migrants de la mer Egée.
Un accord avec la Turquie
En 2016, un accord entre l’Union européenne et la Turquie est signé, engageant cette dernière à maintenir les migrants sur son territoire. L’arrivée au pouvoir d’un gouvernement conservateur en Grèce n’améliore pas la situation des migrants.
Des "îles-camps"
En effet, les « îles-camps » débordent de demandeurs d’asile en attente de réponses, les politiques en place ne leur facilitant pas la tâche. Les Grecs se sentent abandonnés par l’Europe.
Tolérance zéro
S’installe donc une politique de tolérance zéro, quitte à bafouer les droits humains, comme les refoulements illégaux de la part des garde-côtes grecs soutenus par les forces de l’ordre, qui menacent la vie des réfugiés. Des techniques telles que le « pushback » sont employées, consistant à crever les bateaux pneumatiques en provenance de la Turquie, cette stratégie d’écartement aurait déjà fait des dizaines de milliers de morts. Les grandes instances européennes fermant les yeux sur la question, des avocats de plusieurs nationalités prennent la parole et entament des poursuites en justice des garde-côtes pour faire respecter le droit d’asile. Des migrants de nombreuses nationalités comptent la Turquie comme un point de passage dans leur périple, ce qui avantage le pays d’un point de vue économique, sa situation étant misérable, surtout depuis la crise sanitaire de 2020. Les îles grecques sont donc aujourd'hui considérées comme des frontières pour l'Union européenne, filtrant l'arrivée des réfugiés (qui transitent par la Turquie). On constate donc un dispositif d’enfermement des étrangers à la frontière gréco-turque, la Grèce en est la principale porte d’entrée.
Yael BESANCENOT.
Les aéroports sont de nouvelles frontières
Les aéroports sont devenus de nouveaux types de frontières souvent politiques.
Naturelles ou artificielles, les frontières représentent pour les Etats des enjeux de puissance. Dans le contexte de la mondialisation, les Etats répondent aux enjeux économiques et géopolitiques en mettant en place un nouveau type de frontière : les aéroports ou "smart border".
Dès leur apparition au 20e siècle, les aéroports sont vus comme des territoires révolutionnaires qui permettent le transit de milliers de personnes d'un territoire à l'autre.
Porte d'entrée
Plus d'un siècle après l'invention de l'aviation civile, l'explosion du trafic aérien international transforme les aéroports en première porte d'entrée des territoires. Ils sont capables de répondre aux enjeux principaux : contrôler les flux migratoires, répartir et accueillir les populations, transiter ou encore faire fructifier la richesse du pays.
Ils sont aussi une forme d'enjeu politique car les aéroports permettent aux État de projeter leur législation sur un territoire étranger.
"Smart Border"
L'avion a accéléré la mondialisation. En 2018, 4,3 milliards de passagers ont embarqué sur l’une des 1 300 compagnies aériennes à travers le monde. Tous ces passagers sortent et entrent dans les Etats en passant des "smart border" ou "frontières intelligentes". Dotées des hautes technologies, elles ont avant tout pour objectif de sécuriser l'entrée des passagers sur le territoire.
Le film "Le Terminal"
"Le Terminal" met en scène un voyageur dans le terminal d'un aéroport de New York. Pendant son voyage, son pays connaît une révolution et n'est plus reconnu internationalement. Ses papiers n'ont plus aucune validité, il ne peut plus entrer aux État-Unis ni retourner dans son pays d'origine.
Un rôle de plus en plus important
On constate qu'au fil des années les aéroports sont devenus des endroits stratégiques, jusqu'à devenir les portes d'entrée majeures des territoires.
Malo MARTIN.
Tijuana, la frontière mexaméricaine
La frontière mexico-américaine sépare les Etats-Unis de l’Amérique du sud, deux pays totalement différents. Pourquoi cette frontière est nécessaire ?
La frontière mexico-américaine est la frontière la plus traversée du monde. Elle mesure environ 3 150 km, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Elle sépare deux territoires géo-économiques différents : le Mexique, pays émergent et plus pauvre, et les États-Unis, pays développé et riche.
Le "mur" de Trump
Enjeu de politique intérieure, la frontière se ferme dans les années 90. Des barbelés, sous les présidences de B. Clinton, G.W. Bush, ou B. Obama marquent la frontière, et sont consolidés par des murs sous Donald Trump. En 2021, 727 km de mur fortifient cette frontière.
Maquilladoras ou twin cities
Les entreprises nord-américaines profitent des différences de niveaux de vie et d'une législation avantageuse pour s'y installer. La frontière relève alors d'enjeux économiques. La population mexicaine embauchée constitue une main-d’œuvre bon marché dans des maquilladoras ou twin cities.
Usines d'assemblage
Ce sont des complexes d'usines d’assemblage ou de confection détenues par des sociétés asiatiques, américaines ou mexicaines. Elles sont en grande partie installées au nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis.L'enjeu sécuritaire est important car, depuis plusieurs années, l’essor du trafic de drogue est venu compliquer les relations entre les deux pays. La frontière a alors été dotée d’un important dispositif de sécurité avec une télésurveillance, un mur de séparation et de nombreux policiers et patrouilles.
L'enjeu migratoire
S'ajoute l'enjeu migratoire, puisqu'en 1990 les entrées légales comptaient seulement quelques milliers de personnes contrairement aux entrées illégales estimées à 1,3 million de personnes, malgré les nombreux contrôles de police. Les touristes sont, quant à eux, considérés comme des visiteurs légaux. Ils peuvent passer sans problème mais il faut quand même compter deux heures pour entrer sur le territoire américain.
Des améliorations
Si cette frontière semble nécessaire pour limiter les activités illégales entre les deux pays, il resterait toutefois des améliorations à apporter sur le plan sécuritaire, vu le nombre d’entrées illégales sur le territoire nord-américain.
Maëlle PALAY
et Marine GEIGER.
L'OTAN, un instrument de l'hégémonie américaine ?
L'Alliance semble être aujourd'hui un moyen pour les États-Unis d'affirmer leur puissance.
L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est une alliance militaire multilatérale des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Créée le 4 avril 1949 à Washington dans le contexte de la Guerre froide, elle a pour objectif de défendre et d'assister un pays européen agressé par un puissant allié qui n'est autre que les États-Unis. Cependant, l'OTAN est perçue comme un instrument militaire de la domination étasunienne.
L'OTAN a été mise en place par les douze pays occidentaux signataires du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 et est entrée en vigueur le 24 août 1949. L'Organisation s'est élargie durant la Guerre froide en accueillant la Grèce et la Turquie en 1952, l'Allemagne en 1955 grâce aux accords de Paris, puis l'Espagne en 1982.
L'arrivée des pays de l'Est
Elle a continué de s'élargir avec l'effondrement du bloc de l'Est. Il a permis à douze pays d'Europe de l'Est de rejoindre l'Organisation en trois vagues entre 1999 et 2009. En juin 2017, le Monténégro devient le 29e Etat membre et le 27 mars 2020, la Macédoine du Nord en devient le 30e.
Les Etats-Unis,
principaux financeurs
Les États-Unis jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'OTAN car ils assument 70 % des dépenses contre seulement 6,2 % pour le Royaume-Uni, 5,2 % pour la France, 5 % pour l'Allemagne, 2,5 % pour l'Italie et 2,1 % pour le Canada. Les États-Unis sont donc les plus gros contributeurs. L'Alliance a par ailleurs été dirigée pendant cinquante ans par les USA, jusqu'à la fin de la Guerre froide. Ils ont ensuite exigé son maintien malgré la chute de l'URSS. L'OTAN est ainsi devenue l'un des éléments privilégiés de sa politique étrangère. Les États-Unis essaient de garder une bonne relation avec l'OTAN même si l'ancien président Donald Trump avait menacé de se retirer de l'Alliance s'il était réélu. Il la qualifiait d'alliance obsolète.
Face à la puissance chinoise
Joe Biden voit des intérêts géoéconomiques et géopolitiques à rester allié car il compte sur le soutien des pays européens dans sa guerre commerciale contre la Chine. Une guerre commerciale qui, selon les économistes, a pour objectif de rétablir la puissance américaine.
Assoh MIAN.
.
La puissance du cinéma américain
Il domine l'industrie cinématographique mondiale. En 2018, ses revenus étaient estimés à plus de 11 milliards de dollars.
Créé en 1888 par Thomas Edison, le cinéma américain acquiert très rapidement une popularité sans égal. Avec la présence de Hollywood, quartier populaire aujourd’hui considéré comme celui de l'industrie cinématographique mondiale, les Etats-Unis ont su développer leurs produits et s’adapter aux modes et aux époques.
Une domination mondialement reconnue
Le cinéma américain domine à l'international, notamment par sa grande puissance économique. Cette économie est acquise en partie grâce aux dons des agences gouvernementales qui payent pour avoir accès aux scénarios avant le tournage. Leur objectif est d'apporter des modifications pour améliorer l'image de l'armée américaine et des Etats-Unis en général.
De plus, identifié comme cinéma d'exportation, il véhicule la plupart des valeurs américaines. Outils de propagation de ces valeurs, il a pour but de montrer que les habitants des Etats-Unis peuvent tout réaliser en fonction de leur courage et de leur détermination. Tout ceci dans l'unique but de donner envie aux étrangers de venir visiter ou éventuellement de vivre aux Etats-Unis. C'est ce que l'on appelle "le rêve américain".
Enfin, situé dans un pays anglophone, le cinéma américain peut avoir un rayonnement international car il lui est facile d'être compris dans la quasi totalité du monde. Ce qui lui permet de pouvoir être traduit et adapté dans plusieurs pays.
Un box-office sans égal
Grâce à des dizaines de films à succès, comme la saga Star Wars (9,14 milliards de dollars) ou encore Avatar (2,9 milliard de dollars), les Etats-Unis ont remporté plus de 11 milliards de dollars en 2018.
Pour la plupart des films produits en 2021, les États-Unis ont réalisé plus de recettes que de budget de départ. Ce qui prouve que le succès du cinéma a fait gagner aux États-Unis tant en bénéfice qu'en popularité.
Le cinéma indépendant
Il est une révolution des grandes entreprises cinématographiques à Hollywood dans les années 60. Le cinéma indépendant est appelé comme tel car il cherche à travailler en autonomie par rapport aux méthodes de productions conventionnelles.
Souvent opposé au cinéma Hollywoodien, depuis sa création, il a des difficultés à émerger car il est le rassemblement de plusieurs styles de cinéma peu connus comme le cinéma amateur, créé par des non-professionnels, le cinéma de guérilla, produit avec peu de moyens, ou encore le cinéma expérimental qui relève des arts plastiques.
Depuis 1978, un festival se déroule chaque année dans l'Utah pour en faire la promotion.
Luna PEREZ DIAZ
et Lyson GUILLAMET.
Les GAFAM, symbole de la puissance des Etats-Unis
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft… Ces géants américains du numérique s’imposent et laissent peu de place à leurs concurrents. C’est une forme de soft power pour les États-Unis.
Google concentre à lui seul plus de 90 % des requêtes sur internet dans le monde. YouTube, le diffuseur de vidéos sur internet (racheté par Google en 2006 pour 1,65 milliard de dollars) est vu bien plus que n’importe quelle chaîne de télévision : chaque jour, plus d’un milliard d’heures de vidéos sont ainsi visionnées. Facebook, quant à lui, totalise en octobre 2020 plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Pour ce qui est d'Amazon, il est le numéro un mondial en terme de capitalisation boursière.
Leurs revenus
Ces entreprises se nourrissent de l’analyse et de la revente de nos données, de nos choix, de nos goûts, de nos centres d’intérêts quand nous utilisons leurs services. Ils peuvent ainsi définir notre profil de consommateur et ensuite être rémunérés en proposant aux entreprises des liens publicitaires internet qui ont un impact commercial plus efficace qu’un simple panneau au bord de la route. La collecte de ces données transforme les puissances publiques et les acteurs du Web, faisant alors de ces firmes une forme de soft power pour les Américains. Aussi, les GAFAM dominent la nouvelle économie mondiale du numérique.
L'Europe tente de réagir
L’Union européenne souhaite mettre fin à la toute-puissance des géants du numérique sur son territoire car ils menaceraient la souveraineté des États. La commission européenne ainsi que le Parlement tentent leur régulation en créant un projet de législation européenne qui mettrait fin aux abus de pouvoir. Ce projet doit imposer des obligations et interdictions nouvelles pour permettre le libre jeu de la concurrence. Les députés ont approuvé à une écrasante majorité ce projet qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. L'UE deviendra alors une puissance normative, c'est-à-dire une puissance qui n’a fondamentalement que la norme comme instrument privilégié.
Maéline BOUDARD
et Margaux GALLAIS.


















