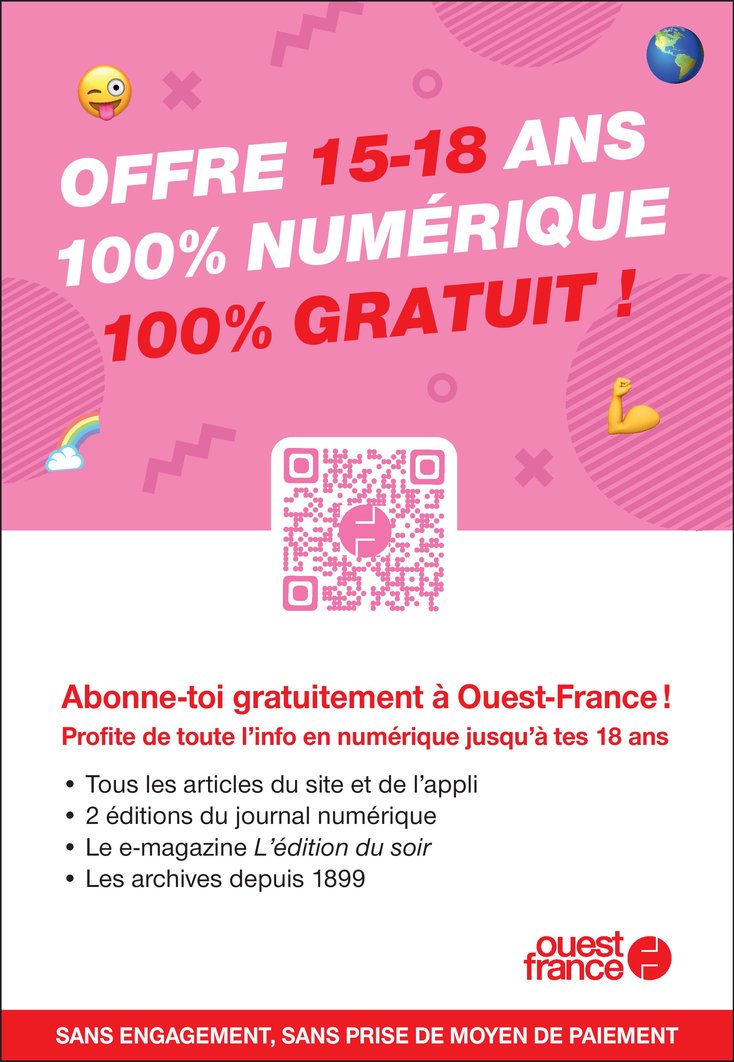Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Sommaire
Mortaza emprisonné
(Page 3)
L'après franquisme
(Page 7)
La parole aux citoyens
(Page 9)
Ploemeur : deux parcours politiques
(Pages 10-11)

| N° 5 - Avril 2023 | www.lycee-colbert-lorient.com |
Au secours des migrants en mer
Page 2
Édito
A l’heure où nous bouclons notre 2e numéro du Journal Des Lycée, Mortaza Behboudi, journaliste est toujours détenu par les talibans en Afghanistan. Juliette et Garance - élèves de terminale - ne pouvaient rester indifférentes et lui consacrent un article en soutien. Aussi est-il d’actualité de s’interroger sur la notion de démocratie. Ce sont ces principes que la presse et le JDL des élèves de 1re H2GSP défendent avec conviction.
Au XXe siècle, les démocraties libérales reculent face à la montée des dictatures. La prise de pouvoir de Franco en 1939 ou la mort de Salvador Allende en 1973 au Chili en sont des symboles. Aujourd'hui, des régimes autoritaires se maintiennent, en Chine, au Qatar. Soumis à des répressions, le peuple kurde mobilise sa diaspora et fait valoir son droit à un Etat-nation. Les peuples tiennent aussi tête aux dictatures et restaurent, avec ou sans révolution, un régime démocratique, comme en Espagne et au Portugal avec la Révolution des Œillets.
Engagés politiques dans nos démocraties représentatives, ou participatives, militants d'Organisation Non Gouvernamentales comme SOS Méditerranée, actions au lycée Colbert contre le harcèlement, nos journalistes sont partis à leur rencontre, et nous rendent compte à travers leurs articles de l'engagement de ces acteurs de nos démocraties qui veillent au maintien de nos libertés démocratiques.
Angélique MANGENOT, proviseure du lycée Colbert.
SOS Méditerranée, une seconde chance
Claire Faggianelli, un des marins, est venue témoigner au lycée.
Nous avons rencontré Claire Faggianelli, marin sauveteuse depuis 2017 dans notre cours de HGGSP (histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques) par l'intermédiaire de l'association Rhizomes. Âgée de 35 ans, elle sillonne les mers les plus meurtrières d'Afrique pour porter secours aux migrants. « Les sauveteurs sont l'équivalent des pompiers mais pour la mer » a-t-elle expliqué. Ces interventions appelées sauvetages humanitaires ont permis « de venir en aide à 34 000 personnes en l'espace de 9 ans ». Cependant, ces "anges gardiens" sont souvent accusés de trafic d'être humains.
C'est pour cela qu'ils sont obligés de faire très attention à tous leurs faits et gestes. Elle a ajouté : « Les ONG sont criminalisées par des anti-migrants qui ne souhaitent pas de migrants dans leur pays. Un exemple concret est le procès du Luventa, qui incrimine dix personnes de l'équipage de trafic d'humains. Ceux-ci risquent vingt ans de prison ».
Le financement des missions
Tous ces sauvetages ont un coût financier important. Elle précise : « Des mouvements de solidarité sont créés sur la terre ferme. » Tout l'argent des dons, ainsi que l'argent récupéré avec les Régions et les villes est alors utilisé pour ces missions. Elle poursuit : « Toutes les personnes à bord des bateaux de sauvetage sont salariés ».
Océan Viking, le navire de l'ONG, a son équipage attitré qui est composé de « 8 marins et 22 SAR (search and rescue). Parmi ces personnes se trouvent 12 équipiers à bord des semi-rigides, 3 médecins, 1 logisticien, 2 journalistes, 1 chargé de communication, une personne chargée d'enregistrer des preuves pour éviter les accusations de trafic d'être humains, 1 coordinateur de recherche et sauvetage plus un chef médecin ».
Les lois sur la mer
« Tout capitaine de navire a l'obligation de porter assistance à navire en danger » a-t-elle précisé. En effet, à partir du moment où quelqu'un a besoin d'aide et qu'il est possible d'accueillir les individus sur son bateau cela devient une obligation et un devoir.
Pour les personnes qui sont sauvées, on trouve un "principe de non refoulement", c'est-à-dire qu'il est interdit de renvoyer une personne dans son pays si elle y est en danger.
Des raisons évidentes
Claire a également évoqué les différentes raisons qui poussent à migrer. "On peut partir pour raisons politiques, économiques ou pour son orientation sexuelle. Ou aussi pour fuir les dégâts liés au changement climatique". Elle cite en outre le souhait d'obtenir une meilleure éducation pour obtenir des diplômes. « Les oppressions des minorités » peuvent aussi être un argument valable pour souhaiter quitter son pays. Des problèmes évidents comme la santé sont évidemment aussi présents.
SOS Méditerrannée revendique sa vocation humanitaire avec trois objectifs : protéger, sauver et témoigner. Basés en Méditerranée, plusieurs bateaux naviguent à la recherche de barques libyennes. La guerre en Libye entraîne une diminution de la surveillance des frontières, ce qui facilite le départ de ces multiples barques pour l'Europe. Quatre pays sont mobilisés : la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Ils se répartissent équitablement la Méditerranée pour sauver le plus grand nombre de migrants.
Pompiers de la mer, ces secouristes sont appelés les SOLAS.
Ninon LASZCZAK
et Anaëlle CARRON.
Les ONG, nouvelle forme d'humanisme
Elles sont indispensables pour défendre les valeurs menacées de la démocratie.
Il existe à travers le monde un nombre considérable d'Organisations Non Gouvernementales, dites ONG. Elles défendent diverses causes, de la protection des populations et de l'environnement à la surveillance des États. Une ONG est une organisation à but non lucratif, d’intérêt public ou ayant un caractère humanitaire qui ne dépend ni d’un Etat, ni d'une institution internationale. Ses membres sont des volontaires salariés ou bénévoles, organisés le plus souvent en association. Elles se développent à partir de la seconde moitié du XXe siècle en Occident. Les ONG disposent de moyens matériels et humains qui sont déployés sur le terrain.
Moyens financiers
Les moyens financiers permettent de faire face aux dépenses de fonctionnement et aux coûts des opérations. Ils sont rassemblés par des appels aux dons, des cotisations, des fonds privés et publics et des subventions internationales, étatiques et des placements financiers. Enfin, il est essentiel d’avoir accès à des moyens de communication. Les ONG disposent des médias classiques et des nouvelles technologies numériques. Elles peuvent aussi se constituer en coalition pour accroître leur influence ou coordonner une action.
Elles contribuent à informer et éduquer le public sur les actions des gouvernements. Cela permet aux populations de se créer leur propre opinion et de prendre des décisions. Elles se doivent de veiller au respect des constitutions et traités internationaux souscrits par les États.
Il existe plusieurs catégories d'ONG.
Quelle légitimité ?
Certaines, dites de plaidoyer, s'impliquent dans les négociations internationales.
Les organisations humanitaires se divisent en deux catégories : les caritatives qui effectuent des interventions d'urgence et de premiers secours aux populations en cas de catastrophe naturelle, exode, guerre, épidémie. Et les ONG de développement qui mettent en place des programmes plus ou moins longs, moins médiatisés, d'aide au développement : éducation, santé, approvisionnement en eau, lutte contre la pauvreté, défense des droits de l'Homme et de l'Enfant...
Ces organisations ne sont pas issues d'un processus démocratique, leur légitimité réside donc dans leur lien avec la société civile. Elles ont besoin de l'adhésion et du soutien de la population. Mais cela peut être remis en question en cas de dérives. Certains observateurs n'hésitent pas à évoquer du "charity business". Un article de Libération donne les clés pour vérifier la fiabilité d'une ONG. « La première chose à faire est de vérifier sur son site internet si elle compte des bailleurs institutionnels parmi ses donateurs. Comme l'ONU. C'est l'organisation qui réalise le plus d'audits lorsqu'elle finance un projet humanitaire. Si l'ONG est en lien avec elle, on peut être quasi sûrs de son bien-fondé » explique Nathalie Ferriere, universitaire spécialiste de l'aide internationale.
Lou-Marine POUILLARD.
Mortaza Behboudi capturé par les Talibans
Nous avions rencontré le jeune journaliste, l'année dernière. Il est détenu à Kaboul depuis début janvier.
Elèves de terminales en HGGSP, nous avons eu la chance de le renconter l'année passée. Ecrire cet article nous a semblé être une évidence.
Arrêté en janvier
L'Afghanistan occupe aujourd'hui la 156e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse de RSF. Mortaza Behboudi est journaliste franco-afghan. Il est né en 1994 en Afghanistan. Il appartient à la minorité chiite, minorité musulmane persécutée par les talibans. Sa famille émigre en Iran ; de retour dans son pays natal en 2010, Mortaza devient photographe. Persécuté, il s'exile en France en 2015 où il est reccueilli par la Maison des journalistes. Il travaille pour plusieurs médias ; c'est ainsi qu'il effectue des reportages dans son pays natal.
Arrivé le 5 janvier 2023 en Afghanistan, dans l'objectif de réaliser son reportage, il est arrêté à peine 48 heures après quand il s'apprête à récupérer son accréditation presse. Selon les autorités locales, le journaliste aurait espionné le régime taliban.
Le silence sur son arrestation a été maintenu par la famille du journaliste et les autorités françaises pendant un mois avant d'être révélée aux médias.
Une action pour sa liberté
Un hashtag, #FreeMortaza, a été lancé par Reporters Sans Frontières afin de médiatiser l'arrrestation et de dénoncer les restrictions des libertés d'expression et de libertés de la presse exercées par les talibans. Une pétition a été mise en ligne pour libérer Mortaza Behboudi.
Et maintenant ?
Alors que nous écrivons cet article, Mortaza Behboudi est toujours retenu par les talibans à Kaboul. On assiste à une vague de soutiens de la part de différents médias du monde entier ainsi que de particuliers ! Notamment à Douarnenez dans le Finistère, sa ville de coeur, où le maire a souhaité prendre la parole lors d'une réunion du comité de soutien. Il a affirmé : « Quand il reviendra, parce qu’il reviendra, nous organiserons un grand mariage ici, avec vous tous ! ». Avec sa compagne, Aleksandra, il souhaite en effet se marier une seconde fois dans le port finistérien.
Juliette GARRIGUE
et Garance HOLOWENKO.
Le Qatar, un pays autoritaire
La famille Al-Thani dirige cet émirat qui essaie de se faire une place parmi les pays démocratiques.
Le Qatar, émirat autoritaire de la péninsule arabique, est indépendant depuis 1973. Il est dirigé par le souverain de la dynastie Al Thani qui domine le pays depuis 150 ans.
Le Qatar est une monarchie absolue
Son système politique repose sur un émirat absolu qui base ses lois sur la charia (loi islamique). La famille régnante des Al Thani gouverne avec les représentants de quelques grandes familles et les tribus du pays.
L’un des géant du gaz
Le Qatar a connu un développement très rapide : pays pauvre dans les années 70, le Qatar possède en 2019 un des PIB (Produit Intérieur Brut) par habitant les plus élevés au monde et se situe au 33e rang pour l'IDH (Indice de Développement Humain). Ses réserves de gaz (24,7 milliers de milliards de m3) et de pétrole (25,2 milliards de baril en 2020) l'ont fortement aidé dans son rapide développement. C'est le premier exportateur mondial de gaz liquéfié. L’émirat prévoit d’augmenter sa production de plus de 50 % d’ici à 2027.
Un soft power en action
A la recherche d’une influence internationale, il développe son soft power. Depuis les année 90, le Qatar tente de diversifier son économie. Il développe le tourisme en faisant de Doha une destination mondiale. Le Qatar s’ouvre aux médias : la chaîne Al-Jazira a été créée en 1996 par un membre de la famille régnante. C’est la première chaîne satellitaire arabe d'informations « La CNN du monde arabe ».
Coupe du monde 2022
L’émirat investit dans le secteur sportif avec l’achat du Paris Saint-Germain en 2011. Il finance l’achat de joueurs prestigieux comme Zlatan Ibrahimovic en 2012, Neymar ou Kylian Mbappé en 2017. Le Qatar remporte l’organisation de la Coupe du monde 2022 mais cette décision provoque un vaste débat en France. Une enquête internationale visant les hauts responsables de la F.I.F.A. a été ouverte.
Atteintes aux droit humains
Les organisations non gouvernementales n'ont de cesse, toutefois, de dénoncer les atteintes aux droits humains : travailleuses et travailleurs migrants victimes d'atteintes à leurs droits (vol de salaires, travail forcé, exploitation et violences), femmes toujours victimes de discriminations, dans la législation et dans la pratique.
Amnesty International indique, de son côté, que les personnes LGBTI subissent de fortes discriminations et risquent d’être arrêtées et torturées. Si aucun journaliste n’est emprisonné, le Qatar réprime la liberté d’expression pour réduire les voix critiques au silence.
Des défis encore importants
Le Qatar est un pays influent grâce à ses ressources qui veut s'efforcer de paraître un pays « libre » pour faciliter ses échanges commerciaux. Mais les défis restent importants, particulièrement en terme de libertés individuelles et d'expression.
Esteban BLAMONT
et Théo CAOUREN.
Le régime politique en Chine
Les principes démocratiques se heurtent au pouvoir personnel de Xi Jinping.
A la prise de pouvoir de Mao Zedong en 1949, la Chine devient la République populaire de Chine (RPC) et connaît des changements politiques, économiques et sociaux importants. Mao est un leader charismatique, le « Grand timonier » suscite l'adhésion d'une grande partie de la population chinoise à son idéologie communiste. Il installe un pouvoir totalitaire, fondé sur un parti unique et un culte du chef. Sous sa direction, le pays connaît des périodes de violences politiques et de famines qui ont causé la mort de millions de personnes.
L'après Mao
Après la mort de Mao en 1976 la Chine connaît une période de transition politique et d'ouverture économique sous la direction de Deng Xiaoping, qui lance des réformes économiques radicales pour moderniser le pays. Il autorise l'existence d'entreprises privées mais de nombreux secteurs restent planifiés par l'État. Depuis lors, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, mais la situation des Droits de l'homme et de la liberté d'expression reste préoccupante.
Le massacre de Tiananmen
Le massacre du mouvement pro-démocratie de Tiananmen en 1989 est un événement tragique et violent. Les manifestants, principalement des étudiants, réclament une plus grande liberté politique et une réforme démocratique. Le gouvernement chinois réagit en envoyant l'armée pour réprimer violemment les manifestations, entraînant des pertes humaines considérables.
Régime actuel
Le régime chinois actuel est considéré comme autoritaire, Xi Jinping vient d'être reconduit pour la troisième fois à la tête de la Chine. Il maintient un parti unique -le parti communiste- au pouvoir. L'Etat contrôle la presse et les citoyens. Là encore, les observateurs dénoncent emprisonnements et persécutions des défenseurs des Droits de l'homme et des opposants politiques. Le gouvernement chinois utilise également des mesures de censure et de contrôle stricts pour limiter l'accès des citoyens à l'information et restreindre la liberté d'expression.
Restrictions et revendications
Malgré ces restrictions, de nombreux Chinois tentent d'exprimer leur désaccord contre la politique du gouvernement et cherchent à revendiquer leurs droits. Les manifestations de Hong Kong en 2019 mettent en lumière les tensions politiques entre la Chine et cette région autonome, où les habitants expriment leur colère contre la mainmise croissante du gouvernement chinois sur leur territoire.
Se battre pour l'avenir
En somme, la Chine a connu une évolution politique complexe au cours du siècle dernier, depuis les premiers jours de Mao Zedong jusqu'à l'ère actuelle de surveillance étatique et de restriction des libertés individuelles. Même si on a pu observer des protestations, fin 2022, face aux restrictions sanitaires liées au covid. La rue a eu gain de cause. En janvier, l'Etat a levé toutes les mesures de confinement en quelques jours à peine, à la grande surprise des observateurs occidentaux.
Solenn CLEACH
et Léna LE PARC.
La répression du peuple kurde
Depuis un siècle, les Kurdes ne sont pas reconnus dans les pays où ils vivent.
Depuis la fin de l'Empire ottoman en 1923, le peuple kurde a été victime de répression de la part des différents gouvernements au Moyen Orient. Les Kurdes forment un peuple de plus de 30 millions de personnes réparties principalement entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, à la source des grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Ce peuple a longtemps été privé de ses droits fondamentaux, notamment son droit à l’autodétermination et à la reconnaissance de son identité culturelle. Ce qui rend problématique la gestion des grands fleuves afin d'accorder un territoire aux Kurdes.
La répression du peuple Kurde dans les pays voisins
En Turquie, où la population kurde est très importante (15 % de la population nationale), la répression a été particulièrement brutale.
Depuis les années 1980, le gouvernement turc mène des opérations contre le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation considérée comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Ce conflit a fait des milliers de morts et a entraîné la destruction de nombreuses villes et villages kurdes.
En Iran, Irak...
En Iran, les Kurdes ont également été victimes de discriminations et de répression de la part des autorités. Les Kurdes iraniens sont privés de leurs droits politiques et culturels. Leur langue et culture sont souvent interdites. Les forces de sécurité iranienne ont réprimé violemment les manifestations kurdes.
En Irak, les Kurdes ont été persécutés sous le régime de Saddam Hussein, qui a mené une campagne de génocide (connu sous le nom d'Anfal) de février à septembre 1988 avec des bombardements aux armes chimiques. Depuis 2003 et l'intervention occidentale à la suite de la seconde Guerre du Golfe qui a mis un terme au régime, les Kurdes irakiens ont acquis une certaine autonomie dans le nord du pays. Cependant leur situation reste fragile et ils continuent à être confrontés à des défis politiques, économiques et sécuritaires.
En Syrie
Les Kurdes ont été impliqués dans le conflit syrien depuis ses débuts en 2011. Les Kurdes syriens ont créé leur propre administration dans le nord-est du pays, mais ils ont également été confrontés à la répression de la part du gouvernement syrien, ainsi qu'à l'hostilité des groupes armés islamistes. On peut notamment affirmer que les femmes kurdes ont joué un grand rôle dans la lutte contre l'état islamique.
Malgré la répression dont ils sont victimes, les Kurdes maintiennent leur lutte, soutenus par des organisations politiques, culturelles et sociales. La communauté internationale commence à reconnaître leurs droits et à exprimer son soutien. Cependant, il reste beaucoup à faire pour mettre fin à la répression et garantir les droits fondamentaux de ce peuple.
Tilio LAIGNEAU-LEGAVRE.
..
Les contestations d'une démocratie
La démocratie libérale est une forme de gouvernement qui s'est développé dans les années 1920 mais elle a connu de nombreuses contestations au cours de ce siècle.
Le vote
Le fondement de la démocratie est le vote des citoyens. Il permet d'exercer sa citoyenneté en participant à l’élection de ses représentants. Ce droit permet de contester le gouvernement, et faire jouer l’alternance politique en changeant les représentants aux différentes assemblées ou de les conserver.
La contestation des élections
Les résultats aux élections peuvent être contestés au-près du Conseil Constitutionnel grâce à l'article L248 du code électoral qui dit que tout le monde a le droit de contester devant un juge le résultat d'une élection. Cette contestation peut être faite à toutes les échelles électorales.
La fraude électorale
En 2008 à Perpignan, l'écart entre les condidats est très faible et un des président des bureaux s'est fait surprendre avec des bulletins de vote sur lui. L'affaire a été soumise à la justice. Aux États-Unis lors de l’élection de Joe Biden en 2020, Donald Trump a essayé de refaire le vote prétextant des faits de corruption. Ces deux exemples permettent donc de montrer une autre façon de contester.
Le rôle de l'opposition
L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis qui n'appartiennent pas à la majorité. Ils ont une fonction capitale dans un démocratie parlementaire et représentent les citoyens. L'opposition peut voter contre ou s'abstenir. Ils peuvent aussi soumettre des amendements. Leur présence mène à des débats souvent agités et force la majorité à réfléchir à des alternatives ou à renoncer à certains projets. L'existence de ces oppositions montre que lors des élections plusieurs programmes sont proposés. Les citoyens peuvent donc choisir leur préférence, c'est une condition du pluralisme politique. C'est pourquoi sans opposition politique la démocratie n'existerait pas, ce serait un régime dit autoritaire.
Les manifestations
Les manifestations sont l'expression du corps social, un bon moyen de montrer son désaccord avec les décisions prises par le gouvernement. Elles sont un acte collectif, encadré par des syndicats. Leur force vient du nombre de personne à manifester. Hors du champ syndical, le mouvement des "Gilets jaunes" en octobre 2018 est l'expression d'une "colère sociale" spontanée contre l'augmentation du niveau de vie des classes populaires et moyennes.
Les formes de constestation dans une démocration libérale sont nombreuses, et permettent d'exprimer son mécontetement. Si la violence est aussi une forme de contestation, elle ne peut être la solution d'une alternative politique.
James KIM et Yuna HALLE.
Dates clefs
1947-1991 : La guerre froide oppose les Etats-Unis à l'URSS.
1969 : Création d' un programme d'Unité Populaire - 6 partis de gauche soutiennent Salvador Allende aux élections présidentielles.
1970 : Election présidentielle, Salvador Allende obtient 36 % des voix. Le Congrès le nomme Président.
1971 : Visite de Fidel Castro au Chili pendant 23 jours.
Le 1er décembre : manifestations "la marche des casseroles vides".
11 septembre 1973 :
Coup d'état militaire, bombardement du palais présidentiel. Augusto Pinochet renverse le pouvoir démocratique.
Suicide de Salvador Allende à Santiago.
11 mars 1990 : Le Chili achève sa transition démocratique, fin de la dictature militaire.
Le Chili, une utopie démocratique
Le Chili dans les années 1970-1973.
Elections présidentielles
Salvador Allende se présente aux élections présidentielles chilienne le 4 septembre 1970 en tant que membre du parti socialiste et est soutenu par l’Unité Populaire.
Lors des résultats de cette élection il ne recueille que 36 % des voix.
N’obtenant donc pas la majorité absolue à un tour, c’est le Congrès qui doit nommer le président de la République. Mais dans le contexte de la guerre froide entre le bloc occidental (USA) et le bloc soviétique (URSS), le Congrès et les États-Unis sont réticents à proclamer un président d’inspiration marxiste. Finalement, grâce aux manifestations populaires, Salvador Allende devient président du Chili le 24 octobre 1970.
Position fragile
Malgré sa légitimité démocratique, sa position reste fragile car au Congrès le Parti démocrate-chrétien de droite possède la majorité et ne partage pas son idéologie. En revanche il peut compter sur l’Union Populaire et la classe ouvrière qui compose 46 % des activités professionnelles.
Il devient le premier Président élu démocratiquement sur un programme socialiste dans l'histoire de Chili.
Projet de société
Le projet de société de Salvador Allende pour son pays est simple et ambitieux. Il a pour volonté de mettre en place un système d'égalité sociale avec une redistribution de la richesse. Il instaure quarante réformes économiques et sociales qui permettent la mise en place progressive d'une prise de pouvoir pas les travailleurs. Il donne plus d’importance aux syndicats et aux dirigeants des structures directives de l’Etat et démontre que le pouvoir populaire constitue des piliers fondamentaux du gouvernement et de la société.
Inspiration marxiste léniniste
Le Président définit une politique d’inspiration marxiste-léniniste et entame la construction du socialisme. Il tente ainsi de libérer le pays de sa dépendance aux sociétés étrangères et de son retard économique et culturel.
Salvador Allende est à l’origine de nombreux espoirs chez les ouvriers, cependant ses choix politiques ont suscité des hostilités à intérieur et à l’extérieur du pays.
Ce qui a vraiment marqué l’échec du projet et ses espoirs démocratiques sont le rapprochement avec Cuba et la visite de Fidel Castro en pleine guerre froide orientant ainsi son gouvernement vers le bloc soviétique. Les État-Unis et la Banque mondiale décident alors de limiter l’aide économique, ce qui provoque une profonde crise économique. Le coût de sa politique déclenche une inflation du prix des marchandises, il perd par conséquent le soutien d’une partie de ses alliés politiques et de la population.
Rapidement, dès 1971, des manifestations dont celle de la « marche des casseroles vides » sont organisées pour protester contre les difficultés d’approvisionnement et d'appauvrissement d’une partie de la population.
Le 11 septembre 1973 le coup d’État militaire organisé par le chef d’Etat-Major de l'armée Augusto Pinochet renverse Salvador Allende qui se suicide. Il aurait dit : « Le président de la République élu par le peuple ne se rend pas ». Le Chili devient une dictature répressive dirigée par la "Junte de gouvernement".
Les réformes causent sa perte
Le Chili, grâce à Salvador Allende et aux nombreuses réformes socialistes qu’il a instaurées et à la redistribution des richesses, a pu amorcer une transition démocratique garantissant une meilleure qualité de vie et de travail aux Chiliens.
Mais toutes ces avancées ont provoqué sa perte et lui ont coûté la vie, basculant le Chili vers un régime autoritaire. Le 11 mars 1990 marque officiellement la fin de la dictature militaire. Le Chili est de nouveau une démocratie.
Rose-Merline LE DALL
et Lucas MAUDEZ.
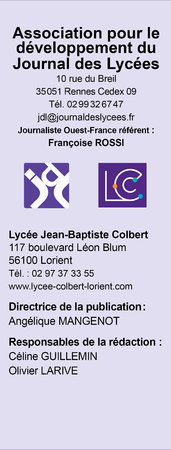
Franco et la guerre civile espagnole
L'irrésistible ascension du Caudillo de l'Espagne de l'entre-deux guerres.
Francisco Franco est né le 4 décembre 1892 à Ferrol et mort le 20 novembre 1975 à Madrid. Il a été général et homme d’État espagnol. A la tête d'une junte militaire, il s'engage en 1936 dans une guerre civile. Après la victoire des nationalistes en 1939, Franco prend le titre de "Caudillo" (le guide) et dirige l'Espagne jusqu'à sa mort. Il aura donc gouverné pendant 36 ans. Franco, presque inconnu en Espagne, est devenu une figure internationale. Retour sur son ascension.
La prise de pouvoir de Franco
En 1931 des élections sont organisées et emportées par les Républicains, ce qui donne naissance à la Seconde République espagnole et provoque la fuite du roi. En février 1936, de nouvelles élections amènent au pouvoir une coalition de gauche, le « Frente Popular » (Front populaire).
Prenant le prétexte des violences révolutionnaires qui secouent le pays, le général Franco lance en 1936 son coup d’État nationaliste.
Un pays coupé en deux
Le pays est coupé en deux avec d’une part, les forces nationalistes incarnant la droite conservatrice bénéficiant de l’aide déterminante d’Adolf Hitler et de Benito Mussolini, et d'autre part le camp républicain dominé par des formations de gauche et révolutionnaires avec le soutien de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et surtout des Brigades.
C’est le début de la guerre civile espagnole. Dès 1936, le conflit s’internationalise puisque les puissances étrangères apportent leur appui à chacun des deux camps.La guerre civile d'Espagne (1936-1939)
En 1934, les mineurs de la province de Guernica dans les Asturies se révoltent contre Franco. Il se charge de la répression du soulèvement qui provoque la mort de 3 000 personnes.
La guerre civile espagnole est souvent considérée comme le prologue à la Seconde Guerre mondiale.
Malgré l'aide de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et surtout des Brigades internationales, la défaite des Républicains permet l’établissement de la dictature de Francisco Franco. Les Républicains restés en Espagne font les frais d’une répression acharnée de la part du régime franquiste. Le conflit fait plus d’un million de victimes.
La figure internationaleDevenu maître de l'Espagne, Franco inaugure une longue dictature. Ce fut l'un des derniers pays autoritaire en Europe de l'Ouest. Au lendemain de sa mort, le 20 novembre 1975, le nouveau roi d’Espagne Juan Carlos, désigné par le Caudillo, fait passer en quelques mois le pays dans le camp des démocraties.
Wendy LEOTURE--GAILLARD
et Nina RYO.
La transition démocratique en Espagne
L'Espagne passe d'un régime autoritaire à une monarchie constitutionnelle.
1975. Le général Franco, dictateur soutenu par l'armée et l'Eglise, qui dirige l'Espagne depuis quarante ans sous un régime autoritaire, meurt. Le roi Juan Carlos Ier en succédant à Franco joue un rôle majeur dans la transition démocratique en nommant un premier ministre libéral : Adolfo Suarez. Après sa disparition, les craintes d'une nouvelle guerre civile se sont avérées infondées.
La transition démocratique
Après plusieurs décennies de dictature sous le régime de Franco, les Espagnols sont arrivés à mettre en place des institutions solides. De plus, la royauté a été maintenue et intégrée à la démocratie instituant ainsi une monarchie constitutionnelle avec un parlement appelé Cortes. Malgré une tentative de coup d'Etat militaire, dirigé par le lieutenant-colonel Antonio Tejero, le gouvernement reste en place et le Congrès des députés ouvre le second vote d'investiture du président. Après la mise en place de ce régime, une constitution a été approuvée majoritairement par un référendum en 1978.
L'héritage
Aujourd'hui, l'Espagne est considérée comme l'un des régimes démocratiques les plus stables d'Europe, mais l'héritage du franquisme continue de peser sur la société espagnole.
L'une des conséquences les plus visibles est le maintien de la mémoire de la dictature dans l'espace public. Bien que de nombreux monuments liés à Franco sont démolis, certains restent encore debouts, témoins de la période sombre de l'histoire espagnole. Les débats sur la manière de traiter la mémoire de la dictature restent vifs, avec des opinions divergentes sur la façon de gérer les vestiges du franquisme.
Les cicatrices
De plus, le franquisme laisse des cicatrices profondes dans la société espagnole. Des milliers de personnes ont été persécutées, emprisonnées, torturées et assassinées. Leurs descendants continuent de souffrir de ces exactions. L'Espagne prend des mesures pour réhabiliter les victimes, mais le chemin vers la réconciliation est encore long.
Malgré ces défis, l'Espagne fait des progrès considérables en matière de démocratie. La transition démocratique permet d'établir un système politique pluraliste, avec des partis politiques variés, un système judiciaire indépendant et un système médiatique libre. La société espagnole est de plus en plus pluraliste et inclusive, avec une reconnaissance croissante des droits des minorités.
Alors que le pays poursuit son engagement en faveur de la démocratie, il est important pour la société espagnole de continuer à affronter les défis liés à l'héritage de la dictature et de travailler à construire une société plus juste et plus équitable pour tous.
Efflam QUEFFELEC
et Aymeric DELOMEL.
Quand l'Amérique devient indépendante
A la fin du XVIIIe siècle, le pays s'est libéré de la domination britannique.
Washington, États-Unis d'Amérique. La révolution américaine de 1775 et 1783, est considérée comme un tournant décisif dans l'histoire de l’Amérique : les colons britanniques, futurs américains, se rebellent contre la domination de la couronne britannique et proclament leur indépendance. Cette guerre d’indépendance participera à la diffusion des idées de liberté et de démocratie en Europe.
Pour l'indépendance
Au XVIIIe siècle, les colons américains sont mécontents des politiques économiques et fiscales imposées par le gouvernement britannique : inégalités politiques et taxes excessives sur les produits d’importation comme le thé, se révoltent et organisent la Boston Tea Party, première révolte politique en 1773. Des leaders tels que George Washington, un des planteurs les plus riches, prend le commandant des troupes américaines et les mène à la victoire. Thomas Jefferson et Benjamin Franklin seront les principaux rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Signée le 4 juillet 1776, elle affirme solennellement l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cet acte donne naissance à une nation souveraine et démocratique, gouvernée par des principes de liberté, d'égalité et de justice, d’autonomie garantie aux États américains.
Nouvelle Constitution
Le nouveau gouvernement rédige la Constitution américaine en 1787, et conteste l’esclavagisme. C’est en 1865 avec la victoire des États du nord que prend fin la guerre civile - guerre de Sécession. Le président Abraham Lincoln abolit définitivement l'esclavage aux États-Unis. Toutefois, dans le Sud des États-Unis va s'installer un régime de ségrégation raciale, d’apartheid.
Influence en Europe
La révolution américaine va inspirer d'autres mouvements politiques et établit un précédent pour la self-rule démocratique. Le marquis de La Fayette, Français engagé aux côtés des insurgés américains, va importer en France ces principes de liberté, de démocratie, et alimenter les idéaux des révolutionnaires français.
Au XIXe siècle, cette jeune nation construite sur des bases de liberté va jouer un rôle dans les relations internationales. Jusqu’en 1910, plusieurs millions d’Européens fuiront le despotisme et la misère en Europe pour tenter leur chance aux États-Unis. Au XXe siècle, elle renforce ses liens avec les autres nations démocratiques et contribue à la formation d'une communauté internationale fondée sur les valeurs de liberté et de démocratie. La révolution américaine est un moment historique majeur dans l'histoire et les Etats-Unis restent un symbole de liberté.
Alexis GOURLAIN et
Gian-Benoni ROTOLO--ROPERC.
Des oeillets pour le Portugal
La Révolution des Oeillets met fin au régime fasciste et devient un exemple de transition démocratique pour le Portugal et pour le monde entier.
La Révolution des Oeillets du 25 mars 1974 est une révolution politique et sociale au Portugal. Elle met fin à quarante-huit ans de dictature. Elle s'inscrit dans un processus international de libération et de démocratisation des pays en dictature.
En 1926, le Portugal est devenu une dictature par un coup d’État militaire. Il met fin à la Première République portugaise. Le contexte politique international du début et milieu du XXe siècle est un épuisement des démocraties libérales et de multiplications des dictatures, fascistes en Europe, et communistes en Amérique du Sud. Antonio Salazar a pris la tête de cette dictature en 1932, jusqu'en 1968 ; Marcelo Caetano lui succède.
Un vent de liberté
Cette dictature a commencé à devenir très impopulaire au début des années 1960 : les guerres coloniales menées en Angola par Salazar mobilisent beaucoup d'hommes. Le service militaire est de plus en plus décrié et provoque la colère des Portugais. Le général Spinola est limogé après s'être déclaré hostile à la poursuite de la guerre dans les colonies. L'économie du Portugal est à l'arrêt et les Portugais migrent massivement vers les autres pays européens : ils sont 500 000 en France en 1968.
L'histoire nous enseigne qu'il est rare que des militaires s'inscrivent dans un processus révolutionnaire et démocratique. Souvent à l'initiative d'un coup d’État, ils instaurent ensuite une dictature militaire et un régime autoritaire. A contrario, les processus révolutionnaires sont en général menés par les classes ouvrières, paysannes et le peuple en son ensemble car c'est dans leurs intérêts sociologiques de classe.
Création du MFA
Les jeunes soldats portugais qui ont vécu les atrocités de la guerre, du colonialisme et du pouvoir se sont révoltés. Ils fondent le M.F.A. (Mouvement des Forces Armées) majoritairement composé de jeunes capitaines de l'armée de terre qui ont servi dans les guerres coloniales.
Le 25 mars 1974, c'est le grand soir. Le M.F.A. réussit son coup d'Etat, intervient à la radio : la Révolution des Oeillets doit être le symbole de la fraternisation et de la paix entre les Portugais. L'allocution implore au calme , afin « d'éviter tout affrontement avec le reste des forces armées ». Cette révolution est un mouvement pacifiste, bienveillant, humain et solidaire, symbole de transition politique, d'une dictature à un régime politique démocratique. Le 26 avril 1974, Spinola devenu chef de la Junte de Salut National, restaure les libertés publiques. Les prisonniers politiques sont libérés, dont Mario Soares. Ce socialiste, farouche opposant à Salazar, est nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement constitué par le président Spinola.
Nataël SERRU.
A Nantes, la parole aux citoyens
« Cabanes, arbres fruitiers, terrain de sport »... Mi-décembre, à Nantes, ils étaient une soixantaine réunis dans la salle Aristide Briand à imaginer leur cour de récré.
La ville de Nantes s’est engagée à rénover 51 cours d’écoles d’ici 2026. C’est pourquoi un forum participatif a été instauré. Enseignants, parents d’élèves, élèves, tous répondent présents. L’objectif : faire des propositions pour rendre les cours de récréation plus vertes, mieux adaptées au changement climatique, plus égalitaires et ainsi permettre aux architectes d'imaginer les écoles de demain. Les travaux restitués servent de base aux propositions qui seront présentées mi-mars 2023 lors de la prochaine séance participative.
Un potager collectif
Ce dialogue citoyen est mis en place par la municipalité sur des projets qu'elle a définis et auxquels elle souhaite associer les citoyens. Avec ces budgets participatifs, financés par la municipalité, ils deviennent force de proposition. Si le projet est retenu, la ville le concrétise. Exemple au square des Lauriers : un potager collectif a été créé par des associations. Elles voulaient s'organiser autour d'un projet de jardinage qui rassemble les acteurs du quartier et les habitants. C’est aujourd’hui un espace agréable où l'on échange des pratiques de jardinage et où on accueille des animations pédagogiques ou de quartiers comme la fête de la soupe.
A l'université
De son côté, la présidente de l'université de Nantes, Carine Bernault, souhaite mettre en place les conditions d’une démocratie plus collaborative. Pour cela, le professeur de sciences politiques, Arnauld Leclerc, organise des dispositifs fondés sur la transparence des débats et décisions prises par les instances. L'objectif ? Renforcer la démocratie au sein de l’université, expérimenter de nouvelles formes de participation et de délibération.
Ses limites
Mais ces expérimentations ont leurs limites : elles prennent beaucoup de temps, car cela demande une implication importante pour les citoyens qui participent aux projets. C'est aussi un coût financier pour la collectivité qui les organise. Surtout quand aucune décision concrète n’est appliquée. On peut aussi regretter d’avoir participé quand les organisateurs ne prennent pas en compte les propositions... et ne plus s’impliquer dans les projets à venir. Dans certains cas, la démocratie participative peut exclure des citoyens. En effet, il faut pouvoir prendre la parole en public, se libérer et se déplacer.
Nantes est un bon exemple des réussites mais aussi des limites de la démocratie participative au niveau local. A-t-on intérêt à étendre cette méthode au niveau national ? Les prochaines années nous le diront mais déjà les partis politiques, de droite ou de gauche, s'y intéressent de plus en plus.
Marion FRABOULET
et Tifanny LE HELLARD.
Les lycéens affichent le harcèlement
Des élèves de secondes générale et professionnelle du lycée Colbert de Lorient ont réalisé des affiches et une vidéo pour dénoncer le harcèlement.
Le 10 février dernier la seconde TCI (bac chaudronnerie industrielle) et la seconde 2 du lycée Colbert ont participé au concours "Non au harcèlement" (NAH) organisé par le Ministère de l’Education nationale avec le soutien de la mutuelle MAE.
Le but principal
L'objectif est de donner la parole aux jeunes pour qu’ils s'expriment collectivement sur le harcèlement à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo, qui servira de support de communication préventif dans leur établissement.
La conception
Que disent les lauréats de leurs créations ? Paloma et Alexandre de seconde 2 racontent que dans un premier temps un sondage sur Pronote (réseau interne au lycée) a été lancé pour élire la meilleure affiche des deux classes. Au total, plusieurs affiches ont été proposées pour le vote au lycée.
Ils nous dévoilent les secrets de la composition de leur support gagnant : Lola et Alexandre expliquent : « Pour le slogan de l’affiche nous nous sommes inspirés des pancartes exposées durant les manifestations contre le sexisme comme par exemple « Victime on te croit, agresseur on te voit . Sur l’affiche on a fait ressortir sur le dos de l'une d'entre nous les différentes insultes sexistes que l’on peut entendre dans notre société ».
Message fort
En parallèle, les élèves et quelques professeurs ont créé une vidéo sur ce même thème. Après un vote, ils ont fait le choix du format vidéo (https://www.youtube.com/watch ?v=aKJpsIaQiWU) plutôt que de l’affiche pour être envoyé au concours NAH académique.
Sur ce support les élèves dévoilent une autre facette du harcèlement : « Quand le harceleur devient la victime suite au suicide d’un élève harcelé ».
Tous ces élèves mettent en lumière un problème de notre société grâce à leur talent.
Dans l'attente des résultats
La promulgation des résultats se fera au mois de mai pour les résultats académiques, en juin pour les résultats nationaux. Si chacun est dans l'attente des résultats, tous restent engagés dans ce programme de lutte contre le harcèlement dans les établissements scolaires.
Félicitation à eux !
Rose-Merline LE DALL,
Maudez LUCAS et Yuna HALLE.
Ronan Loas, maire de Ploemeur
Rencontre avec l'élu de 40 ans.
Pouvez-vous nous résumer votre parcours, ce qui vous a amené à être maire ?
Je suis né à Ploemeur et j'ai effectué ma scolarité à Lorient, suivi d'un BTS à Brest. J'ai démarré ma carrière professionnelle dans des groupes d'assurance, "chassé", comme on dit, pour devenir directeur financier à Paris jusqu'en 2010. Mais ma société a changé de groupe. J'ai préféré revenir à Ploemeur. J'y ai créé une start-up dans le développement durable avec un associé ingénieur, qui a depuis cessé ses activités. J'envisageais de retourner à Paris. Mais, passionné de politique, de tradition gaulliste, je me suis lancé en étant investi par le groupe divers droite, comme tête de liste aux municipales de Ploemeur en 2014. On m'a prédit que ça serait compliqué. Mais j'ai gagné avec 99 voix d'avance. J'ai été réélu en 2020 au premier tour.
En quoi, en tant que maire, êtes-vous garant de la démocratie ?
Le maire ne prend pas de décision tout seul. Certains pouvoirs lui sont délégués, mais il doit rendre des comptes au conseil municipal. Toutes les autres décisions sont soumises au vote. Avant elles font débat. Le maire a toute une équipe autour de lui et doit faire preuve de transparence. Le conseil municipal est public. Tous les documents sont disponibles.
Est-ce difficile ?
Un dossier peut être très bien pour l'intérêt général mais pas pour l'intérêt privé de certaines personnes. Sur la question des éoliennes ou des arrêts de bus, il en faut mais personne n'en veut juste devant chez lui. Ces dossiers doivent être débattus avec les riverains. Par exemple, au sujet de l'extension des Kaolins, une démarche consultative a été entreprise, depuis 2014, et une enquête publique va être enclenchée. Les délais sont longs. Le maire doit instruire le dossier et modifier le plan d'urbanisme. Mais les avis sont très partagés. Les gens contre sont souvent plus mobilisés que les gens pour.
Le dialogue fait-il avancer les choses ?
Les Kaolins représentent de l'emploi, et les questions environnementales ont été étudiées. Le rôle du maire est de permettre à tout le monde de discuter, malgré les tensions, en organisant des réunions afin d'entendre les opinions. Par ce dialogue, le projet évolue et son acceptabilité augmente. On doit toujours identifier si quelqu'un parle de l'intérêt général ou particulier. Avant, on faisait confiance au maire. Maintenant, avec internet, tout le monde a un avis sur tout et devient spécialiste.
Energie, écologie, quelles sont vos actions ?
A l'échelle de la ville, on n'a pas attendu d'être dans le dur, pour agir. Ce fut un des premiers sujets pris en charge en 2014, question de génération ? Cela a mené au plan Ploemeur 2030, pour le renouvellement urbain et la mobilité. Nous avons développé les voies vélo, par exemple vers Quéven ou le Fort Bloqué. Pour structurer sa transition énergétique, la ville s'est engagée dans une démarche à l'échelle européenne : elle est évaluée selon plein de critères. Sa capacité de progression est indiquée. La ville est labellisée "territoire en transition écologique". Deux mesures importantes de cette politique ont été le passage à un éclairage public LED (qui fait aussi baisser les coûts), et une nouvelle cuisine centrale, qui favorise les circuits courts et le bio.
Quant au volet social ?
Malgré l'augmentation des coûts, on a augmenté la rémunération des agents de la ville. Cette mesure permet de lutter contre la précarisation de la fonction publique. De plus, aucun impôt n'a été augmenté, malgré plein de projets qui auraient pu être financés ainsi. Mais on doit voter des tarifs (cantine, médiathèque, piscine... ), qui évoluent avec l'inflation. On ne les a augmentés que de 2 %, contre 15 % d'augmentation pour la ville. Le CCAS permet aussi d'aider les Ploemeurois grâce à des fonds solidarité-logement, dont le nombre a augmenté à Ploemeur. On peut aussi réguler les tarifs des sorties avec la maison des jeunes par exemple.
Comment cela se passe avec votre opposition ?
Mon rapport avec l'opposition est très différent de mon premier mandat. Avant, les débats étaient plus longs, mais politiquement construits. Aujourd'hui, beaucoup moins. Au niveau local, aller chercher des gens de différents horizons politiques marche très bien, je l'ai fait dans mon équipe. Mais les oppositions s'opposent parfois sur des sujets qu'elles ne comprennent pas. Elles sont censées empêcher la majorité de faire des bêtises, mais on dirait qu'elles sont contre tout. La réflexion est plus difficile, les débats plus compliqués. Il n'y a pas d'écoute, et cela isole l'opposition.
Avez-vous déjà remis en question votre engagement politique ?
Non : j'ai toujours été engagé en politique, dans des associations ou par du militantisme. Mon voyage récent en Ukraine découle de cette fibre d'aller vers l'engagement. En tant que maire, on se fait parfois un peu engeuler gratuitement : je suis maire, pas souffre-douleur, et je trouve parfois ça un peu ingrat. En plus, je suis l'élu le plus en proximité, personne ne connait la députée. Mais ce sont les réalisations et l'engagement qui permettent d'être heureux.
Vos meilleurs souvenirs ?
Mon voyage en Ukraine a été un moment fort. La Marianne d'or reçue pour la décarbonation de Ploemeur a été une belle récompense. Le conseil municipal des jeunes a été un projet très enrichissant. Sinon, une réalisation en terme d'habitat sur Larmor : un accueil pour les jeunes adultes ayant des troubles cognitifs.Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi ?
Je suis trop addict ! Mine de rien, ça permet d'être au courant des choses, et ça permet une spontanéité et un échange permanent. Les Facebook live sont toujours très suivis, ils ont battu des records pendant la COVID. Ils permettent une démocratie très directe.
Envisagez-vous un troisième mandat ?
Je ne sais pas encore. Mon premier mandat a été compliqué dans sa construction, mon second a été traversé par trois ans de crises. J'adore ce que je fais, et j'ai une bonne équipe qui m'entoure, mais c'est aussi compliqué pour ma vie personnelle, j'ai besoin de souffler un peu.J'ai toujours dit que je m'arrêterai quand je n'aurai plus envie d'aller vers les gens. C'est une réflexion importante.
Propos recueillis par
Maël LE MESTRE
et Lou-Marine POUILLARD.
Figure locale de l'engagement politique
Rencontre avec Michel Le Mestrallan, engagé politiquement à Ploemeur.
Instituteur, professeur, chef de collèges puis de lycées durant 28 ans, Michel Le Mestrallan, 69 ans, retraité, nous livre son expérience politique.Pouvez-vous nous résumer votre engagement politique ?
« Je suis militant politique de longue date. J’ai eu deux mandats, un mandat de conseiller municipal dans la majorité d’une grande ville de la région parisienne, et un mandat de minoritaire dans la commune de Plœmeur, de 2014 à 2020 ».
Où vous situez-vous sur l'échiquier politique ?
« Je suis adhérent d’un parti politique, le Parti Communiste Français. Le mandat que j’avais à Plœmeur était dans le cadre d’une alliance entre différents partis de gauche et écologistes ».
Dans quelle commission siégiez-vous ?
« Je siégeais dans la commission finance ressources humaines, la commission finance ayant la particularité de rassembler beaucoup de sujets. Elle participait à toutes les autres commissions (urbanisme, culture, éducation). [...] C'était intéressant de voir quels usages il est fait de l'argent des citoyens pour orienter les actions. Tout est source de besoins financiers. C'est là que se fait le pilotage.
Au moment du vote du budget ?
« Par exemple, le débat d’orientation budgetaire 2023 est un moment obligé, le maire doit présenter ce qu’il va faire avec l’argent de la commune. Il n'y a pas de vote, mais une information obligatoire ».
C'était difficile d'être dans l'opposition ?
« On se contente de constater, on ne décide pas, c'est un rôle de contrôle, de contestation, éventuellement de propositions. On ne dispose pas de tous les éléments d'information, on n'a pas les clés de la maison, on se contente de réagir sur des propositions si le maire, et en l’occurrence c’était le cas, ne souhaite pas vous associer aux décisions et vous informer, on n'a qu'un rôle de réaction et non d’opposition. C'est le maire qui décide du temps de parole de chacun ».
Avez-vous un exemple de dossiers où vous avez pu faire valoir ce rôle d’opposition ?
« On ne pourra pas au bout du compte, s’opposer, en nombre on ne peut pas. Mais faire avancer le dossier, oui. Par exemple, sur la question du logement, faire savoir que peut-être il y a des solutions à trouver pour plus de mixité sociale dans la ville. On a formulé des propositions ».
Lesquelles ?
« Sur la question du PLU (Plan Local d'Urbanisme), on a eu une certaine écoute, non pas de la part du maire, qui n’entendait pas, mais du préfet, qui a, sur avis des commissaires enquêteurs de l’enquête publique, décidé de ne pas accepter le PLU. Nous avons contribué à donner des arguments pour montrer que ce PLU proposé par M. Loas il y a 4 ans, n'était pas bon. Il a été repoussé par le préfet. Nous étions parmi ceux, avec d'autres citoyens, à dire que ce PLU n'était pas satisfaisant et qu’il ne répondait pas à certains critères écologiques, de mixité sociale ou de développement de la ville. On a mis l'accent sur les points qui nous semblaient faibles. On avait dû déposer une trentaine de pages d’observation auprès du commissaire enquêteur ».
Quel rapport avez-vous à l'engagement politique, combien de temps y consacrez-vous ?
« Selon moi, pour arriver à être militant politique, il faut une certaine connaissance des lieux, des personnes. Cela demande du temps. Je lis trois journaux, dont deux locaux, cela me prend plus d’une heure chaque matin. Au sein de mon parti, il y a des instances et des réunions, il faut du temps pour les préparer et y participer ».
Et le plus important pour vous ?
« C'est l’idée de peser sur des choix sociétaux qui influent sur la vie de l’ensemble des citoyens, de faire partager des avis. Les questions politiques ont beaucoup d'importance car ce sont celles qui font que la société bouge de la manière dont on veut qu'elle bouge. Ce sont des options philosophiques personnelles. Il faut du recul par rapport aux évènements ».
Dans quelles associations êtes-vous engagé ?
« En tant que citoyen, je suis membre de plusieurs associations : les Riverains des Kaolins, les habitants du Courégant (A.V.E.C, Association Pour le Vivre Ensemble au Courégant), les pécheurs plaisanciers du Courégant, Tarz Heol (association environnementale), qui sont de natures très diverses ».
Avez-vous l’impression de pouvoir jouer un vrai rôle ?
« J’ai la sensation de ne pas avoir affaire à quelque chose de frontal, mais plutôt de fraternel, d'être parfois dans la confrontation mais plus souvent dans la construction, c'est plus facile ».
Auriez-vous aimé être maire ?
« Aimé non. En sachant que cela aurait pu être possible en région parisienne, j'aurais pu devenir maire d'une grande commune, mais je n'en avais pas envie. Etre maire, c'est un statut très particulier, un temps plein, il faut être sous les feux de l'actualité locale en permanence ».
Propos recueillis par
Lou-Marine POUILLARD
et Maël LE MESTRE.