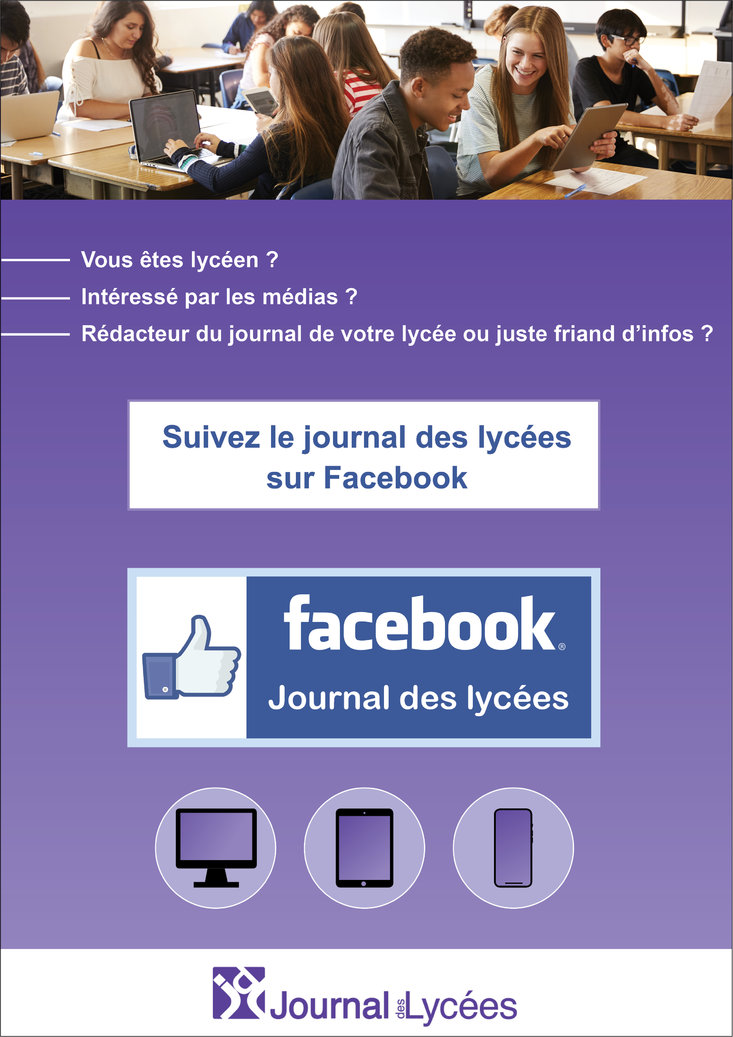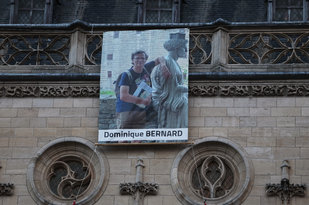Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Un monde en guerre(s)
Après l'Ukraine, l’attaque du Hamas sur Israël du 7 octobre a plongé le Proche Orient dans une nouvelle guerre dont personne ne sait comment elle peut s'achever et sur quoi elle peut déboucher.
Éditorial
« Il est plus facile de faire la guerre que la paix » (Georges Clemenceau)
"Faire la guerre, faire la paix" tel est l'intitulé du thème 2 du programme d'Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences politiques en classe de terminale. Au vu de l'actualité de ces derniers mois, force est de constater que la guerre est partout, de l'Ukraine au Proche-Orient en passant par le Karabakh, sans omettre ces guerres "oubliées" du Tigré, du Soudan ou à l'Est du Congo.
Ces conflits, où le droit international et les droits humains les plus élémentaires sont bafoués, révèlent l'échec et l’impuissance de la "communauté internationale", de l’ONU et du multilatéralisme.
Alors, dans ces conditions, comment faire pour que la paix ne soit pas qu'un idéal inatteignable ? Comment la construire ? Peut-être en s'appuyant sur les peuples et les sociétés civiles comme nous le suggère Bertand Badie dans l'entretien exclusif qu'il nous a accordé lors du dernier Forum mondial Normandie pour la paix (à lire en page 10). Pour le politologue et expert en relations internationales, la paix est aussi un fait social et « le social court plus vite que le politique et quand les manettes du politique ne répondent plus ce sont les dynamiques sociales qui prennent le relais"
Désormais, le réglement des conflits et la stabilité internationale ne peuvent plus dépendre uniquement des dirigeants ni même des instances internationales et il est illusoire de vouloir y parvenir sans y associer les sociétés, et peut-être plus particulièrement les femmes qui sont un levier puissant pour construire la paix. C'est peut-être aussi le message que nous délivre Narges Mohammadi, Prix Nobel de la Paix 2023 (lire son portrait page 7).
A travers leurs contributions à la réalisation de ce numéro 2 de "Georges Décrypte", nos élèves ont aussi voulu, à leur échelle, contribuer au défi de la construction de la paix. N'hésitez pas à les féliciter pour leur travail et leur engagement. Bonne lecture.
Jean-Luc VILLEMIN.
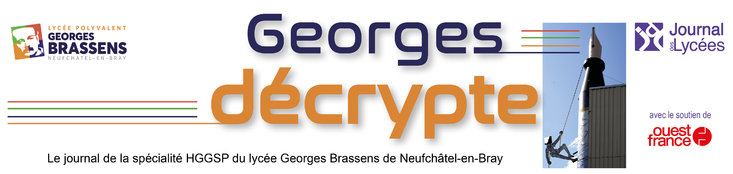
| N° 2 - Novembre 2023 | brassens.lycee.ac-normandie.fr |
La guerre du Tigré, un conflit oublié
Au Tigré, région d’Éthiopie, la guerre s'est achevée sans véritable retour à la Paix.
La guerre du Tigré qui s'est déroulée de 2020 à 2022 loin des caméras, fait partie de ces guerres oubliées. L'accord de Paix en vigueur depuis novembre 2022 est loin d'avoir réglé ce conflit comme le prouve la reprise récente des combats dans plusieurs régions du pays. Le Tigré, une région éthiopienne autonome
Le Tigré qui a pour capitale Mekele est situé au nord du pays, à la frontière de l'Erythrée et du Soudan. Il est peuplé de six millions d'habitants appartenant pour la plupart à l’ethnie tigréenne qui représente environ 6 % de la population totale de l'Ethiopie, véritable mosaïque ethnique, situation propice aux revendications identitaires et territoriales.
Une guerre complexe
La guerre a commencé en novembre 2020 par une offensive lancée par le gouvernement central pour renverser les autorités rebelles du Tigré issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Ce mouvement qui dirige la région autonome, a été accusé d’avoir attaqué des bases de l’armée fédérale au Tigré. Mais le conflit remonte en fait à 2018 avec l’arrivée du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed d’origine oromo, l’ethnie la plus importante du pays. Ce dernier, Prix Nobel de la paix en 2019 pour ses efforts en vue de la résolution du conflit avec l'Erythrée, a écarté du pouvoir fédéral le Front de Libération du Peuple du Tigré (TPLF) qui était une force politique majeure en Éthiopie depuis 1991. La guerre a opposé en premier lieu le gouvernement central éthiopien au TPLF mais d'autres acteurs se sont impliqués. En 2021,l'Érythrée prend part au combat du côté de l’Éthiopie soutenue aussi par la Chine, la Russie, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. De son côté le FLPT s'est allié avec l’Armée de libération Oromo (OLA) dans le but de renverser le gouvernement fédéral. Finalement après presque deux années de guerre, des pourparlers de paix se sont engagés sous l'égide de l'Afrique du Sud aboutissant le 12 novembre 2022 à la signature d'un traité de paix.
Des conséquences catastrophiques
Ces 2 années de guerre auront fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes. 5,5 millions de personnes souffrent aussi de malnutrition du fait du conflit. L’ONU a accusé l’armée du Tigré de "crimes de guerre" ainsi que de "crimes contre l’humanité".
Une reprise des affrontements armés
Durant l'été 2023, des affrontements armés ont repris dans plusieurs régions du pays. Le 4 août 2023, le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence et commencé à déployer des troupes dans la région d'Amhara. Le 13 août, une frappe aérienne a tué 26 personnes sur une place animée de Finote Selam.
Louane FACQUET
Clémence FONTAINE.
En RDC, 30 ans de crimes et d'impunité
Prix Nobel de la paix, le Dr. Denis Mukwege affirme que dans son pays, la République démocratique du Congo, « l'impunité fait partie de la géopolitique »...
Candidat à la prochaine élection présidentielle de décembre 2023, le Docteur Mukwege définit la situation de son pays ravagé par la guerre comme "critique".
Depuis trente ans et également depuis le génocide au Rwanda, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de guerres successives et complexes. Elles impliquent des dizaines de groupes armés, certains congolais, d'autres provenant ou soutenus par les pays voisins notamment le Rwanda.
Des richesses convoitées
On recense 4 à 6 millions de victimes, le plus lourd bilan depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela continue aujourd'hui encore dans la région du Nord Kivu où l'armée congolaise affronte les rebelles du "Mouvement du 23 mars" (M23), la "bête noire de la RDC".
La situation conflictuelle trouve notamment ses origines dans le pillage de ses minerais stratégiques (cobalt, cuivre, etc.) par les pays voisins, particulièrement le Rwanda. Face à cette situation, le pouvoir à Kinshasa n'est pas en capacité de lutter efficacement pour contenir les violences et la communauté internationale reste silencieuse malgré la présence d'une mission pour la paix de l'ONU, la MONUSCO.
De nombreux crimes contre les civils
Les populations locales sont les premières victimes de la violence des groupes armés et de l'armée congolaise, une armée composée de "mixés et de brasés", expression utilisée pour désigner les anciens rebelles enrôlés, souvent coupables de viols. L'ONG Public Healt a ainsi révélé que plus d'1,8 million de femmes ont été violées au moins une fois dans leur vie. Certains Casques Bleus sont aussi accusés de connivence avec certains groupes armés et de "crimes contre l'humanité".
Pire, les agresseurs bénéficient d’une impunité absolue. Le silence de la communauté internationale, notamment de la part des grandes puissances, est inquiétant vis-à-vis de la population congolaise Alors que ces puissances s’élèvent face aux crimes commis en Ukraine par l'armée russe, leur attitude suscite l’incompréhension des Congolais. Elle contribue à l’invisibilisation de ce conflit.
Tess DUVIVIER.
Soudan, les humanitaires s'alarment
Depuis presque qu’un an maintenant, le Soudan fait face à une guerre civile.
Depuis avril 2023, une nouvelle guerre civile a éclaté au Soudan. D’ un côté l’armée au pouvoir, dirigée par le général Burhane ; de l’autre les forces de soutien rapide (FSR), organisation paramilitaire avec à sa tête le général Dalgo. Les deux acteurs peuvent compter chacun sur des soutiens extérieurs, l’Egypte pour Burhane, les Emirats Arabes Unis pour les FSR.Ce conflit est principalement localisé à Khartoum, la capitale qui ressemble désormais à un vrai champ de bataille et dans la région du Darfour, à l'Ouest du Soudan. Depuis le début du conflit les violences n’ont cessé, attaques aériennes, bombardements, tirs...
Aujourd’hui, le bilan est assez lourd. On compte plus de 9 000 morts, et plus de 7,1 millions de déplacés, qui fuient dans les pays voisins, particulièrement au Tchad.
Un désastre humanitaire La crise sanitaire s’aggrave dans le pays. Plus de la moitié des habitants ont besoin d’aide. Les combats se déroulent dans des conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique : Inondations ou encore fortes périodes de sécheresse ont des conséquences désastreuses.
La perte importante des récoltes complique encore plus la vie des familles. Elle affecte des centaines de milliers de personnes, notamment des enfants.
Aujourd’hui, 700 000 enfants souffrent de malnutrition. S'ajoutent des maladies comme le choléra ou la rougeole, entraînant des besoins de traitements vitaux, alors qu’environ 70 % des hôpitaux sont pillés ou détruits.
En ville, les services sont désormais très limités. Les établissements encore ouverts manquent de matériel pour soigner la population. L'eau courante, l'électricité, les réseaux téléphoniques et internet sont également défaillants. C’est pourquoi, au-delà des frontières, les organismes humanitaires tirent la sonnette d’alarme, en particulier au Soudan du Sud, où 200 000 femmes et enfants sont arrivés épuisés en manque de soin et d'eau. Avec des tentatives de négociations jamais abouties, des généraux qui demandent de rester concentrés sur la guerre et des trêves jamais respectées, le conflit désastreux au Soudan semble sans issue.
Anaïs PESQUET,
Maëlys MAILLARD,
Ambre BEJOT.
Gabon, un avenir incertain après un putsch
Après six coups d’État sur le continent africain depuis 2019, c'est au tour du Gabon d'être concerné, le 30 août 2023 avec l'éviction du « clan Bongo ».
Le 30 août 2023 marque un tournant au Gabon, touché à son tour par un putsch militaire. Il s'ajoute aux coups d'Etat qui se succèdent en Afrique. En cause , la candidature à sa propre succession du président Ali Bongo, à la tête du pays depuis 2009. Lui-même a succédé à son père, Omar Bongo. C'est la fin d'une dynastie, du "clan Bongo". Elle est le fait d'un groupe militaire, mené par le général Brice Oligui Nguema, fort d'un soutien populaire.
Ali Bongo, un président renié
Ali Bongo était sur le point d'entamer son 3e mandat. Il aurait été le mandat de trop. Voir le clan Bongo, à la tête du pays depuis plus de cinquante ans, devenait insupportable pour la grande majorité de la population. Les Bongo, prêts à tout pour se maintenir au pouvoir, ont instauré au fil des années un régime autoritaire. Les putschistes les ont accusés de fraude et de corruption par les putschistes. De plus, le président sortant se voyait affaibli par la maladie, un AVC en 2018, remettant en cause depuis quelques années, sa capacité à diriger le pays.
La nouvelle figure gabonaise, Nguema
Le Gabon entre dans une importante phase de transition démocratique, que préside le général Nguema, lui-même.
Tout en se forgeant de nouveaux alliés, le putschiste concentre, pour l'instant, des pouvoirs majeurs. Il agit tel un chef d'Etat. Il a prêté serment quelques jours après le renversement du président Ali Bongo, à Libreville, devant nombre de personnalités.
Il s'est alors engagé à redonner au peuple "sa liberté" et "sa dignité" et promis de futures élections "libres et transparentes". Elles viennent d'être fixées au mois d'août 2025. Selon l'AFP, ce calendrier sera soumis au printemps à une conférence nationale incluant "toutes les forces vives de la Nation".
La communauté internationale attentive
Si le calendrier annoncé lundi est respecté, la "transition" durera donc deux ans.
Dans un contexte où plusieurs régimes putschistes en Afrique ont déjà prorogé ces périodes de transition devant mener à des élections, les généraux de Libreville seront observés attentivement par la communauté internationale.
Eux qui ont bénéficié, par comparaison, d'une relative indulgence des capitales africaines et occidentales à ce jour. L'avenir du Gabon reste incertain.
Emma GODET.
Le fléau persistant des gangs en Colombie
La guerre des gangs en Colombie, un fléau qui continue de déchirer les communautés et faire des ravages dans le pays.
En Colombie, derrière ses atouts comme sa beauté naturelle et sa culture se cache un problème sombre et persistant : la guerre des gangs. Ces gangs criminels opèrent dans de nombreuses régions de Colombie et sèment la terreur parmi les civils défiant la police et les autorités. Cette guerre des gangs dure depuis plus d’un siècle alimentée par la pauvreté, le trafic de drogue et la violence politique.
Selon des rapports du gouvernement colombien, il existe actuellement plus de 1 100 gangs opérant dans tout le pays, avec environ 1,5 million de membres.
Ces gangs se livrent à des activités criminelles telles que le trafic de drogue, l'extorsion, le vol a main armée et les meurtres.
On constate que les premières victimes de ces guerres de gangs sont les civils innocents qui se retrouvent au milieu des fusillades et des règlements de comptes.
Le cas de Buenaventura, "port du crime"
Situé sur la façade Pacifique le port de Buenaventura est la première plate-forme portuaire du pays sur les routes maritimes menant à l'Asie.
Dans ce port transitent 40 % des échanges internationaux du pays mais aussi l'essentiel de la cocaïne à destination des États-Unis.
C'est aussi la ville la plus dangereuse de Colombie et l'une des villes les plus dangereuses au monde avec un nombre record d'homicides violents liés au trafic de drogue et à la guerre des gangs, 576 entre 2017 et 2021 selon la fondation Pares. Les gangs criminels y pratiquent la torture et la découpe d'êtres vivants dans les quartiers qu'ils dirigent et les corps sont démembrés et jetés dans la Mangrove ou sont retrouvés dans la mer. Dans certains quartiers autour du port les tirs et les échanges de coups de feu sont quasi quotidien.
Des négociations en vue d'un accord de paix "total"
La guerre des gangs en Colombie a eu et continue d'avoir des conséquences géopolitiques importantes. Elle contribue notamment à déstabiliser la région et les pays voisins. De plus, la guerre des gangs pousse chaque année des dizaines de milliers de colombiens à fuir leur pays et la violence. Dans ce contexte, le président de gauche Gustavo Petro, élu à l’été 2022, tente depuis plusieurs mois de négocier avec les guérillas et autres groupes armés actifs dans les provinces du pays, souvent liés au narcotrafic en vue d'un accord de paix "total".
Zoé BLANGIER.
Haïti en proie à un cycle de violence
Un avenir incertain pour la nation la plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes minée par une insécurité endémique.
Haïti, la nation caribéenne la plus ancienne, est aujourd'hui plongée dans un tourbillon de violence et d'instabilité politique qui préoccupe la communauté internationale. Depuis de nombreuses années, le pays a été secoué par des crises politiques, des catastrophes naturelles, et une pauvreté considérable. Malheureusement, le conflit en Haïti s'est intensifié ces derniers temps, jetant un voile d'incertitude sur son avenir.
Les racines du conflit
Le conflit en Haïti puise ses racines dans une longue histoire de troubles politiques, de corruption, de faibles institutions gouvernementales, et de profondes divisions au sein de la société. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a marqué un tournant majeur, ouvrant une période d'instabilité politique et de lutte pour le pouvoir. Depuis lors, le pays a été dirigé par le Premier Ministre Ariel Henry, mais les gangs se disputent le contrôle du pouvoir. Ces gangs contrôlent le pays, et surtout la capitale : Port-au-Prince. Ils font la loi en Haïti, le gouvernement et la police haïtienne étant impuissants. Les manifestations populaires, la violence urbaine et les enlèvements se sont multipliés, créant un climat de peur et de désespoir parmi la population.
La nation caribéenne est le pays le plus pauvre d’Amérique latine et des Caraïbes (60 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour), avec un taux de chômage élevé et une dépendance à l'aide étrangère. 5,2 millions d’Haïtiens auraient besoin d’aide humanitaire. La crise politique actuelle entrave la croissance économique et l'aide humanitaire. Les catastrophes naturelles, telles que les récents tremblements de terre et les ouragans, ont contribué à la vulnérabilité du pays.
L'appel à l'aide internationale
La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation en Haïti et appelle à une résolution pacifique du conflit. Les Nations Unies ont déployé des forces de maintien de la paix dans le pays pour tenter de rétablir l'ordre en vain. Le conflit en Haïti plonge la nation dans une période d'incertitude sans précédent, avec déjà plus de 2 400 victimes depuis janvier 2023. La majorité des Haïtiens aspirent à la paix, à la sécurité et à des opportunités économiques mais leurs espoirs restent fragiles face aux luttes politiques et à l'instabilité.
Il sera compliqué de mettre fin à ce conflit sans aide extérieure. Un espoir est né récemment chez les Haïtiens, avec la visite le 31 octobre de l’expert des Nations Unies sur la situation des droits humains d’Haïti, William O’Neill, qui s’est dit alarmé par la violence affectant la capitale Port-au-Prince. Les efforts conjoints de la communauté internationale et des dirigeants haïtiens seront cruciaux pour sortir Haïti de ce cycle de violence et d'incertitude qui l'entrave depuis si longtemps.
Nathan ISMAILI, Marie BUNEL.
Le conflit israélo-palestinien se ravive
L'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre a brisé le statu quo israélo-palestinien.
Les tensions entre Israël et le peuple palestinien existent depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Le Hamas est l'organisation qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. Elle est considérée comme une organisation terroriste par l'Union Européenne et les États-Unis, mais est cependant soutenue financièrement par le Qatar et l'Iran. Sa branche armée, Les Brigades Izz al-Din al-Qassam, a lancé une vaste attaque terroriste en Israël le 7 octobre dernier, ciblant notamment une reave party et faisant au moins 1400 morts et 220 otages. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de l'État d'Israël.
"Écraser et détruire le Hamas"
Caractérisée immédiatement de "guerre" par le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, la riposte israélienne vise à la destruction du Hamas. "Tout membre du Hamas est un homme mort", a lancé M. Nétanyahou lors d’une première allocution solennelle. "Le Hamas, c’est Daech et nous allons l’écraser et le détruire comme le monde a détruit Daech", a-t-il ajouté après avoir qualifié l’attaque de "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah". Le 9 octobre le gouvernement israélien a annoncé un siège complet de la bande de Gaza, coupant son approvisionnement en électricité, eau, gaz et stoppant l'importation de nourriture. Ce blocus est instauré en réponse à la prise d'otages de civils israéliens par le Hamas. En même temps, 300 000 réservistes ont été mobilisés et des dizaines de milliers de soldats déployés autour de la bande de Gaza en vue d'une intervention terrestre. L'ONU a rappelé que ce siège total est interdit par le droit international et a alerté sur l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza.
Une situation "humanitaire dramatique" à Gaza
Avec une concentration de 2.4 millions de personnes sur 362km2, la population civile est très fortement touchée par les bombardements israéliens. Les hôpitaux ne sont pas épargnés et l'aide humanitaire peine à entrer dans la bande de Gaza. Ce n'est que le 21 octobre que les premiers convois humanitaires à Gaza arrivent par l'Égypte. Le bilan actuel est de plus de 10 000 morts palestiniens et environ 26 000 blessés. Plus d'un million de personnes ont été déplacées après la demande de l'armée israélienne de quitter le nord de Gaza.
La crainte d'un "embrasement régional"
Tandis que les pays occidentaux affirment leur soutien à Israël, les pays arabes expriment leur soutien aux Palestiniens. La crainte est aujourd'hui à l'embrasement et à l'extension du conflit dans la région. Les présidents américain puis français, se sont successivement rendus en Israël afin de s'entretenir avec le gouvernement Nétanyahou et réaffirmer leur soutien tout en mettant en garde contre une invasion massive et une occupation de la bande de Gaza. Le président français a aussi rencontré le président de l'Autorité palestinienne, M. Abbas, afin de plaider pour une relance du processus de paix et une solution à deux États.
Liséa LEFEBVRE.
Le Yémen lutte sans espoir pour sa survie
En 2023, le Yémen sombre dans une crise humanitaire sans précédent créée par une guerre fratricide depuis 2015.
Depuis plusieurs années, le Yémen ; qui se situe à la pointe du Sud-ouest de la péninsule arabique, fait face à l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque. En 2023, la situation s'est aggravée, plongeant des millions de Yéménites dans la désespérance.
Une guerre qui dure depuis 2015
Les chiffres sont alarmants, avec plus de 20 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire, dont 10 millions sont au bord de la famine, selon des données de l'ONU.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation désastreuse. Le conflit armé qui perdure depuis 2015 entre les forces gouvernementales et les rebelles chiites houthis ont causé d'immenses dégâts au pays, laissant derrière des infrastructures détruites,des écoles fermées, et un système de santé en ruine.
La réponse de la communauté internationale
Les conséquences se sont intensifiées par l'arrivée de pénuries alimentaires,d'épidémies de maladies,et de difficultés d'accès à l'eau potable.
La communauté internationale a tenté de répondre à cette crise en fournissant une aide humanitaire, mais les fonds nécessaires sont insuffisants pour faire face à l'ampleur des besoins.
Les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont cherché à trouver une solution politique, mais la situation reste complexe.
Face à cette crise humanitaire désespérée , il est crucial que la communauté internationale se mobilise. Les ONG et les agences humanitaires continuent de fournir de l'aide, mais elles ont besoin de soutien financier et logistique.
L'appel à l'aide et à la solidarité
Cette solidarité est cruciale pour apporter un semblant d'espoir dans une nation en proie au désespoir. L'année 2023 a malheureusement vu le Yémen s'enfoncer davantage dans la désespérance, mais l'humanité a le pouvoir de faire une différence. Il est temps que le monde se mobilise pour aider le peuple yéménite à trouver un chemin vers la paix, la stabilité, et une vie digne.
Mey-Ly CARLIER,
Lily LECANU.
Haut-Karabakh, un « nettoyage ethnique »
L'Azerbaïdjan a abandonné toute idée de paix avec l'Arménie en lançant une offensive sur le Haut-Karabakh le 19 septembre 2023.
Le 19 septembre 2023, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire éclair sur le Haut-Karabakh pour en prendre le contrôle. Depuis des décennies Bakou et Erevan se disputent cette enclave située en Azerbaïdjan, mais presque exclusivement peuplée d’Arméniens.
Vingt-quatre heures seulement après le déclenchement de l'offensive, les séparatistes arméniens ont déposé les armes et annoncé l'auto-dissolution de la République du Karabakh au 1er janvier 2024. Ce tournant historique scelle la victoire de l'Azerbaïdjan et la fin de la présence arménienne sur ce petit territoire.
Un conflit ancien et trois guerres
Le Haut-Karabakh, appelé Artsakh par les Arméniens se situe dans le Caucase du Sud. D'une superficie de 4 400 kilomètres carrés, il est peuplé de 120 000 habitants à 99 % d’origine et de langue arménienne et de confession chrétienne. Les Azéris sont, eux, majoritairement musulmans et turcophones. Le territoire a été rattaché à l’Azerbaïdjan par Staline, malgré sa population arménienne. Il a obtenu toutefois l’autonomie en 1923, statut qui restera inchangé pendant soixante-cinq ans. En 1988, le Haut-Karabakh vote son rattachement à l’Arménie. Un premier conflit armé de grande ampleur éclate. Il fera 30 000 morts. Cette première guerre s'achève en 1991 par un cessez-le -eu et la victoire des Arméniens de la république autoproclamée du Karabakh, entité non reconnue par la communauté internationale, pas même par l'Arménie.
Un avenir incertain pour l'Arménie
Animé par un fort désir de revanche l'Azerbaïdjan déclenche une deuxième guerre en septembre 2020. Elle s'achève à peine deux mois plus tard par la victoire de Bakou soutenu par la Turquie et la signature d'un accord de cessez-le-feu, le 10 novembre 2020. Cet accord prévoit le déploiement de troupes russes pour maintenir la paix. Depuis, les tensions n'ont jamais cessé jusqu' à l'offensive éclair et victorieuse de l'Azerbaïdjan du 19 septembre 2023.
Depuis la victoire de Bakou plus de 100 000 personnes ont fui le Karabakh et les autorités arméniennes n'hésitent pas à parler de "nettoyage ethnique" de ce territoire. L'Arménie se retrouve dans une position délicate. Elle craint que son voisin plus riche, mieux équipé et qui a le soutien de la Turquie, ne convoite davantage de son territoire. C'est pourquoi, elle cherche à se protéger en se rapprochant de l'Occident et de la France. Paris a annoncé, lundi 23 octobre, la vente à Erevan d'équipements pour sa défense. Ce même jour, l'Iran et la Russie ont dénoncé cet interventionnisme occidental lors d'une réunion à Téhéran.
Camille FLAHAUT.
L'enlisement de la guerre en Ukraine
Ce conflit qui dure depuis le 24 février 2022 ne semble toujours pas trouver de dénouement.
Alors que l’Ukraine espérait une contre-offensive décisive, Kiev n’a repris ces derniers mois que quelques kilomètres carrés de son territoire, faute de moyens, à l’heure où la guerre entre le Hamas et Israël attire davantage l’attention des médias et de la communauté internationale.
La situation actuelle
A ce jour, la Russie contrôle la partie Est de l'Ukraine (près de 20 % du territoire). L'Ukraine résiste en gardant le contrôle de l'Ouest du pays et en s'efforçant de regagner du terrain vers le Sud en direction de la Crimée. Malgré tout, une fatigue se fait ressentir chez les Ukrainiens après presque deux ans de guerre et une ligne de front qui n'a pratiquement pas bougé depuis plus d'un an. Cette fatigue est amplifiée par la baisse du soutien de leurs alliés, dont les opinions publiques se lassent de ce conflit qui s'enlise. Le Président ukrainien Zelensky a récemment annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle (initialement prévue en 2024) au vu de la situation de guerre et des millions de déplacés hors du pays.
Côté russe, Vladimir Poutine a signé le 2 novembre une loi permettant la sortie du traité d'interdiction d'essais nucléaires. Il avait déjà suspendu la participation de la Russie au traité de désarmement nucléaire, en février. Fin octobre, la Russie a procédé à des essais de missiles balistiques, afin de se préparer à une "frappe nucléaire massive de riposte".
Le soutien de l'Union Européenne à l'Ukraine
Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne s'est rendue en Ukraine le 4 novembre. Elle a réaffirmé le soutien "inébranlable" de l'Union Européenne à son égard. Elle a dit espérer réussir à débloquer 50 milliards d'euros d'aide supplémentaire avant la fin de l'année. Elle a également annoncé la prise de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Le 8 novembre la Commission européenne a rendu un rapport favorable sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Un sommet se tiendra entre les 27 pays membres les 14 et 15 décembre afin de se prononcer sur le début des négociations en vue de son adhésion.
Aucune perspective de résolution du conflit
Le 28 octobre, s'est tenu à Malte un sommet à huis clos entre 66 pays afin de mettre un terme à l'invasion russe en Ukraine, la Russie n'y a pas été conviée. Ces discussions ne semblent pas avoir abouti à une résolution du conflit.
La guerre russo-ukrainienne est actuellement dans une impasse, de plus elle glisse au second plan dans les médias depuis le retour de la guerre au Proche-Orient.
Liséa LEFEBVRE.
Les femmes et les conflits armés
Premières victimes des guerres, soldates au front, et aussi combattantes pour la paix.
Les femmes sont en première ligne, les premières victimes des conflits. Même si les conflits armés frappent les communautés dans leur ensemble, ils affectent plus particulièrement les femmes et les filles du fait de leur statut social et de leur sexe.
Le viol comme tactique de guerre :"un crime invisible".
La violence contre les femmes est utilisée comme arme de guerre pour les déshumaniser et les terroriser.
Le meurtre, l'esclavage sexuel, la grossesse et la stérilisation forcées constituent d'autres formes de violence dans le contexte de conflits armés. Comme en Colombie, au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan du Sud et en Syrie
Des femmes réfugiées, déplacées.
Lorsqu'elles fuient les conflits, les femmes se déplacent et s'installent dans des camps de réfugiés. Elles s'exposent à des mariages précoces ou n'ont d'autres choix que de satisfaire des faveurs sexuelles contre de l'argent pour satisfaire leurs besoins essentiels...
En dépit de ces actes, les femmes ne doivent pas simplement être perçues comme des victimes de guerre.
Des femmes combattantes.
Aujourd'hui, nombreuses sont celles qui participent activement aux conflits armés en tant que combattantes aussi bien dans les armées régulières que dans les mouvements contestataires issus des luttes de libération nationale.
Des femmes impliquées dans les mouvements de défense de la paix.
Si certaines femmes prennent les armes, d’autres peuvent être à l’avant-garde des activités pour la paix. Elles sont des actrices importantes en matière de règlements des conflits et en faveur de la paix.
Pourtant, leur voix n’est souvent pas entendue ni prise à sa juste valeur dans les efforts de paix.
Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 1325 sur « les femmes, la paix et la sécurité ».
Malgré une résolution de l'ONU votée par le Conseil de sécurité en 2000 censée protéger les femmes des conflits armés et les inclure dans les processus de paix, elles restent les premières victimes des guerres et sont sous-représentées dans les négociations diplomatiques.
Les femmes ne sont donc pas, en tant que telles, plus vulnérables que les hommes dans des situations de conflit armé. Néanmoins, elles sont particulièrement susceptibles de connaître l’exclusion, la pauvreté et les souffrances , tout spécialement lorsqu’elles font déjà l’objet de discrimination en temps de paix.
Laurence CARREZ-MARTIN.
Narges Mohammadi, Nobel de la paix 2023
L’Iranienne est actuellement en détention à Téhéran. Elle a été condamnée en 2016 à seize ans de prison pour son activisme, peine allongée en août. Portrait.
Figure éminente de la lutte pour les Droits de l'Homme, Narges Mohammadi, a été annoncée le 6 octobre 2023 comme la récipiendaire du prix Nobel de la Paix. Née en 1972 en Iran, elle a consacré sa vie à défendre les droits fondamentaux, à promouvoir la justice sociale et à lutter contre l'oppression.
Elle est connue pour son travail au sein de diverses organisations non gouvernementales où elle a défendu les droits de la femme, des prisonniers politiques et des minorités opprimées.
Son impact sur la société iranienne Son travail a eu un impact significatif sur la société iranienne. Elle a été une voix forte pour la liberté d'expression, dénonçant les violations des Droits de l'Homme et plaidant pour le respect des droits civils et politiques.
Elle a également mis en lumière les violences auxquelles sont confrontées les femmes quotidiennement. Son courage et sa détermination ont inspiré de nombreux militants et ont donné de l'espoir à ceux qui se battent pour la justice en Iran.
L''avenir des Droits de l'Homme en Iran
La reconnaissance de Narges Mohammadi par le prix Nobel de la Paix est un puissant rappel de l'importance de la lutte pour les Droits de l'Homme en Iran et dans le monde entier. Alors que le pays traverse des périodes de tensions politiques et de répressions, son travail incarne la résistance et l'espoir pour un avenir meilleur.
Ce prix Nobel envoie un message fort à la communauté internationale, soulignant l'urgence de soutenir les défenseurs des Droits de l'Homme et de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils respectent les droits fondamentaux de leurs citoyens.
En récompensant Narges Mohammadi, le comité Nobel honore non seulement son courage personnel, mais aussi tous ceux qui sacrifient leur liberté.
Clémence MAINEMARE,
Killian DION.
Encore un prof assassiné !
Le vendredi 13 octobre 2023, quelques jours avant les 3 ans du meurtre de Samuel Paty, l'école est encore touchée.
Il s'appelait Dominique Bernard. Il avait 57 ans et était professeur de lettres modernes à la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras.
Assassiné parce qu'il voulait protéger ses élèves
Le 13 octobre, son assassin âgé de 20 ans s'est introduit dans la cité scolaire d'Arras. Dominique Bernard s'est interposé avec 3 autres personnes avant d'être poignardé à mort à plusieurs reprises. Parmi les 3 autres personnes, 2 ont été grièvement blessées mais s'en sont sorties.
Dominique Bernard était aimé par tous, par ses élèves, par ses collègues... Sa famille et ses amis le décrivaient comme quelqu'un de discret et sensible. Il va manquer à ses élèves. Sa mère et sa sœur se sont exprimées pour rappeler qu'il était parti trop tôt.
Assassiné par un ancien élève
L'individu armé de deux couteaux qui s'est introduit dans le collège-lycée d'Arras et a semé la panique, s'appelle Mohammed Mogouchkov.
Cet ancien élève était fiché S depuis février 2021, tout comme son père. Cet individu est un tchétchène radicalisé qui se revendique membre de l'organisation Etat Islamique (Daech).
Un homme simple honoré
Dominique Bernard était un homme qui n'aimait pas les distinctions pourtant il a été fait chevalier de la légion d'honneur. Il a eu droit à une cérémonie religieuse à la cathédrale d'Arras, avec près d'un millier de personnes présentes. Le président de la République et son épouse et le ministre de l’Éducation, Gabriel Attal étaient présents.
Un portrait a été affiché sur la façade de l'hôtel de ville en son honneur.
Le lundi 16 octobre, tous les collèges et lycées de France ont rendu hommage à ce héros en respectant 1 minute de silence.
Mathilde NYS.
Être prof d'histoire-géo en octobre 2023
« Le plus beau métier du monde ? »
Face aux évènements qui se répètent...les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, les assassinats de Samuel Paty, d'Agnès Lasalle et maintenant de Dominique Bernard, je suis stupéfaite, consternée, abasourdie...encore une fois un professeur !
C'est la colère qui crée la détermination
Je suis professeure, avec cette triple casquette (histoire, géographie et EMC) depuis plus de 30 ans, et depuis peu j'enseigne la spécialité Géopolitique et Science Politique. J'exerce un métier que j'ai choisi.
Et le métier reprend le dessus !
J'ai envie de continuer à former des élèves curieux, qui doivent penser par eux-mêmes, j'ai envie de leur donner les clés de la compréhension des enjeux contemporains.j'ai envie de former des citoyens éclairés et de transmettre les valeurs de la République.
Nous sommes des passeurs de mémoire et de savoirs
Ne pas céder, pas de censure sur des sujets qui méritent d'être soumis aux débats !
L'école est une arme !
Elle combat l'ignorance et l'obscurantisme !
J'ai encadré une photographie de Samuel Paty dans ma salle de classe car je ne veux pas oublier qu'il est mort parce qu'il était professeur.
Je vais rajouter celle de Dominique Bernard. Un collègue m'a dit "ta salle va devenir un monument aux morts"
Combien de photos je vais afficher avant mon départ en retraite ?
Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des résistants !
Laurence CARREZ-MARTIN.

Une lutte sans relâche contre le terrorisme
La France en état d'urgence attentats depuis l'attaque au couteau à Arras. Les moyens d'enrayer la menace terroriste sont multiples.
Le combat contre la propagation de l’État islamique ne date pas d'hier. Ce terrorisme s'incarne sous deux principales organisations : Al Qaïda et Daesh. Fondée en 1988, Al-Qaïda est une organisation connue pour avoir été l'autrice des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
De même qu'Al-Qaïda, Daesh est à l'origine de nombreuses attaques à travers le monde. Ces deux organisations partagent une même idéologie, le salafisme, une vision radicale de l'Islam.
Une coopération internationale
L'un des moyens de lutte contre les associations terroristes est l'entraide entre différents pays. Dans cet objectif, l'UNCCT (UN Counter Terrorism Center) a été créé en 2011 pour promouvoir la coopération internationale contre la menace terroriste et aider les États membres à la mise en œuvre d'une stratégie antiterroriste mondiale.
Services de renseignement français
La DGSI, c'est-à-dire la Direction générale de la Sécurité intérieure est un service de renseignement. Cet organisme a plusieurs objectifs, parmi lesquels la lutte contre l'atteinte à la République Française lors d'actes terroristes. Elle a aussi un rôle important dans la surveillance des activités des organisations criminelles internationales qui représentent un danger pour la sécurité du pays. La DGSE, la Direction générale de la Sécurité extérieure est, elle aussi, un service de renseignement. Son rôle est similaire à celui de la DGSI. La coopération avec des services de renseignement étrangers est de vigueur. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis 2017 une quarantaine d'attaques ont été déjouées sur le territoire Français.
Après 2015
En réaction aux attaques de 2015, la France a amélioré ses moyens de lutte contre le terrorisme, afin qu'ils soient plus efficaces et qu'ils correspondent également à l'évolution des formes d'actes terroristes.
Le gouvernement agit contre le financement du terrorisme, lutte contre la radicalisation des jeunes en limitant la propagande de l’État Islamiste en ligne et effectue des contrôles aux frontières.
Léna COURBOULAY.
Trois citations de Clausewitz sur la guerre
La guerre en Ukraine a été l'occasion pour les journalistes et les experts de citer régulièrement le théoricien de la guerre. Décryptage de trois citations.
Carl von Clausewitz, né en 1780 à Burg, près de Magdebourg, et mort en 1831 à Breslau, est un officier général et théoricien militaire prussien. Il est l'auteur de "De la guerre", publié par sa femme en 1832 sous sa forme inachevée. Cet ouvrage est une réflexion théorique sur la guerre, nourrie par l'observation des guerres de son temps (Clausewitz était présent lors de la bataille de Valmy et il a participé aux guerres napoléoniennes dans les rangs de l'armée russe), et dans lequel les journalistes puisent régulièrement plusieurs citations sur la guerre.
"La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens"
Dans son ouvrage Clausewitz insiste sur la dimension politique de la guerre qu'il voit comme "la continuation de la politique (des États) par d'autres moyens". Selon lui, la guerre répond toujours à des finalités politiques qui sont le moteur des affrontements. Pour y parvenir Clausewitz définit le concept de la « remarquable trinité », où la guerre se compose de trois niveaux : le but (le gouvernement fixe la finalité politique) ; le moyen (le militaire mène l’action pour imposer le but) et la passion (le peuple, essence de la violence pour atteindre le but). Ce "modèle" de la guerre reste toujours pertinent pour analyser les guerres interétatiques et mieux comprendre les agissements de la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine ou de l'Azerbaïdjan au Karabakh. Dans les deux cas, la guerre procède d'un choix politique pour atteindre un but politique, éviter que l'Ukraine n'adhère à l'OTAN pour Poutine et intégrer le Karabakh dans le giron de l'Azerbaïdjan pour le président Azéri Ilham Aliyev.
"Le brouillard de la guerre"
Autre formule de Clausewitz passée à la postérité et régulièrement citée "le brouillard de la guerre". Cette expression désigne le degré d'incertitude dans lequel se déroule la guerre une fois celle-ci enclenchée, « La grande incertitude [liée au manque] d'informations en période de guerre est d'une difficulté particulière parce que toutes les actions doivent dans une certaine mesure être planifiées avec une légère zone d'ombre qui (…) comme l'effet d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles" écrit Clausewitz dans "De la guerre". Presque deux siècles après, force est de constater que ce constat s'applique encore à la plupart des conflits armés actuels.
"La guerre est un caméléon"
Dans "De la guerre" Clausewitz compare la guerre à un Caméléon. Selon lui, la nature même de la guerre est de revêtir des formes changeantes, en raison de sa soumission à la politique, qui voit son apparence se modifier en fonction de son environnement. Sur ce point aussi la réflexion de Clausewitz est toujours pertinente.
Jean-Luc VILLEMIN.
Bertrand Badie,« Il faut socialiser à la paix »
Lors de la 6e édition du Forum Mondial Normandie pour la Paix, à Caen, l'universitaire spécialiste des relations internationales nous a accordé un entretien exclusif.
Quel est l’intérêt d’une manifestation comme le Forum mondial Normandie pour la Paix ? En quoi peut-elle aider à la construction de la Paix ?
Il y a peu d'études sur la paix, peu de manifestations. Pourquoi ? On définit la paix comme la "non-guerre", comme on définirait un être humain comme un "non-animal". On s'était mis en tête que la paix était l'état normal. Ce Forum est une façon de positiver la paix, de vaincre l'entre-soi belligène des États. Notre objectif est donc de socialiser à la paix, d'en faire l'affaire de tous !
Cette manifestation peut contribuer à la paix si, par elle, nous pouvons habituer les États à cette lecture positive de la paix, en faisant que chacun des participants soit comme une goutte d'eau qui s'assemble aux autres pour former un torrent de réel pacifisme.
Plus profondément, il s'agit de comprendre à quel point les sociétés sont reliées les unes aux autres comme nous le voyons avec la question migratoire. C'est faire l'effort de comprendre l'autre, et, comme dans le sketch de Fernand Raynaud, de saisir la contribution indispensable du boulanger...
Pourquoi ce choix du thème « Résistances ! La paix des peuples » ?
Comme pour les autres éditions, nous renonçons à des sujets classiques. La 5e édition était consacrée à l'effet pervers des murs. Cette fois, nous avons voulu réfléchir sur les peuples, qui subissent toujours la guerre. Parler de la "La Paix des peuples", c'est considérer que la paix et la guerre, c'est l'affaire de tous.
Exemple, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Russie est mise en échec. Pourquoi ? Par le fait de la société civile ukrainienne. Ainsi, l'usage du portable par chaque Ukrainien modifie et enrichit les informations dont a besoin l'armée nationale. Comme toute initiative individuelle de sabotage de l'armée des envahisseurs, elle fait partie de cette énergie sociale qui bouscule les rapports classiques de puissance qui jouaient en faveur de Moscou. Quantité d'autres exemples illustrent cela. Ca peut sembler des actes dérisoires. Pourtant, leur portée est considérable.
Au Mali, ou au Yémen, les populations sont dans une grande souffrance. Au Yémen, le taux de mortalité maternelle est le plus élevé au monde. Il y a une actualité sociale profondément déterminante et structurante des guerres qui s'y déploient. L'analyste comme le politique ne peuvent pas l'ignorer. Ils pèsent sur l'avenir du conflit dans un contexte de guerre mondialisée que nous connaissons. Une telle réflexion est plus engageante que les batailles militaires.
Pour penser cela, l'Abbé de Saint-Pierre (1658-1743) est une figure incontournable. On lui doit Le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713). Autre exemple : pendant la Révolution française, le décret de la levée en masse du 23 août 1793 provoque la mobilisation humaine et matérielle de toute la France. Ecoutez "Le Chant du Départ" de Marie-Joseph Chénier composé en 1794 "Tremblez, ennemis de la France,/ Rois ivres de sang et d’orgueil ! / Le peuple souverain s’avance...
Autre exemple, la guerre de Crimée (1852-1856) qui oppose l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de l'Empire français, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne. La société française est pour la première fois informée grâce à la Presse, en plein essor public, qui raconte les batailles avec des reporters envoyés sur place. Il se crée une opinion publique qui va agir sur le cours de la guerre...
Aujourd'hui, au Sahel, l'Armée française se révèle impuissante et l'opinion africaine de plus en plus active. Les politiques doivent comprendre qu'il est temps de faire entrer les peuples, directement ou non, dans les négociations. Les politiques ne veulent pas admettre qu'ils perdent le monopole des Affaires étrangères !
Comment faire ? L'Abbé de Saint Pierre répond à cette question, selon trois points, trois exigences.
1) Il s'agit de faire entrer des paramètres sociaux dans la réflexion pour mettre fin aux conflits. Par exemple, pour la guerre au Sahel, se demander ce que ressent l'éleveur sahélien de cette situation ? 2) Comprendre l'Autre. 3) Associer effectivement les acteurs locaux à la définition des solutions. Autrefois, les Princes se réunissaient autour de la même table, pour les mêmes festins. Or, la paix n'est plus l'affaire du Club fermé des Princes. Il s'agit d'intégrer les acteurs locaux. Qui peut tirer parti de la paix sinon les acteurs locaux ? Sans cela, le risque est inévitable d'une radicalisation des conflits.
L’actualité est encore marquée par la guerre en Ukraine, aussi par la reprise de la guerre au Karabakh. Quel regard y portez-vous ? Diriez-vous qu’ils illustrent un retour de la guerre conventionnelle ?
D'abord, il n'y a pas de retour en histoire, parce que le contexte change. La Guerre froide s'expliquait par une idéologie de blocs opposés. Ce schéma ne vaut plus du tout pour les États-Unis et la Chine, au regard des 700 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre ces deux puissances. Ce n'est donc pas au retour de la « Guerre froide » entre la Chine et les États-Unis.
Ensuite, depuis 1945, il n'y a plus de guerre de conquête. Toute tentative de conquête est mise en échec Le 24 février 2022,. la Russie déclenche son « opération spéciale » contre l'Ukraine. Les États-Unis proposent au Président Zelensky d'être ex-filtré. Il refuse, pour la raison que son pays a fait l'objet d'une appropriation sociale par le peuple ukrainien. Fini le temps où les territoires étaient de simples monnaies d'échange réductibles à des marchandages ou des rapports de forces. Vrai aussi pour la Cisjordanie, le Sahara-Occidental...
Pour Haut-Karabakh, il faut comprendre qu'en 1991, l'URSS se décompose de manière anarchique. Alors que la République d'Arménie proclame son indépendance, le Haut Karabakh, enclave insérée dans l'Azerbaidjan s'autoproclame indépendante sans la reconnaissance formelle d'Erevan. Les enclaves surtout non reconnues sont toujours source de tensions. D'où celles qui opposent durablement les deux républiques. Aujourd'hui, l'Azarbaidjan dispose de nombreuses complicités dans le monde . Elle en a profité pour régler le problème en sa faveur ! L'Union Européenne n'a-t-elle pas négocié la fourniture de pétrole en compensation de la rupture d'approvisionnement auprès du marché russe ?
Une anomalie géographique devient un appât pour déclencher un conflit. Le problème de fond, c'est que les ethnies ne sont pas territorialisables. Si on veut les territorialiser, le prix tragique à payer est celui d'une purification ethnique ou même d'un génocide ...
Recueilli le 29/09/2023 par
Gabriel LEVASSEUR.