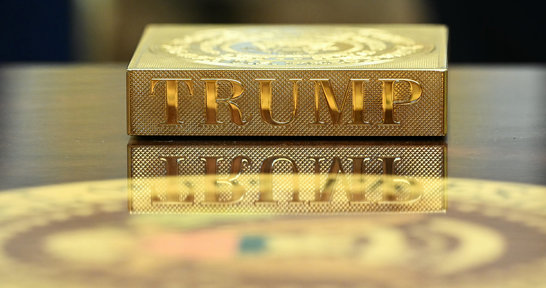Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

| N° 5 - Avril 2025 | brassens.lycee.ac-normandie.fr |
Le nouveau visage de l'Amérique
Pages 2 à 9 et page 16.
Édito : « l'empereur » et le « bouffon »
« Washington est devenu la cour de Néron », « Un empereur incendiaire, des courtisans soumis, un bouffon sous kétamine chargé de l’épuration de la fonction publique »…, « Jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi.
Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs, pris le contrôle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une dérive illibérale, c'est un début de confiscation de la démocratie ».
Ce sont les propos forts prononcés par le sénateur de l'Allier Claude Malhuret lors d'un débat au Sénat le 6 mars dernier consacré à l'Ukraine. Un discours devenu viral, vu par plus d'un million de personnes sur YouTube, et qui a fait le tour du monde.
Dans ce nouveau numéro de "Georges Décrypte" réalisé par les élèves de 1ère, nous avons voulu nous aussi mettre l'accent sur les premières semaines de la nouvelle présidence Trump et sur ses conséquences politiques et géopolitiques.
Entre volonté d'annexion du Groenland, du Canada ou du canal de Panama ; mise en scène de l'expulsion des immigrés en situation irrégulière ; attaques contre l'État de droit et les sciences du climat ; mots bannis ; coupes à la « tronçonneuse » d'Elon Musk dans les budgets des agences fédérales ; « leçon » adressée par JD Vance aux Européens ; soutien à l'AfD en Allemagne ; suspension de l'aide à l'Ukraine ; projet de transformation de la Bande de Gaza en une nouvelle « Riviera » avec au passage le déplacement « forcé » des Gazaouis ; guerre commerciale ; c'est bien « un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis ».
Outre Atlantique, ni les Républicains ni les Démocrates n'ont réagi au discours de Claude Malhuret.
Bonne lecture malgré tout...
Jean-Luc VILLEMIN.
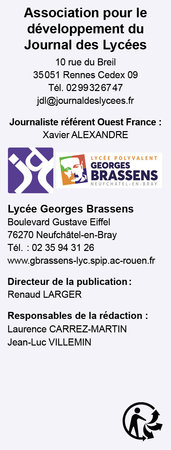
USA : premières expulsions de migrants
Lors de son investiture, Donald Trump a signé un décret expulsant les immigrés illégaux des États-Unis.
Le 29 janvier, lors de son investiture, Donald Trump a signé un décret afin de renvoyer un maximum d’immigrés en situation illégale. Le président américain avait promis, lors de sa campagne, de mettre fin à l'immigration clandestine.
Laken Riley
Le décret porte le nom de Laken Riley, une étudiante de 22 ans tuée par un Vénézuélien en situation irrégulière. "Son nom ... vivra à jamais dans les lois de notre pays", a commenté Trump.
« 30 000 migrants à Guantanamo »
De plus, Donald Trump a annoncé préparer l'envoi de migrants sans papiers sur la base de Guantanamo ; "Je vais signer aujourd'hui un décret demandant aux ministères de la Défense et de la Sécurité intérieure de préparer un centre pour 30 000 migrants à Guantanamo Bay", a-t-il déclaré, en ajoutant qu'il s'agirait de "criminels" en situation irrégulière.
La base militaire de Guantanamo accueille la prison du même nom, symbole des dérives de la lutte contre le terrorisme, à cause de ses conditions de détention extrêmes et de son recours à la torture.
La Colombie cède aux menaces
Le président américain a également suspendu sa menace d'imposer une série de sanctions contre la Colombie, la Maison Blanche assurant que Bogota avait accepté ses conditions pour le rapatriement d'immigrés colombiens expulsés par les États-Unis. Selon un porte-parole de la Maison Blanche, "Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis”.
Louise DUSSART.
Décrets en avalanche : Trump en action !
Le 47e président des Etats-Unis signe 46 décrets en une journée. Un événement très mis en scène, voir peut être trop.
Donald Trump marque les esprits en signant 46 décrets ("executive orders") en une journée : sur l'intelligence artificielle, sur l'immigration, le droit du sol, la remise en cause des droits des personnes transgenres...
S'ajoutent des décrets sur l'écologie, le retour aux pailles en plastique ou même la suppression des éoliennes qui "bousillent le paysage", en passant par les décrets sur les taxes douanières imposées aux membres de l'Union Européenne et à la Chine.
Une mise en scène
"à la Donald Trump"
Le tout de façon médiatisée, un moyen de dire qu'il fait son come back au bureau Ovale de la Maison Blanche. Décrivant cela comme "[une] sensation formidable". La signature des décrets a été mise en scène dans une arène sportive, devant des milliers de personnes.
Chaque geste est millimétré pour affirmer le pouvoir du nouveau Président des États-Unis. Pour chaque décret signé, il a changé de stylo ! Chaque décret étant célébré comme un trophée. Il considère cela comme une victoire qui mériterait un Award pour avoir signé le plus de décrets dans l'histoire de l'Amérique du Nord et d'être inscrit dans le livre des records.
"Il n'y a que deux genres : homme et femme"
Comme il l'avait annoncé dans son programme, Donald Trump a tenu sa promesse. "[Maintenant] il n'y a que deux genres [en Amérique] : homme et femme", a asséné le nouveau président, lors de son discours d'investiture.
Ce décret signe également un recul majeur des libertés, instaurant la menace qui pèse désormais sur la communauté LGBTQIA+ en Amérique du Nord. Ce que l'on peut qualifier de bond dans le passé.
Thomas FRERET,
Tom BRUHIERE.
Musk, Trump : un duo explosif
À l'approche du quatrième mois du mandat de Trump, Elon Musk se positionne plus que jamais comme « first buddy » et comme conseiller spécial.
Elon Musk , l'un des principaux financeurs de la campagne de Trump, a une influence inédite sur la politique américaine. Les médias américains lui ont trouvé un surnom le qualifiant de « First buddy », "le meilleur ami" du 47e président des États-Unis, pour souligner son omniprésence.
Ses activités,Tesla et Space X, et sa mainmise sur X, lui procurent aussi une grande influence. En effet, Elon Musk ne cesse de publier du contenu numérique par le biais de tweets,"Une stratégie intelligente et réfléchie" d’après Francetvinfo.
Elon Musk n'est pas le seul
Pour le chercheur et spécialiste des États-unis, Gabriel Solans « Elon Musk n’est pas le seul, on a plusieurs grands entrepreneurs de la tech qui ont un monopole sur des technologies clés. C’est par exemple le cas de Peter Thiel et de son logiciel Palantir utilisé par la CIA. Il est devenu impossible, pour le Parti Républicain, de couper tous les ponts avec eux. Que ce soit aussi bien pour les donations que pour le “succès” des États-Unis [à l’international] et la popularité du Parti Républicain, ces entrepreneurs sont clés ». Donald Trump peut remercier Elon Musk quand il veut, mais pas sûr qu’il en ait le souhait.
Une relation complexe
Beaucoup spéculent sur le duo et sur sa durée de vie. Elon Musk dispose d'un accès privilégié aux données et aux leviers de l'État fédéral, suscitant une rafale de recours en justice et de critiques. Les relations entre Donald Trump et Elon Musk semblent marquées par une complicité mais aussi certaines tensions, entre collaboration et rivalité. Leurs personnalités fortes et leurs visions parfois différentes sur certains sujets, notamment politiques ou médiatiques, alimentent régulièrement des frictions. Bien que des moments de rapprochement aient été observés, leurs échanges publics révèlent souvent une dynamique complexe. Une relation qui, malgré les apparences, reste fragile.
Stane MOREL.
Quand J.D. Vance s'en prend à l'Europe
À Munich, le vice-président américain a ouvertement critiqué le modèle européen.
Le 14 février dernier, lors de la conférence annuelle sur la sécurité internationale à Munich, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, s'est exprimé devant de nombreux chefs d'États ou de gouvernements. Ce discours a surpris par son ton offensif, mais aussi et surtout par son contenu. En effet, si les premiers jours de la nouvelle présidence Trump ont été marqués par une série de mesures réactionnaires, la volonté affichée de "résoudre" le conflit russo-ukrainien, illustrée par un échange avec Vladimir Poutine, laissait supposer que ce discours serait une occasion d'exposer la vision américaine du conflit.
Une leçon aux Européens
J.D. Vance n'a pourtant quasiment pas évoqué cette guerre mais a profité de cette occasion pour faire la leçon aux Européens. Qualifiant Donald Trump de "nouveau shériff", il a critiqué ce qui, à ses yeux, constitue un recul de la liberté d'expression en Europe. Évoquant l'annulation des dernières élections roumaines ou la mise en place de "zones de sécurité" autour des cliniques pratiquant l'avortement au Royaume-Uni afin de protéger les femmes, il a présenté les États-Unis comme les défenseurs de la liberté d'expression. Une déclaration plus que discutable alors que les cas de censure se multiplient dans les médias américains.
L'obsession migratoire
L'ancien sénateur de l'Ohio a non seulement critiqué le modèle démocratique européen, illustrant la montée de l'illibéralisme aux États-Unis, mais a aussi cherché à s'immiscer dans les affaires nationales. "Je pense qu’il n’y a pas de défi plus urgent que celui de l’immigration de masse", a-t-il déclaré, confirmant une obsession de longue date des trumpistes pour l'immigration. Neuf jours avant les élections législatives anticipées en Allemagne, et alors que l'immigration a été un thème central d'une campagne marquée par le soutien d'Elon Musk à l'AfD, J.D. Vance a critiqué le "cordon sanitaire" traditionnellement instauré afin de barrer la route à l'extrême droite. L'ingérence américaine, un nouveau sujet d'inquiétude pour les Européens ?
Thibaud de FORTESCU.
Trump renomme le Golfe du Mexique
Le jour de son investiture, le 20 janvier, Trump a annoncé le changement de nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique. Une appropriation purement politique.
Le lundi 20 janvier 2025, le Président des États-Unis Donald Trump a annoncé le changement de nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique. Celui-ci a été officialisé le 24 Janvier 2025. Il faut rappeler que le terme de Golfe du Mexique était employé depuis le XVIe siècle.
Avec cette nouvelle appellation, Trump a notifié qu'il veut rendre son Amérique plus "Great again".
Des réactions mitigées
D'après le New York Times et d'autres médias américains, de nombreuses personnes sont sceptiques sur cette modification. Dès sa candidature, Donald Trump avait promis de rétablir certains noms historiques. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, pour plaisanter, a suggéré que l'Amérique du Nord et que les États-Unis soient renommés "L'Amérique mexicaine".
Modification sur Google Maps
Google Maps a dû mettre à jour la carte des États-Unis. L'application a renommé le "Golfe du Mexique" en "Golfe d'Amérique". Le changement de nom est visible aux USA depuis cette mise à jour par le Geographic Names Information System (GNIS). Les Américains voient donc s'afficher "Gulf of America" alors que les Mexicains peuvent voir "Golfo de México". Cependant, en dehors de ces deux pays, les utilisateurs du reste du monde bénéficient des deux noms inscrits.
Les raisons du changement
Les décisions du Président des États-Unis sont soutenues par des politiques expansionnistes. Il souhaite provoquer et s'affirmer.
Cette modification prend place pour différentes raisons : préserver le patrimoine étasunien, veiller à ce que les générations futures d'Américains fêtent l'héritage de ses atouts historiques et de ses héros mais également pour l'histoire et l'économie de l'Amérique. Cette nouvelle formulation est avant tout une stratégie politique pour réaffirmer la puissance américaine et mettre en avant la grandeur des États-Unis.
Lola LEBLIC.
Donald Trump veut annexer le Canada
Le président américain a réaffirmé depuis sa résidence de Mar-a-lago son intention de faire du Canada le 51e État des États-Unis.
Le 6 janvier 2025, Donald Trump a choqué l'opinion publique en suggérant que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Lors d'une conférence à Mar-a-Lago (situé à Palm Beach), le nouveau président a affirmé que les deux pays partagent une histoire commune, des valeurs similaires et une frontière partagée. Selon lui, l'intégration du Canada serait une opportunité pour les deux nations. "Le Canada a tout à gagner à rejoindre notre grande nation", a-t-il déclaré devant ses partisans.Une idée massivement rejetée
Cette proposition intervient alors que le Canada traverse une période d’instabilité politique, suite à la démission de Justin Trudeau en décembre 2024. Le Canada, avec ses vastes ressources naturelles et sa position géographique stratégique, représenterait un atout précieux pour les États-Unis. Cependant, la réaction de la population canadienne et du personnel politique a été majoritairement négative. Les responsables politiques et les citoyens ont fermement rejeté l’idée. Ils soulignent que le Canada est une nation souveraine avec sa propre identité. “Nous n’avons pas besoin de devenir un État américain” a réagi un député, reprenant les propos d’une majorité d’opposants.
Enjeux internationaux
En revanche, certains économistes ont suggéré que l'intégration pourrait offrir des avantages économiques, comme un accès plus direct au marché américain. Cependant, cette idée reste marginale et n'a pas trouvé d'écho auprès des dirigeants politiques canadiens. La proposition de Trump semble irréaliste. Elle révèle sa capacité à susciter des débats mondiaux tout en soulevant des questions sur l'avenir des relations entre les deux pays et sur l'évolution des alliances internationales dans un monde de plus en plus globalisé.
Mattéo CRÉPIN.
Quel avenir pour le canal de Panama ?
« Le Canal appartient et continuera d'appartenir au Panama » cingle le président du Panama, José Raul Mulino, face aux prétentions de Donald Trump.
Le Canal de Panama est crucial pour le commerce mondial, évitant aux navires un détour par l’Amérique du Sud. Mais il traverse une période compliquée en étant exposé à différentes menaces...
La menace du changement climatique
Depuis longtemps, ce canal repose sur une ressource essentielle : l’eau douce. Or, avec le changement climatique, les sécheresses se multiplient. En 2023, le niveau d’eau des lacs a tellement baissé que les autorités ont dû limiter le passage des bateaux, provoquant des embouteillages maritimes et une flambée des coûts de transport.
La menace Trump
Depuis son retour en 2024, Donald Trump a ravivé le débat sur la souveraineté du Canal de Panama en remettant en cause l’accord de 1999 qui a restitué l'ouvrage au Panama et critique des tarifs jugés excessifs pour les navires américains. Il accuse la Chine d’accroître son influence et suggère que le Panama pourrait favoriser Pékin au détriment de Washington. Le président panaméen José Raúl Mulino a répliqué fermement : « Le canal appartient au Panama, il n'y a pas de débat. » Pourtant, les tensions risquent de s’intensifier. Trump, fidèle à son approche des relations internationales fondée sur le rapport de force, pourrait exercer des pressions économiques pour défendre les intérêts américains et exiger la cession du canal.
Quel avenir pour le canal ?
Entre la menace de sécheresse et les tensions internationales, l’avenir du canal est incertain. Trump ira-t-il plus loin ou cherche-t-il juste à marquer les esprits ? Une chose est sûre, le Panama devra faire preuve de stratégie et jongler entre ses droits, son histoire avec les États-Unis et la montée en puissance de la Chine en Amérique latine, pour défendre cette infrastructure essentielle à son économie…
Pénélope DUPAYS,
Noémie ROUFFELAERS.
Et si Trump annexait le Groenland
Trump réitère ses menaces expansionnistes sur le territoire autonome danois.
Trump veut acquérir l'île danoise de 2,166 millions de km². Il souhaite posséder le Groenland pour ses ressources naturelles et son avantage géographique et géostratégique. Cependant, le gouvernement danois ne se laisse pas intimider. Pour Mette Frederiksen, la première ministre danoise. " Le Groenland n'est pas à vendre ", a-t-elle rappelé lors d'une conférence de presse suite à un échange vif avec le président américain. "Trump n'aura pas le Groenland. Le Groenland, c'est le Groenland, et le peuple groenlandais est un peuple au sens du droit international, donc protégé par ce droit ", dit Lars Løkke Rasmussen à Copenhague.
Suite au refus des Danois de lui céder leur glacier, Trump menace le Danemark de prendre le Groenland par la force, en ajoutant que les Groenlandais voudraient quitter l'Union européenne et le Danemark au profit de son pays. Toutefois, "Le Groenland est une démocratie, ce sont les Groenlandais qui décident, personne d'autre" souligne un de ses habitants.
Un nouvel eldorado
Si Trump venait à s'approprier le Groenland, les États-Unis seraient en possession d'une véritable mine d'or. L'île glacée possède de nombreuses ressources inexploitées par le royaume nordique, telles qu'un gisement de lithium, des gisements d'uranium et du titane ainsi que d'importantes réserves d'hydrocarbures.
Le réveil d'un peuple indépendantiste
En annonçant vouloir conquérir le Groenland, Trump a ravivé la flamme indépendantiste des Groenlandais. Le gouvernement danois (social-démocrate), ne veut pas reproduire les erreurs qu'il avait commise lorsque les îles Féroé demandèrent leur indépendance au royaume.
Le 11 mars dernier se sont tenues des élections à Nuuk, la capitale du territoire autonome, où le parti de centre-droit (favorable à l'indépendance du Groenland) a emporté ces élections. De plus, l'assemblée groenlandaise a voté un texte de loi le 3 février dernier, pour que les différents partis politiques de l'île soient plus transparents sur leurs dons, afin d'éviter qu'une organisation extérieure au Groenland ne corrompe certains partis pour leur profit.
Nolan DEVISSE,
Alexandre PAILLARD.
Trump, Poutine : vers une paix en Ukraine ?
Alors que les deux superpuissances semblent négliger l'avis de Volodymyr Zelensky, elles posent pourtant enfin les conditions d'une « demi-trêve ».
Après plus de trois années de guerre, une perspective de fin du conflit semble se dessiner avec la présidence Trump.
Trump faiseur de paix ?
L'un des arguments de campagne du nouveau Président des États-Unis était de mettre fin à la guerre dans les 24 heures qui suivraient son investiture, délai non respecté par Donald Trump. Washington a cependant accéléré les négociations le 11 mars en organisant, avec l'Arabie Saoudite et l'Ukraine, une réunion diplomatique qui a abouti à la proposition d'une trêve de 30 jours acceptée par l'Ukraine, sous pression américaine.
Vladimir Poutine, lui, a préféré un accord plus précis mais finalement moins concret, décidé avec Trump lors de leur appel du 18 mars dernier. Un cessez-le-feu de 30 jours ne concernant que les infrastructures énergétiques ukrainiennes, assorti d'un échange de prisonniers entre les deux camps. Il a été, en plus, question du sort des milliers d'enfants ukrainiens enlevés puis placés "de force" en familles d'accueil russes ; « Le président Trump a promis de travailler étroitement avec les deux parties pour s’assurer que ces enfants seraient ramenés chez eux. » précise le communiqué américain. Donald Trump résume de son côté la conversation en la qualifiant de "positive".
Zelensky sur la touche
Bien que des discussions plus approfondies qualifiées de "difficiles" par le Kremlin se soient engagées en Arabie Saoudite, le chef d'État ukrainien semble exclu des pourparlers et dépendant des décisions américaines. On a assisté le 28 février, lors d'une rencontre entre V. Zelensky et D. Trump à la Maison Blanche, à l'impuissance du président ukrainien attaqué et humilié, Trump imposant son avis : « Je veux un cessez-le-feu ». Vœu en partie réalisé car Zelensky a accepté la proposition de "trêve énergétique", bien que de nombreuses de ses conditions aient été ignorées.
Lilian LEGOAREGUER,
Zoé LIEURY.
Échanges tendus à la Maison Blanche
La rencontre entre le président américain, son vice-président et le président ukrainien, le 28 février dans le bureau Ovale a tourné à l’altercation.
Le 28 février 2025 les présidents américain et ukrainien,Trump et Zelensky ainsi que le vice-président américain, J.D Vance se sont rencontrés à la Maison Blanche, dans le bureau Ovale dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. L'objectif officiel de cette rencontre était de signer un accord permettant aux États-Unis de participer à l'exploitation des précieux minerais de l'Ukraine en contrepartie du soutien apporté par Washington à Kiev depuis l'invasion russe de 2022.
Discussion tumultueuse
La réunion débute calmement, puis en direct, devant les caméras de télévision diffusant cette séquence, Trump et Vance reprochent au dirigeant ukrainien de ne pas lui dire merci pour le soutien que les États-Unis lui ont apporté pendant la guerre.
Trump et Zelensky commencent alors à parler en même temps. Tandis que Zelensky affirme : « Vous ressentirez une influence », Trump déclare : « Nous allons nous sentir très bien et très forts. [...] Vous n’avez pas les cartes. Avec nous, vous commencez à les avoir ». Zelensky rétorque : « Je ne joue pas aux cartes… Je suis très sérieux… Je suis un président dans une guerre », tandis que Trump insiste : « Vous jouez avec des millions de vies, vous jouez avec la Troisième Guerre Mondiale [...] et ce que vous faites est très irrespectueux » (envers les États-Unis), ajoutant : « Nous vous avons soutenu bien plus que beaucoup de gens ne pensent que nous n'aurions dû ».
Enjeux pour l'Ukraine
Cet affrontement verbal ne pouvait pas survenir à un moment plus difficile pour Zelensky. Tout d'abord parce que la Russie a exclu de rendre ce qu'elle a conquis par la force (environ 20 % du territoire ukrainien) ensuite parce que la priorité de Trump est d'améliorer les relations avec la Russie, et que les concessions de l'Ukraine sont un prix qu'il est prêt à payer.
Maryna MELNYK,
Faustine GRANDIERE.
Los Angeles : Trump face à la catastrophe
Après les incendies qui ont ravagé le grand quartier de Pacific Palissades, le nouveau président américain instrumentalise en affrontement politique ce méga feu.
La Californie brûle, et des milliers de familles voient leur vie partir en fumée. Plus de 23 000 hectares ont été ravagés, laissant des quartiers comme Altadena et Pacific Palissades méconnaissables. Les habitants tentent de s'organiser, mais la reconstruction dépend largement des aides fédérales, qui semblent aujourd'hui incertaines.
Trump accuse la Californie de mauvaise gestion
Donald Trump s'est rendu en Californie mais au lieu de rassurer les sinistrés, il a pointé du doigt la gestion locale. "Ils laissent l'eau se perdre dans l'océan, c'est du gaspillage !", a-t-il affirmé, une déclaration contredite par les experts. Il accuse aussi l’État de Californie (démocrate) de ne pas entretenir ses forêts et critique les associations environnementales.
Ces déclarations passent mal auprès des Californiens. Ils pensent que le président refuse de voir la réalité en face.
Le gouverneur Newsom sollicite une aide fédérale de 40 millards de dollars
Face aux destructions massives, Gavin Newsom a sollicité le Congrès pour une aide fédérale de 40 milliards de dollars afin de reconstruire les infrastructures et de soutenir les sinistrés. "La Californie contribue de manière significative à l'économie nationale, et son rétablissement est essentiel pour la prospérité de notre pays ", a-t-il déclaré.
La Californie face à une situation toujours précaire
Les incendies de janvier 2025 ont laissé Los Angeles dans une situation catastrophique. "C'est la désolation, tout est en ruine", confie un habitant d'Altadena.
Alors que des milliers de familles se battent, la reconstruction dépend largement de l'aide promise, mais les habitants commencent à douter que celle-ci arrive à temps.
Olga PERRIN-STRUB,
Louison LEVASSEUR.
Trump veut « nettoyer » Gaza
Les projets de Donald Trump pour la Bande de Gaza s'apparentent à un véritable « nettoyage ethnique ».
Après ses nombreuses déclarations, Donald Trump, nouvellement élu président États-Unis, "s'attaque" au conflit israélo-palestinien. Il ne cache pas son soutien à Israël, notamment en débloquant les livraisons de bombes à son armée, qui avaient été stoppées par le président sortant Joe Biden.
« Nous les avons débloquées aujourd’hui. », dit-il, devant les journalistes, à bord de son Air Force One présidentiel, ce 26 janvier. Le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, l'en a remercié.
Un plan de grande envergure
Donald Trump ajoute : « La bande de Gaza, c'est l'enfer depuis tant d'années [...] Je pense donc que les gens pourraient vivre dans des zones beaucoup plus sûres et peut-être beaucoup plus confortables ». C'est pourquoi le nouveau président dit vouloir proposer à Netanyahu d'organiser un déplacement massif de la population gazaouie vers les pays voisins, comme la Jordanie, et même l'Égypte. « J’aimerais que l’Égypte et la Jordanie accueillent des gens de Gaza, on parle de 1,5 million de personnes, il faut faire le ménage là-dedans ».
Cette stratégie de déplacement massif vise à "prendre le contrôle" de Gaza pour transformer le territoire en "nouvelle Riviera".
Les Gazaouis s'y opposent
Les populations y sont fermement opposées, beaucoup ont déjà refusé de quitter leurs vies et maisons avant la recrudescence des offensives israéliennes d'octobre 2023, après la violente offensive du Hamas.
Ce projet a aussi été rejeté par l'ensemble du monde arabe ainsi que par de nombreux autres pays, qui l'ont qualifié de "nettoyage ethnique".
Mathilde BRAQUET.
Conflit UE - X : une rupture inévitable
Faces aux ambitions numériques d' Elon Musk, l'Union Européenne intervient et tente de faire front afin de défendre la démocratie.
Le vendredi 12 juillet 2024, la Commission européenne a rendu un avis préliminaire indiquant que la plateforme X violerait le DSA (Digital Services Act).
L'institution soulève plusieurs manquements concernant le réseau social, acquis par Elon Musk en 2022.
La perversion de X
Le réseau social X est accusé par la Commission de privilégier la désinformation et de diffuser des informations non vérifiées. Selon la journaliste Kesso Diallo (BFMTV), X affiche le taux le plus élevé de désinformation.
Ses algorithmes amplifient les contenus toxiques et polémiques, attirant un large public.
Ils ont également été modifiés récemment pour mettre en avant les tweets de Musk et Trump comme chacun peut le constater.
L'UE se mobilise... enfin
Sous la pression d’eurodéputés et d’États membres pour agir fermement, le patron de X est soupçonné de manipuler ses algorithmes pour soutenir l’extrême droite en Europe et notamment en soutenant l'AfD (Alternative pour l'Allemagne).
Il a d'ailleurs affirmé sur son réseau, que seul ce parti d'extrême droite pouvait "sauver l'Allemagne", suscitant des inquiétudes à l’approche des législatives de 2025.La démocratie menacée ?
Suite à cela, certains élus poussent la Commission à suspendre la plateforme, au moins temporairement, pour la contraindre à respecter le DSA.
En dernier recours, la possibilité d’une amende à hauteur de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel de la plateforme est avancée.
Depuis son rachat par Elon Musk, X est devenu "le théâtre d'une transformation inquiétante". Il affaiblit la démocratie en favorisant la désinformation, en amplifiant les clivages, en polarisant le débat public et en donnant du pouvoir à des acteurs malveillants.
Clara TWITTENHOFF,
Klelya LETAILLEUR.
Musk soutient l'extrême droite allemande
« Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne » écrit le milliardaire Elon Musk sur son réseau social X le 21 décembre 2024 en pleine campagne des législatives outre-Rhin.
Lors du meeting de l'AfD (Alternative für Deutschland) à Halle, en Allemagne, le 25 janvier 2025, devant plus de 4500 personnes, Elon Musk s’est adressé en direct par vidéo à la salle aux côtés d’Alice Weidel, cheffe de file du parti. Il s’est prononcé en faveur du vote pour le parti d’extrême droite, déclarant : « Je suis très enthousiaste pour l’AfD, je pense que vous êtes vraiment le meilleur espoir pour l’Allemagne ».
De multiples ingérences pendant la campagne
Au début du mois de janvier, le patron de Space X avait organisé un échange sur sa plate-forme X avec Alice Weidel pour lui apporter son soutien. Le milliardaire américain l’avait notamment interrogé sur les accusations sur la filiation entre les idées de son parti et celles du parti national socialiste d’Adolf Hitler. Alice Weidel lui avait répondu qu’au contraire l’ancien dictateur allemand était en réalité "communiste" et que, a contrario, l'AfD est un parti "libertarien et conservateur". À l'approche des élections, Elon Musk a multiplié ses interventions et ses ingérences dans la campagne allant même jusqu'à tweeter "AFD !" le jour du scrutin.
Le milliardaire a agi de concert avec le vice-président américain JD Vance. Il a profité de la Conférence sur la Sécurité de Munich pour un entretien en tête-à-tête avec la cheffe de file de l’AfD.
Score "historique"
Avec plus de 20 % des voix à l'issue du scrutin, L'AfD a doublé son score par rapport aux législatives de 2021. Il est désormais la deuxième force du pays. Un résultat historique. « On voulait nous réduire de moitié, c’est le contraire qui s’est produit ! » a souligné Alice Weidel le soir des élections. Les analystes politiques estiment que les ingérences répétées d'Elon Musk dans la campagne ont contribué à banaliser sa présence sur la scène politique et à normaliser ce parti jugé sulfureux par une grande partie du pays et à l’étranger.
Gautier VERDURE.
Le groupe Meta met fin à la modération
Le PDG du groupe Meta, Mark Zuckerberg, a décidé que ses réseaux sociaux ne seraient plus soumis à la modération afin de restaurer « la liberté d'expression ».
Le 7 janvier 2025, Mark Zuckerberg a déclaré mettre fin à la modération sur ces plateformes aux États-Unis. Le patron de Facebook, Instagram et WhatsApp a décidé de remplacer les fact-checkeurs par des notes de la communauté car, selon lui, "il est temps de revenir à nos racines autour de la liberté d'expression". Cette décision marque son ralliement au clan Trump/Musk.
Une opportunité politique
Avant l'investiture de Donald Trump, Mark Zuckerberg a déclaré que ses réseaux sociaux étaient soumis à trop de censure. Rappelons qu'il avait lui-même décidé de suspendre le compte du nouveau Président sur Facebook suite à l'invasion du Capitole en 2021. Serait-ce donc aujourd'hui une tentative de "s'acheter une assurance" auprès de la nouvelle politique afin d'éviter une nuisance possible sur l'un des plus grands business mondial ? Le PDG de Meta chercherait ainsi à se ranger aux côtés de Donald Trump, en rivalité avec Elon Musk, pour atteindre le pouvoir américain. Ce nouveau mandat ouvre en effet de nouvelles portes aux "libertariens" leur permettant ainsi de se hisser en politique notamment grâce à la puissance de leurs plateformes mondiales, mais également grâce à leur puissance financière. Ce ralliement des libertariens américains pourrait être un moyen de promouvoir l'idéologie du masculinisme et du conservatisme pouvant ainsi entraîner des dérives.
Un risque pour la démocratie
Cette montée idéologique du libertarianisme au pouvoir favoriserait l'individualisme sur le plan numérique mais également sur le plan national mettant au péril la démocratie. Mark Zuckerberg a déclaré "Les géants de la tech préfèrent de plus en plus laisser leurs utilisateurs se charger de la vérification et de la modération, ce qui leur épargne les coûts financiers et politiques associés à ces tâches".
Cette fin du fact-checking, marque donc un nouveau regard sur la liberté d'expression de chaque individu mais dévoile aussi une raison majeure de cet arrêt, celle d'accroître l'empire financier du magnat de la tech.
Cette fragmentation de l'information pourrait donc entraîner le développement massif des discours haineux regroupant des propos homophobes et anti-féministes ; une section des règles interdisant de qualifier les femmes d'objets a été supprimée sur ses réseaux sociaux. Ou encore de la propagande de complotisme remettant ainsi en cause la parole des hommes politiques, des médias et des experts. Ce nouveau mandat présidentiel signerait-il le début de la fin de la démocratie ?
Camille SACHY.
Tiktok banni : sécurité, enjeux géopolitiques
Alors que la plateforme séduit des millions d'utilisateurs, sa fermeture aux États-Unis pourrait marquer un tournant dans la régulation des géants du numérique.
Le 19 janvier 2025, une loi interdisant TikTok aux États-Unis a poussé la plateforme à rendre les services du réseau social indisponibles aux citoyens américains le temps de trouver une alternative avec le nouveau président.
La guerre des données
En avril 2024, le Congrès des États-Unis a adopté une loi pour protéger les données des utilisateurs ciblant TikTok, jugé comme un moyen pour le régime chinois de collecter massivement des informations personnelles.
Cependant, certains voient aussi dans cette loi une tentative du gouvernement américain de contrôler pour des raisons de sécurité nationale un réseau social difficile à réguler à cause de la quantité d'informations publiées. Elles s'élevent à 1 milliard par jour.
Une perturbation économique et culturelle
L'interdiction de l'application rendrait beaucoup plus difficiles les métiers artistiques et leurs promotions, TikTok permettant à de nombreux créateurs de partager leur contenu et d'en faire un phénomène viral.
L'interdiction de la plateforme priverait aussi de revenus de nombreux influenceurs.
Des négociations cruciales pour l'avenir de Tik Tok
TikTok a obtenu un délai de 90 jours pour se conformer aux exigences américaines, sous peine de sanctions.
Cette décision soulève des questions sur l'équilibre entre sécurité nationale et libre circulation des services numériques.
Trump a exprimé des inquiétudes sur la sécurité des données des citoyens américains en raison des liens de l'application avec la Chine.
En 2020, il a tenté de forcer la vente de TikTok à une entreprise américaine, affirmant que cela protégerait les données des utilisateurs de l'influence chinoise.
Clémence BOUCHEDDA-LIBERT,
Paul LETIENNE.
Soudan : les civils, victimes de la guerre
Presque deux ans après le début de cette guerre oubliée, les populations soudanaises voient leurs conditions de vie se dégrader sans aide extérieure.
Depuis le 15 avril 2023, après la chute de l'ancien dictateur Omar el-Bechir, les Soudanais subissent le conflit entre le général Al-Burhan et le général Hemetti pour le contrôle du pays.
L'armée régulière d'Al-Burahan et les forces d'intervention rapide d'Hemetti s'affrontent dans la capitale Khartoum et dans les régions du Soudan comme le Darfour, où les populations subissent les combats et les violences des soldats.
Basées sur des caractéristiques ethniques, des exécutions de civils ont eu lieu faisant entre 20 000 et 150 000 morts depuis le début des hostilités. Des viols organisés sont infligés à de nombreuses femmes. Cette guerre aura des conséquences à long terme pour les habitants et victimes du conflit.
Les populations sont confrontées à des problèmes d'accès aux ressources de base, nourriture et eau potable. Les carences alimentaires présentent un réel danger pour les Soudanais.
Des tristes records
Le pays fait face à une situation de famine touchant 80 % de la population et notamment les enfants. 14 millions d'entre eux auraient besoin de soins médicaux. Le Soudan compte à ce jour plus de 12 millions de réfugiés répartis dans tout le pays et dont 3,5 millions dans des camps situés dans des pays voisins. Ce qui en fait la pire crise migratoire au monde depuis des décennies.
Des lueurs d'espoir
Les populations doivent s'adapter. Les locaux ont mis en place des soupes publiques pour les plus démunis. Une "nouvelle capitale" a été établie à Port-Soudan, qui accueille de nombreux réfugiés. Les ONG ont enfin pu arriver dans le pays grâce à l'ouverture d'accès.
Les organisations internationales commencent à prendre le conflit en main en réaction aux massacres de civils. Elles réclament une enquête pour crimes contre l'humanité. "Il est clair pour mon bureau (...) qu'au moment où nous parlons des crimes internationaux sont sans aucun doute en train d'être commis au Darfour", a déclaré Karim Khan, procureur à la Cour Pénale Internationale.
Clara VANDENBERGHE,
Joris LEFORT.
La RDC, un pays à l'agonie
la situation à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) s'est détériorée avec l'avancée des rebelles soutenus par le Rwanda voisin.
Ancienne colonie belge, la République Démocratique du Congo connait une guerre civile dans ses provinces de l'Est depuis presque 30 ans. Le conflit s'est ravivé ces dernières semaines avec l'avancée rapide du "M23", un groupe rebelle armé créé en 2012 dans la région du Nord-Kivu, entré en rébellion contre le gouvernement de Kinshasa et soutenu par le Rwanda.
Un conflit internationalisé
Après avoir pris la ville de Goma au mois de janvier, les combattants du M23 se sont emparés il y a peu de Bukavu, l'objectif étant de prendre le contrôle de l'ensemble de la région du Kivu, notamment pour ses mines de coltan et d’étain, composants d’appareils électroniques, ce qui permettrait d’avoir une emprise sur le marché mondial.
Le conflit affecte également les pays voisins en provoquant une déstabilisation dans toute la région des Grands Lacs (Rwanda, Ouganda, Burundi et Zimbabwe). Ces pays sont directement impliqués, soit par des interventions militaires, soit en soutenant différentes factions comme, par exemple le groupe M23 pour le Rwanda. Les États-Unis, la France, la Belgique ou encore la Chine et d'autres acteurs ont aussi joué un rôle en soutenant certaines factions ou en ayant des intérêts stratégiques dans les ressources naturelles du pays. Cela a contribué à la complexité du conflit et à la durabilité de l'instabilité et ce malgré la présence de la MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo) critiquée pour son incapacité à empêcher certaines atrocités.
Un peuple en détresse
"Les bombes tombaient et tuaient des gens partout", raconte depuis un centre de transit frontalier rwandais Destin Jamaica Kela à l’AFP le 28 janvier dernier. Il a depuis fui avec sa famille au Rwanda, dans un camp de réfugiés avec plus de 200 autres Congolais, après avoir vécu plusieurs jours sans manger, boire et sans avoir d’endroit où dormir. Selon lui, "l'humanité a abandonné les gens".Une rencontre a eu lieu le mardi 19 mars au Qatar, ouvrant l'espoir à un cessez-le-feu durable entre le M23 avec le Rwanda et la RDC.
Louise GROSS,
Robin RICAUX.
Géorgie, la fin du rêve européen ?
Le 14 Décembre 2024, le candidat du parti pro-russe Rêve Géorgien, Mikheïl Kavelachvili, à été élu président de la Géorgie, une élection contestée.
Le 26 octobre dernier les Géorgiens ont été appelés aux urnes pour les élections législatives, élections remportées par le parti pro-russe, “Rêve géorgien”. Le résultat a été contesté par l’opposition pro-européenne ainsi que par l'ex-présidente Salomé Zourabichvili, plongeant le pays dans une grave crise politique. Un avenir incertain plane sur la Géorgie.
Des élections "entachées d'irrégularités"
Pour l'opposition pro-européenne, les élections du mois d'octobre ont été "entachées d'irrégularités" et marquées par de multiples fraudes (pressions sur les électeurs, bourrages d'urnes, achats de voix,...) et ingérences russes, ce que dément le parti "Rêve géorgien". Malgré ce démenti, l'opposition boycotte le Parlement fraîchement élu et appelle depuis à de nouvelles élections et à manifester dans les rues de la capitale Tbilissi. "Nous sommes témoins d'une opération russe spéciale, une forme moderne de guerre hybride contre le peuple géorgien", a déclaré l'ex-présidente Salomé Zourabichvili.
Un nouveau président "illégitime"
Au mois de décembre, la crise s'est aggravée avec l'élection par le Parlement d'un nouveau président qui a pris ses fonctions le 29 décembre, l’ex-footballeur Mikheïl Kavelachvili, connu pour ses prises de position ultraconservatrices, pro-russes et anti-occidentales. L'une de ses premières décisions a été de suspendre le processus d'adhésion à l'Union européenne. Cette décision va à l'encontre de la perspective européenne souhaitée par la majorité de la population. Son parti met en place un régime autoritaire et adopte des lois pour favoriser la répression. Pour l'ancienne présidente Salomé Zourabichvili qui s'estime la seule présidente légitime, « Kavelachvili ne sera jamais président de la Géorgie. Tout comme le Rêve Géorgien ne sera jamais la force dirigeante du pays, car il ne s’agit pas d’un gouvernement légitime ».
Angèle FOURAY,
Romane BELLEC.
Israël-Hamas : un cessez-le-feu caduc
Signé le 15 janvier 2025, l'accord de cessez-le-feu a été rompu deux mois plus tard avec la reprise des bombardements israéliens à Gaza.
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été mis en place le 15 janvier 2025 notamment grâce à la médiation du Qatar et à la pression des États-Unis.
L'accord conclu prévoyait une trêve de six semaines avec la libération progressive des otages israéliens entre les mains du Hamas et l'instauration d'un cessez-le-feu permanent à l'issue de cette période.
Israël met fin à la trêve
La trêve a pris fin le 18 mars 2025 avec la reprise des bombardements israéliens. « Ce n’est que le début », a prévenu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. « Désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu », a-t-il également affirmé.
« Je peux confirmer que la reprise des combats intenses s’est faite en totale coordination avec Washington », a affirmé mardi David Mencer, un porte-parole du gouvernement israélien, lors d’un point presse.
Selon un premier bilan mercredi 19 mars, cette offensive a provoqué la mort de plus de 470 personnes supplémentaires en 48 heures.
Mais le Hamas, bien qu'affaibli, est toujours une menace. Grâce au cessez-le-feu, il a pu se reconstruire et affirme être prêt pour la reprise des combats.
Gaza, un champ de ruines
Selon le ministère de la santé du Hamas, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait plus de 48.000 morts et plus de 111.000 blessés depuis le 7 octobre 2023.
Quant aux destructions matérielles, elles sont considérables, l'enclave étant réduite à un champ de ruines rendant extrêmement difficiles les conditions de vie des habitants souvent déplacés par la guerre.
Aimann THIRION,
Mathéo HART.
La loi Veil est-elle en danger ?
Malgré l'inscription dans la constitution de la loi Veil en 2024, l'IVG reste fragilisée en France par plusieurs oppositions.
Remis en cause aux États-Unis en juin 2023, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est un droit fragile.
Dimanche 19 janvier 2025 à Paris, des milliers d'opposants à la loi Veil ont manifesté dans le cadre de la "marche pour la vie".
Des opposants qui
se mobilisent
"IVG, ça suffit, nous marchons pour la vie". La manifestation est organisée par des militants conservateurs catholiques chaque année autour de l'anniversaire de la loi portée par Simone Veil relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et promulguée le 17 janvier 1975.
S'exprimant sur un podium, le président de la Marche pour la vie, Nicolas Tardy-Joubert a affirmé ne pas avoir "peur de dire que l'avortement est la première cause de mortalité en France pour l'espèce humaine".
Parmi les anti-IVG présents lors de la manifestation, une dizaine de militantes du collectif féministe "NousToutes" ont déployé une banderole "les anti-IVG ont du sang sur les mains" avant d'être exfiltrées par le service de sécurité en début de manifestation.
Les associations féministes s'alarment d'un droit toujours "fragile" et font état "d'attaques régulières" de ses opposants.
Pourtant la France est le premier pays du monde à avoir constitutionnalisé le droit à l’IVG par le vote du Parlement réuni en Congrès à Versailles le 4 mars 2024.
Un droit menacé en Europe
Le droit des femmes à disposer de leur corps est l’une des cibles principales des mouvements anti-genre et conservateurs, ce qui fait du droit à l’avortement un droit menacé à défendre.
Si la plupart des pays européens autorisent maintenant l'IVG, son maintien est loin d'être garanti. Le cas de la Pologne doit nous alarmer. En effet, ils ont presque interdit l'avortement. Le droit à l’IVG n’est jamais complètement acquis et il faut tout faire pour le protéger, comme nous le rappelle la situation aux États-Unis.
Eva LEROUX
Camille SIMON.
Simone Veil, le combat de toute une vie
Il y a 50 ans, le 17 janvier 1995, Simone Veil, ministre de la santé, remportait son combat pour le droit à l'avortement.
La loi de l’interruption volontaire de grossesse ( IVG ) a été adoptée le 20 décembre 1974, d'abord à titre expérimental pour une durée de 5 ans, avant son adoption définitive le 17 janvier 1975. Cette loi a été mise en place pour améliorer les conditions de la vie des femmes, car l’accès à la contraception étant insuffisant, de trop nombreuses interruptions volontaires de grossesse se déroulent clandestinement dans des conditions dangereuses mettant en péril la vie des femmes.
Tout cela a été possible grâce à une femme, Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Durant son discours, devant une Assemblée nationale pratiquement composée d’hommes, elle a su imposer ses idées en affirmant qu'« aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement ». La loi autorise l’IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse, tout en laissant le droit à tout médecin ou établissement hospitalier de refuser de pratiquer des avortements.
La constitutionnalisation de l'IVG
Le 17 janvier 2025, la loi Veil fêtait ses 50 ans et elle a subi plusieurs modifications depuis 1975.
Il y a d’abord les modalités de recours à l’IVG qui ont évolué avec la méthode médicamenteuse qui est devenue majoritaire, ainsi que la prise en charge des IVG hors établissement de santé. Puis, en 2022, le Parlement vote l’allongement du délai de recours à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Avec le décret du 23 avril 2024, quel que soit le professionnel qui réalise l’acte d’IVG, les sages-femmes peuvent le pratiquer sans la supervision de médecins. Enfin, le changement le plus récent et le plus important est intervenu le 8 mars 2024 avec l’inscription dans la Constitution de la « liberté garantie à la femme » de recourir à l’IVG, ce qui assure une forte portée symbolique à cette avancée majeure des droits des femmes.
Lalie RIMBERT,
Morgane MANTEL.
La vie impossible des femmes afghanes
« Le crime des Afghanes ? Etre une femme. Leur faute ? Exister » : les présidentes du Parlement, porte-voix des opprimées.
À leur retour au pouvoir, les Talibans avaient promis de ne prendre aucune mesure discriminatoire à l'encontre des femmes, contrairement à leur premier régime de 1996 à 2001. Cette promesse n’a absolument pas été tenue. Déjà privées d’éducation, d’emploi, de liberté de déplacement et d’accès à l’espace public, les femmes subissent une nouvelle restriction. Un décret annoncé le 28 décembre 2024 par le bureau des affaires administratives, ordonne la suppression des fenêtres donnant sur l’extérieur dans leurs logements, sous prétexte que « le fait de voir des femmes travaillant dans des cuisines, dans des cours ou collectant de l’eau dans des puits peut engendrer des actes obscènes ". Les femmes afghanes doivent désormais être invisibles, même au sein de leur propre domicile.
Un « apartheid de genre »
Depuis le retour des Talibans en août 2021, les femmes ont été progressivement exclues de l’espace public, conduisant l’ONU à dénoncer un « apartheid de genre ». Malgré leurs nombreuses restrictions, une nouvelle loi leur interdit de chanter, de réciter de la poésie et impose d’« atténuer » leurs voix hors de chez elles, poussant certaines radios et télévisions à censurer les voix féminines. Pourtant, les autorités talibanes assurent que la loi islamique « garantit » les droits de tous !
Des femmes qui luttent en silence
Cette lente asphyxie de la moitié de la population, commencée en mars 2022 par la fermeture des lycées aux filles, se poursuit. Malgré cette répression, beaucoup continuent de lutter comme elles le peuvent, en puisant leur force dans leur désespoir. Dans le bruit du monde, le silence est tombé sur elles. Seuls les décrets du chef des islamistes afghans, Haibatullah Akhundzada, réduisant à chaque fois ce qui leur reste de liberté, rappellent qu’en Afghanistan, le genre détermine le droit d’exister socialement ou non. La situation des femmes en Afghanistan inquiète. Pour Fawzia Koofi, ancienne députée du Parlement afghan :"Les femmes n'ont plus le droit de respirer à cause du régime répressif des Talibans." "Toutes les activités propres aux humains sont interdites aux femmes", déclare-t-elle. Pour décrire cette réalité, il faut aller sur place. Si le tableau est sombre, des voix féminines partagent encore leur espoir de peser sur l’avenir du pays.
Tessa DUJARDIN,
Emma ROUSSEL.
Irak : vers un mariage légal très précoce ?
Sous la pression des conservateurs chiites, le Parlement irakien cherche à baisser l'âge du mariage dès 9 ans pour les jeunes filles.
Le mardi 21 janvier, le Parlement Irakien a adopté une proposition de loi qui ouvre la voie au mariage à partir de l'âge 9 ans pour les filles. L’âge légal du mariage demeure fixé à 18 ans et, au minimum, à 15 ans, avec l’autorisation des tuteurs légaux et d’un juge. Mais la proposition de loi redonne aux autorités religieuses un droit de regard sur la gestion des affaires familiales. Elle pourrait encourager le mariage à un âge plus précoce, dès 9 ans pour la communauté chiite. Cette proposition de loi remet en cause d'autres droits des femmes, tels que le droit au divorce, la garde des enfants suite à une rupture de mariage ainsi que le droit à l'héritage. D'après la coalition des partis musulmans chiites conservateurs au pouvoir à l'origine de cette proposition, cela permettrait de "consolider le pouvoir". Pour le député indépendant Sajjad Salem cet amendement est une "abomination".
Le mariage forcé, une pratique déjà courante
La loi de 1959 donne aux femmes le droit de divorce et interdit le mariage avant 18 ans. Elle est déjà très souvent enfreinte. Bien que cette pratique soit illégale, les jeunes filles sont souvent forcées à se marier avant 18 ans à des hommes plus âgés qu'elles avec l'accord du chef de famille. Selon l'Unicef, en 2021, 28 % des femmes Irakiennes sont mariées avant l'âge de 18 ans soit une femmes sur quatre.« Mon père m'a vendue au frère de l'un de ses amis. Je ne voulais pas l'épouser, il était trop vieux, violent, toujours très en colère. Mais je ne pouvais pas refuser. » explique au quotidien La Croix, Shaima une femme divorcée.Des femmes privées de liberté
Dans une société ultra conservatrice et patriarcale, la place de la femme est avant tout à la maison, à l'abri des regards. Et gare à celles qui voudraient faire voler en éclats les traditions : mariages forcés, viols et crimes d'honneur ! Une coutume appelée « fasliya » permet même d’offrir une femme pour lier deux clans afin d'empêcher de futurs affrontements. Aujourd'hui, quelques femmes se battent à leur échelle au risque de leur vie. Pour ces femmes, chaque jour est une survie.
Justine TRAULLE,
Louna WILLIOT.
Auschwitz-Birkenau : le devoir du souvenir
Il y a 80 ans, nous assistions à la libération du camp de la mort, dévoilant l’horreur nazie. Aujourd’hui, se souvenir est une responsabilité collective.
Le 27 janvier 1945, l’Armée rouge découvre le camp d’Auschwitz-Birkenau. Sur place, 7,000 prisonniers trop faibles pour fuir, abandonnés par les nazis. Les soldats soviétiques découvrent l’ampleur de l’horreur : des cadavres, des baraquements insalubres, des preuves accablantes du génocide.
Les images tournées sont d’abord censurées, avant que les Alliés ne comprennent la mesure du crime. Auschwitz-Birkenau devient alors le symbole de la Shoah, rappelant la barbarie du régime nazi et l’extermination de plus d’un million de personnes dans ce lieu de mise à mort.
Un devoir de mémoire face à l’oubli
Le 27 janvier 2025, une cérémonie a marqué les 80 ans de la libération d’Auschwitz, réunissant dirigeants politiques et survivants. Ces derniers témoins d’un passé qui s’efface ont rappelé l’horreur quotidienne vécue derrière ces barbelés : la séparation brutale des familles, la sélection, la faim, la peur constante de la mort.Transmettre pour ne jamais revivre
Pourtant, la mémoire s’effrite. 46 % des jeunes Français ne connaissent pas précisément la Shoah, un chiffre alarmant. Alors que les survivants disparaissent, il est essentiel de transmettre leur témoignage. Se souvenir d’Auschwitz, c’est prévenir l’oubli et lutter contre la haine et l'antisémitisme et son augmentation.
L’enseignement de la Shoah ne concerne pas seulement le passé, mais aussi l’avenir. Aujourd’hui encore, l’antisémitisme persiste et des génocides continuent de se produire à travers le monde. Auschwitz est un avertissement : la haine, lorsqu’elle est ignorée ou minimisée, peut mener aux pires atrocités.
C’est pourquoi le travail de mémoire ne doit pas se limiter aux commémorations. Il doit s’incarner dans l’éducation et la vigilance face aux discours de haine. Se souvenir, c’est résister. Se souvenir, c’est agir.
Timéo DUMOULIN,
Clément CORROY.
Ultimes paroles des survivants d'Auschwitz
Au 80e anniversaire de la libération du camps de la mort, seules les voix des rescapés ont pu être entendues.
Il y a 80 ans, l'armée soviétique entrait et libérait le camp de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Après 1945, la mémoire de la Shoah reste enfouie, personne ne veut parler des souffrances de la guerre et des déportés. Contrairement à aujourd'hui où la demande de témoignages est essentielle pour retracer l'histoire. C'est pour cela qu'à la cérémonie organisée en la mémoire des victimes de ce génocide ce 27 janvier 2025 en Pologne, à Auschwitz, seules les paroles des rescapés ont été autorisées à se faire entendre malgré le grand nombre d'hommes politiques invités et présents.
Les personnalités politiques dans l'obligation du silence
Le roi Charles III, le Président français Emmanuel Macron, le Chancelier et le Président allemand, Olaf Scholz et Frank-Walter Steinmeier, le Président polonais Andrzej Duda, et d'autres dirigeants n'ont pas pu prendre la parole. "Cette année, nous nous concentrons sur les survivants et leur message", a déclaré à l'AFP Pawel Sawicki, porte-parole du musée d'Auschwitz. "Il n'y aura pas de discours d'hommes politiques", a-t-il souligné. Ce n'est qu'une fois la cérémonie finie qu'ils ont eu le droit de s'exprimer.
Des exclus pour un meilleur silence
Le Président russe, Vladimir Poutine, n'a pas été invité car il est accusé d'être responsable des crimes de guerre en Ukraine. De même pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, accusé de crime contre l'humanité à Gaza par la Cour Pénale Internationale, qui a émis un mandat d'arrêt contre lui.
"L'ère des témoins"
C'est le dernier anniversaire avec autant de survivants. Ils étaient une cinquantaine à être présents ce jour. Et seuls quatre ont pris la parole : Marian Turski, Tova Friedman, Leon Weintraub et Janina Iwansk avec des écharpes a rayures bleues et blanches symbolisant leurs anciens uniformes de prisonniers.
Lilou CHARLY.
Dix ans après, l'esprit Charlie perdure
Il y a 10 ans Charlie Hebdo était la cible d'une attaque terroriste, un drame à ne pas oublier pour entretenir l'esprit Charlie.
En janvier 2015, la France est frappée par une série d’attentats qui marqueront durablement les esprits. Le 7 janvier, l’attaque contre le journal Charlie Hebdo fait douze victimes.
Dix ans plus tard, la France se recueille pour honorer la mémoire des victimes et réaffirmer son attachement à la liberté d’expression à travers des cérémonies officielles en présence d'Anne Hidalgo maire de Paris, le Président de la République Emmanuel Macron et de plusieurs ministres.
Esprit Charlie, es-tu toujours là ?
Conformément aux souhaits des familles, les hommages et les commémorations se sont déroulés sobrement. Ils ont pris plusieurs formes : des recueillements, des émissions de télévision spéciales, une mobilisation des établissements scolaires.
L'association "Cartooning for peace" a publié 40 dessins pour Charlie dans la collection "Tracts". « La tristesse est la même, l'émotion aussi » pour François Molins, procureur de Paris à l'époque. "Nous réaffirmons aujourd'hui, avec force et conviction, notre attachement indéfectible à la liberté d'expression" a-t-il affirmé.
Une maison du dessin de presse
Ces mots traduisent encore "l'esprit Charlie" et la résilience 10 ans plus tard.
Rachida Dati, ministre de la Culture, souhaite que la Maison du dessin de presse soit "un hommage de la République aux victimes assassinées pour avoir défendu,sans jamais faiblir et au service de tous les citoyens, la cause de la liberté". Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2025 à Paris et l’ouverture au public pour 2027.
Cette année, la 32e édition du Salon du dessin a été un succès sans précédent, il a accueilli 15 000 visiteurs, soit une fréquentation en hausse de 25 % par rapport à l’édition 2023, révélateur peut-être de cet "esprit Charlie".
Manola HAREL,
Chloé CHEVALLIER.
Le mot de la fin ?
Depuis 3 ans « Georges décrypte » est un outil pour les élèves de première et de terminale HGGSP.
Déjà le cinquième numéro et une sensation très personnelle, mêlant nostalgie et fierté.
Une belle idée
Tout commence par une idée de mon collègue Jean-Luc Villemin : Mettre à disposition des élèves de la spécialité HGGSP (Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques) un journal pour s'exprimer sur l'actualité internationale. Nous embarquons depuis chaque année nos élèves dans cette expérience originale et formatrice. Ils apprennent à produire une information, à la vérifier.
Des "apprentis journalistes"
Accompagnés depuis le début du projet par Edouard Maret et Xavier Alexandre, journalistes à Ouest France, nos élèves découvrent le métier de journaliste et mettent en pratique quelques principes : "Dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner". Nos élèves apprennent donc à se questionner et à devenir "des journalistes, les historiens de l'instant", célèbre formule d'Albert Camus.
Un moment particulier
C'est un projet concret, motivant, gratifiant qui éveille et stimule leur curiosité intellectuelle.
Mais la retraite pointe à l'horizon, nous allons passer le témoin à nos jeunes collègues, entre sentiment de satisfaction du devoir accompli et regrets.
Une nouvelle étape commence, pleine de promesses.
Laurence CARREZ-MARTIN.
Donald Trump est-il fasciste ?
Trois questions à l'éditorialiste de Ouest France, Jacques Le Goff.
Professeur émérite des universités, éditorialiste pour Ouest-France depuis 48 ans, Jacques Le Goff est juriste, sociologue et philosophe
Selon vous, Donald Trump est-il fasciste ?
Pour John Kelly, son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche, le doute n’est pas permis : Donald Trump est bel et bien « fasciste ». Ce que Mark Milley, ancien chef d’état-major des armées, confirme : « Il est fasciste jusqu’à la moelle ».
L’affaire est d’importance pour le proche et lointain avenir des États-Unis et du monde.
Mais que veut dire « fasciste » ? L’usage essentiellement polémique et intempérant du qualificatif, dans sa version « facho », lui a fait perdre une bonne part de son tranchant explicatif.
Au moins trois traits caractérisent le fascisme.
D’abord une conception de la communauté politique reposant sur l’idée de pureté et donc de discrimination sourcilleuse à l’égard des non-conformes à ce critère, à la fois idéologique (vision du monde et des valeurs) et racial. Le pluralisme doit s’incliner devant une orthodoxie opérant la sélection entre les purs et les autres, marginalisés ou évincés. La voie est dès lors ouverte à la chasse aux sorcières contre les « ennemis de l’intérieur » qu’il s’agisse des « déviants » ou des perturbateurs de la mise en œuvre du grand projet purificateur (procureurs, journalistes…). Et place au rejet des immigrants et groupes minoritaires comme Juifs sous Hitler, ou des « démocrates » sous Mussolini, Franco, Salazar ou… Staline. Le nationalisme centripète de Trump, qui s’applique aussi à la Chine, à l’Europe et aux Émergents, suprémaciste à l’intérieur comme à l’extérieur, constitue l’arrière-plan d’un projet préoccupant.
S’y ajoute une conception du pouvoir de tonalité vitaliste organisée autour de la vision populiste d’une fusion entre le leader et « son » peuple. « Je suis votre voix, dit Trump, je suis votre guerrier, je suis votre justice. Et pour ceux qui ont été lésés et trahis, je suis votre châtiment » de statut prophétique puisque « sauvé par Dieu » lors de la tentative d’assassinat. Avec le risque avéré d’une absorption du peuple par le leader et d’une captation directe de son énergie dégénérant en violence par définition… légitime. Ce fut l’épisode du Capitole, ce pourrait être un déferlement de vengeances sans frein au nom du « bon peuple ».
Ce que fait redouter, troisième trait, l’idée que Trump se fait de son pouvoir présidentiel moins comme une fonction constitutionnelle que comme un attribut personnel identifié au bon vouloir. Je suis le chef, un vrai chef de guerre, et je fais ce que bon me semble. L’État c’est moi et l’État de droit aussi. « Il n’a jamais accepté le fait qu’il n’était pas l’homme le plus puissant du monde, ayant la capacité de faire ce qu’il voulait » (John Kelly) par tous les moyens à commencer par le mensonge. Qui lui résiste n’est pas un opposant mais un « ennemi » justifiant le sort réservé aux traîtres.
S’il n’est pas fasciste, ce dont on peut douter, il est au minimum fascistoïde.
Et qu’en est-il d’Elon Musk accusé d’avoir pratiqué un salut nazi lors du meeting d'inauguration de Donald Trump, suivi d’un soutien public à l’AfD, le parti d’extrême-droite allemand ? Est-il lui aussi fasciste ?
Son libertarianisme, qui est un ultra-libéralisme devrait, en principe, l’en prémunir. Mais, curieusement, une conception extrême et extrémiste de la liberté c’est-à-dire de « sa » liberté peut conduire à son contraire, à l’oppression et d’autant plus qu’il déploie son influence au sein et avec les armes de l’État qu’il pourfend par ailleurs. J’ai dit et écrit qu’il était le Goebbels de Trump. Cela a surpris. Mais je le maintiens. Dans les deux cas, l’alliage propagande / pouvoir presque illimité peut générer le pire.
Faut-il être inquiet pour l’avenir de la démocratie américaine ?
Le nouveau président a annoncé la « dictature le premier jour ». Redoutons qu’elle ne dure plus longtemps dans un mixte de brutalité conforme à son tempérament, et de manœuvres insidieuses sapant le socle du régime.
Avec un dispositif institutionnel (Congrès et Cour suprême) désormais entièrement à sa botte, le pire n’est plus possible mais probable. Trump est dans la logique d’un pouvoir illimité, avec l’appui de Musk, et dont on voit mal ce qui pourrait l’endiguer sans un sursaut de tous les contre-pouvoirs officiels ou ce qu’il en restera, et officieux, à savoir la nation elle-même dans ce qu’elle conserve d’esprit authentiquement démocratique.
Alors oui, on peut être inquiet pour l'avenir de la démocratie américaine.
Propos recueillis par
Jean-Luc VILLEMIN.