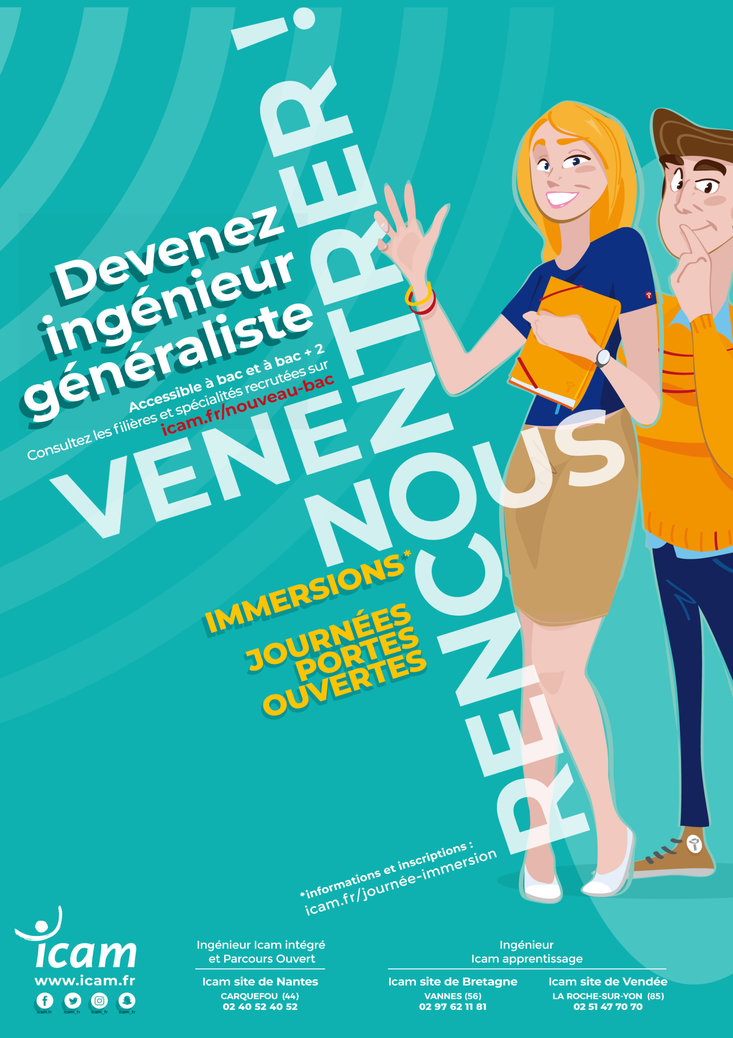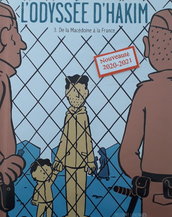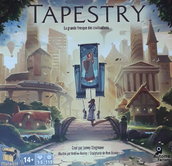Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).
Page 9
Fan de généalogie
Julien Remaud, professeur d'histoire-géographie , est un fan de généalogie qu'il pratique à chacun de ses temps libres. Depuis des années, il traque ses ancêtres 6 500 recensés à ce jour.
Page 7
A l'Ironman des Sables
Avec Lionel Berland, prof d'EPS, et Bertrand Potier directeur du lycée, Sean Morris a participé à l'Ironman des Sables, début septembre. Le trio a réussi son pari de terminer l'épreuve avec les honneurs.
Page 5
Au lycée, à vélo
Jean-Marie Chauvière, vient au lycée à vélo depuis quatre ans. Autant par pur plaisir que par souci écologique. Il milite pour une meilleure prise en compte des besoins des cyclistes dans les rues de La Roche-sur-Yon.
Page 4
Masquée de licornes
Tous masqués depuis la rentrée. Anja Gereke, professeur d'allemand, a pris les choses du bon côté en arborant des masques originaux montrant des licornes, son animal mythique préféré.
Saint-François s'habille de neuf
Lire page 3

| N° 40 - Décembre 2020 | www.stfrancoislaroche.fr |
Des rentrées particulières !
Confinement et mise en place du télétravail à cause du Covid 19 ont bousculé la vie du lycée. Entretien avec Bertrand Potier, directeur.
Comment avez-vous géré le lycée pendant le confinement ?
J'ai dû me mettre en télétravail, mais je suis rapidement retourné dans l'établissement, notamment pour gérer les dossiers d'inscription. Le conseil de direction se retrouvait tous les deux jours en visioconférence pour assurer la continuité pédagogique.
Comment s'est déroulée la rentrée 2020 ?
Elle s'est globalement bien passée, malgré les changements qu'il y a eu cette année. Le lycée a dû appliquer le protocole sanitaire, comme tous les lycées en France, ce qui implique de nouvelles habitudes : le port du masque, le gel hydroalcoolique et les désinfections régulières dans toutes les salles. Le lycée a tenu à donner des masques aux professeurs et au personnel. Cette rentrée fut plus compliquée que les précédentes, car il fallait penser à beaucoup de choses.
Etes-vous déçu de ne pas avoir pu emménager sur le nouveau site ?
Je suis très déçu de ne pas avoir pu rentrer sur le nouveau site dès septembre, évidemment. Nous avons appris très rapidement qu'il ne serait pas possible d'emménager dans le nouveau lycée. Sachant que le planning de construction était très tendu, le fait de suspendre les travaux 15 jours a été l'élément décisif. Toutefois, la bonne nouvelle est que le déménagement se fera bel et bien en décembre.
Comment s'est passée la rentrée de la Toussaint suite au deuxième confinement ?
En réalité, le deuxième confinement n'a pas eu de gros impact sur le lycée. Le protocole sanitaire du mois de septembre a seulement été renforcé. Ce renforcement de protocole consiste en pratique à éviter le brassage des élèves et le risque de contamination. Il se traduit par une application plus stricte des sens de circulation et à l'aération plus fréquente des salles du lycée.
Avez-vous un message particulier à transmettre
aux élèves ?
Il faut continuer à jouer le jeu, respecter les règles pour arriver à passer cette période difficile. Il faut agir individuellement dans le collectif et pour le collectif, et penser à soi tout en pensant aux autres.
Interview réalisée par
Justine LOTIN, terminale A.
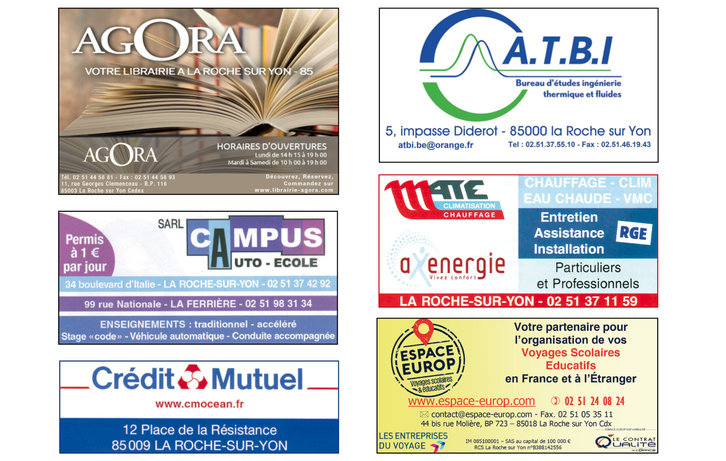
Anthony Tesson architecte de notre futur
Anthony Tesson est l'architecte en charge du nouveau lycée Saint-François-d'Assise : 30 000 mètres carrés, et un coût d'environ 50 millions d'euros de travaux.
Membre du cabinet d'architecture Pelleau & Associés, Anthony Tesson a obtenu son bac en 1998 à Saint-Joseph ! Il se retrouve 20 ans plus tard à piloter le projet qui va rassembler le pôle professionnel et le pôle général de l'établissement. C'est pour lui une expérience inédite qu'il n'est pas sur de pouvoir vivre à nouveau.
Pelleau & Associés avaient déjà mené des travaux sur le site Victor Hugo, notamment l'escalier en métal du bâtiment C. Anthony Tesson s'occupe principalement d'établissements scolaires. Il a travaillé pour les lycées du Roc et de Sainte-Marie, ainsi qu'au collège Saint-Pierre.
Pour Anthony Tesson, « l'architecte est un facilitateur pour construire et son but est de proposer des projets réalisables et durables. Le métier d'architecte consiste tout d'abord à créer un projet répondant au cahier des charges du client ». Pour cela, il faut passer par la partie d'étude : l'élaboration des plans, le choix des prestataires et l'estimation financière. Puis, après la validation de cette partie par le client, l'architecte coordonne toute la réalisation du projet.
Pour la conception du futur lycée, sept personnes ont travaillé sur la partie d'étude qui a duré environ un an et demi. Quant au chantier lui-même, il aura duré plus de deux ans, mobilisant 250 ouvriers. « Ce dernier a été fortement impacté par la crise de la Covid-19 et par le protocole sanitaire rigoureux imposé par l'Etat ».
Les travaux n'ont pas pu se dérouler normalement : distanciation sociale entre les ouvriers, désinfection régulière des salles de vie et restriction du nombre de personnes présentes sur le chantier au quotidien (seulement durant une période).
Les bâtiments ont été conçus dans le respect de l'environnement, avec la mise en place de panneaux photovoltaiques et l'utilisation d'isolants performants. Ainsi, les locaux ayant un faible besoin énergétique, leur consommation d'énergie sera moins élevée. L'architecte à fait le choix de faire appel à des entreprises locales ce qui réduit l'empreinte carbone de la main d'oeuvre.
« L'architecture du nouveau lycée a été pensée comme une "mini ville", avec la volonté de créer un lieu de rencontre et d'échanges ouvert sur l'extérieur ». En effet, on retrouve "la place du village", la zone centrale dans l'établissement qui permet de se rassembler et de circuler. Puis, il y a "les rues", qui sont les liaisons vers les lieux d'enseignement, les infrastructures et les espaces de vie.
Anthony Tesson : « espère que tous les élèves passeront de très bons moments dans le futur lycée, qu'il leur apportera un nouveau mode de vie agréable, malgré la nostalgie de leur ancien établissement ».
Eva BONNIN, terminale F et
Nhi BOUREL, terminale A.
Lycée et environnement
Le Pape François plaide pour une écologie intégrale. Comment, au lycée, répond-t-on aux idées de l'encyclique Laudato si' ?
Tout d'abord, qu'est-ce que l'écologie intégrale ? C'est un concept de l'écologie qui s'intéresse autant à l'environnement et l'économie qu'aux relations sociales.
En matière de relation avec l'autre, le lycée pratique déjà le tutorat, donne le coup de main à la Banque alimentaire et intervient pour l'aide aux devoirs dans les écoles primaires. Et de plus en plus d'actions sont mises en place, chaque année. Dans les salles de classe, les déchets sont triés dans des poubelles dédiées, depuis le début de l'année.
Et dans les cuisines
il se passe quoi ?
Pour comprendre encore mieux comment le lycée Saint-François-d'Assise oeuvre pour l'environnement, il faut aller dans les cuisines. Freddy Bret, cuisinier en chef du site Victor-Hugo, explique les actions qui sont menées au self : « Nous privilégions le local. Les fruits et légumes proviennent tous des alentours de La Roche. Les viandes viennent la plupart du temps des Pays de la Loire. Les fruits et légumes sont également de saison (purée de potimarons, choux) ».
Quant aux emballages, le tri est fait entre les plastiques, les boîtes de conserves, etc.
Lola HIBLOT, seconde D.

Covid et travailleuses de l’ombre
Valérie Maltaverne est employée par l’entreprise Elior et porte la responsabilté du ménage au sein du lycée depuis maintenant 14 ans. Son métier est d’assurer au quotidien la propreté du site Victor-Hugo, des labos ainsi que de la salle de la Fiajec.
Avec la crise de la Covid-19, le travail du personnel de nettoyage est quelque peu impacté. En effet, elle et ses deux collègues doivent suivre un protocole sanitaire très strict qui comprend la désinfection de l’ensemble des locaux, dont les poignées de portes, les rampes, le sol… et ce, tous les jours.
Valérie Maltaverne a vu son temps de travail augmenter à raison d'une heure par jour. Cela reste toujours compliqué, pour elle, d'accomplir l’ensemble de ses tâches quotidiennes tout en appliquant les consignes sanitaires.
Malgré cela et le port du masque incommodant, Valérie Maltaverne reste positive et aime toujours autant prendre soin du lycée. Elle participe à la qualité des conditions de travail des jeunes et améliore leur cadre de vie tout en protégeant la santé de tous.
Nous la remercions pour tout le travail accompli, en espérant la retrouver dans le futur établissement.
Eva BONNIN, terminale F.
Aux plus petits de Roumanie
« Notre engagement est fondé sur des valeurs chrétiennes de partage et d'entraide. Leur respect nous est primordial, au delà des croyances religieuses de chacun », explique Paul Laurent, élève à Saint-François-d'Assise, membre de l'association "Aux plus petits", depuis un an.
L'association "Aux plus petits" a été créée par Mathilde de Chesnard Sorbay en collaboration avec l'Institut catholique d'études supérieures (ICES), suite à un voyage en Roumanie, où elle a rencontré les enfants d'un bidonville. Le but est d'apporter un peu de joie dans la vie d'enfants défavorisés, notamment en leur offrant la possibilité de partir dans un camp d'été hors de leur cadre de vie. Tout cela se fait avec l'aide de religieuses orthodoxes, présentes sur place, et qui veillent toute l'année auprès des plus pauvres.
« Pour récolter les fonds nécessaires au financement de nos projets, nous avons participé au concours Kerialis. Nous avons fait appel à des dons et nous avons également démarché quelques entreprises. Cette année, nous essayons aussi de collecter des produits utiles à la vie quotidienne auprès de commerçants pour pouvoir les donner lors de nos futurs voyages ».
« Accompagner les enfants défavorisés me tient à coeur, poursuit Paul Laurent, parce qu'ils ont besoin de notre soutien, de notre aide et de nos conseils pour grandir et vivre dans de meilleures conditions. Partager un camps de vacances avec ces enfants leur permettrait de retrouver le confort et l'insouciance qu'ils n'ont jamais eu la chance de connaître ».
Nhi BOUREL, terminale A.
Tous masqués au lycée
Depuis la rentrée, le masque est obligatoire en cours. Certains masques sont plus originaux que d'autres.
Anja Gereke vient régulièrement au lycée avec des masques ornés de licornes, animaux imaginaires qu'elle adore, ou bien avec des masques marrants. Ce sont des masques allemands portés par une professeur d'allemand... Elle a fait ce choix, car elle adore les licornes. Mais, derrière, elle a une idée : « S'il n'y a qu'un seul sens à ne jamais perdre, ce serait le sens de l'autodérision ». Une invitation à garder le sens de l'humour.
Des masques signés Julie
Si vous cherchez des masques originaux à acheter, vous pouvez compter sur Julie Rouelle, élève de terminale I, qui a décidé de créer ses propres masques afin de les ajouter à sa collection de vêtements Jellyfishsmooth. Son projet est de proposer à tous ceux qui voudront en acheter des packs de 5 masques. Ces derniers seront réalisés à base de tissu recyclé ou bien de coton organique.
Concernant le design, Julie voudrait y inscrire la première lettre du jour de la semaine à savoir « L, M, Me, J, V » ainsi qu’une méduse symbolisant l’emblème de sa marque. D’après elle, « il est important de réduire l’utilisation des masques jetables, car ils polluent énormément ». Elle ajoute : « comme beaucoup de personnes, je suis très inquiète pour notre planète ! »
Si vous êtes intéressés pour acheter ces masques écologiques ou pour de plus amples précisions, n’hésitez pas à la contacter par mail (Jellyfishsmooth@gmail.com) ou bien sur son instagram (@smooth_jellyfish).
Bien que les masques se retrouvent stylisés, ça reste un outil de protection sanitaire, il est donc important de bien le porter... sur le nez.
Andréa LALONNIER, terminale C et Louis MIMEAU--CHESNEAU, seconde H.
En bus et à vélo
Tous les jours, quelques centaines d'élèves de Saint-François-d'Assise viennent au lycée. Tout le monde n'a pas le même temps de trajet et pas le même moyen de transport.
15 à 45 minutes en bus
Comme beaucoup, Jarod, élève de seconde, vient au lycée en bus. Tous les matins, il lui faut 15 minutes.. Le soir, après deux minutes, de marche pour aller place Napoléon, puis 5 minutes d'attente, il est temps de reprendre le bus pour rentrer chez lui. « Les lignes de bus sont souvent pleines. Et certains chauffeurs peuvent être désagréables », fait-il remarquer.
D'autres élèves habitant plus loin mettent jusqu'à 30 voire 45 minutes pour venir au lycée.
Pour plus de rapidité
Ce n'est pas le cas de Mélissandre, élève de seconde A, qui vient au lycée à vélo. Elle met, le matin, environ 15 minutes. Un temps de trajet qui va fortement diminuer avec le changement d'établissement. Elle a fait le choix de venir en vélo pour plus de rapidité. Elle raconte que malheureusement pas mal d'automobilistes font peu attention aux cyclistes.
Louis MIMEAU--CHESNEAU, seconde H.
Et avec le nouveau lycée...
Comment les élèves se déplacent-ils ? Et demain avec le changement de site ? Rencontre avec Jean-Marc Enfrein, responsable de la vie scolaire.
Comment les élèves viennent-ils au lycée ?
La plupart des élèves viennent par les transports en commun, les autres élèves sont déposés devant le lycée ou viennent à vélo ou en deux roues motorisés.
Et quelles seront les différences avec le nouveau lycée ?
Pour le transport vers le nouveau lycée, deux lignes de bus seront mises en place reliant la place Napoléon ( La Roche-sur-Yon étant organisé de façon à ce que toutes les lignes de bus aient leur terminus place Napoléon) et le nouveau lycée. De plus, une ligne directe avec Le Poiré-sur-Vie est prévue.
Tous ces aménagements ont nécessité beaucoup de travail pour mettre en place les différentes lignes et les synchroniser. Cela fera arriver les premiers élèves vers 7 h 30. Ensuite, le lycée compte sur les nombreuses pistes cyclables reliant La Roche-sur-Yon, Coëx, Aizenay ou encore Le Poiré-Sur-Vie. Avec ces pistes cyclables, verra-t-on plus d'élèves venir au lycée en deux roues ?
Dylan PELLOQUIN et Tom LEGEAI, seconde A.
Un prof engagé dans la pratique du vélo
Le vélo est une pratique régulière pour Jean-Marie Chauvière qui, depuis maintenant quatre ans, se rend tous les jours au lycée à vélo, quelle que soit la saison.
Jean-Marie Chauvière, prof de français, fait partie de l’association « Centre Vélo » : « L’association, qui a déjà plus de 200 adhérents, compte sur ses bénévoles pour repérer les endroits où un aménagement serait nécessaire et le fait remonter aux équipes techniques de la ville. Les pistes Covid (marquées en jaune) sont en place grâce au Centre Vélo. Cette association essaie d’être très influente sur le développement du vélo dans la ville et dans l’agglomération. C’est un travail de long terme ».
« Les voitures saturent l'espace public »
Qu’est-ce qui vous incite à venir au lycée à vélo ?
Premièrement, c’est par pur plaisir, car j’aime être dehors. Lorsque je sors à 7 h 40 de chez moi, je respire, il fait frais et je trouve ça plus agréable que d’être dans ma voiture. Ensuite, c’est par souci écologique. J’observe de nombreuses voitures où les conducteurs sont seuls. Je trouve ça effrayant. Les voitures saturent l’espace public. L’idée, c’est de faire en sorte que les choses changent. Dernièrement, c’est par souci pratique : je vais plus vite que les voitures, surtout lorsque la circulation est dense.
L' agglomération yonnaise favorise-t-elle l'usage du vélo ?
Il y a de vrais progrès, c’est incontestable, mais il reste encore du travail. Il y a beaucoup d’endroits où c’est incohérent, et d’autres où il n’y a aucune piste. Mais, il n’y a pas que ça, les aménagements facilitateurs pour accrocher son vélo manquent parfois dans le centre-ville.
« De nombreux accès au futur lycée »
Est-ce que l’emplacement du nouveau lycée va changer vos habitudes ?
Non, car le lycée dispose de nombreux accès, la rue Monge par exemple où une piste cyclable a été mise en place et où la circulation y est très facile. La distance reste la même que lorsque je me rends sur le site Pierre Brossolette. Je reviendrai chez moi par Rivoli, un quartier lui aussi doté de nombreux aménagements favorisant l’usage du vélo. J’ai d’ailleurs hâte de pouvoir utiliser les emplacements vélos couverts prévus dans le prochain lycée. Ça ne changera rien du tout à mes habitudes, au contraire !
Victor LE MAUFF, première A.
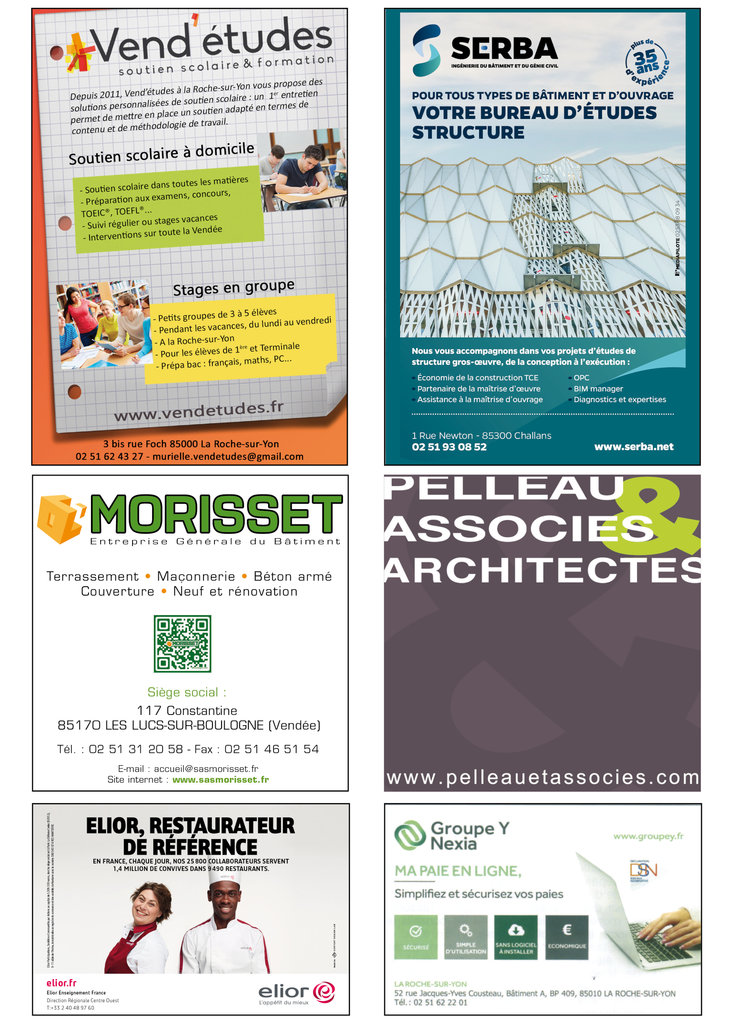
Un partenariat basket avec l'Etoile rouge
Comment présenter cette rentrée au lycée Saint-François-d'Assise sans évoquer le partenariat avec le club serbe de l'Etoile rouge de Belgrade.
L’une des nouveautés, cette année, à Saint-François est l’Académie de basket en partenariat avec le club de l’Etoile rouge de Belgrade. Il s'agit, en effet, d'une première en France ! Riwan Armani, fondateur de ce partenariat et principal entraîneur et éducateur des joueurs, nous dit tout.
D’où cette idée vient-elle ?
L’idée de cette Academy est née lors de ma première saison à l’Étoile Rouge de Belgrade, en Serbie il y a 2 ans. En concertation avec les dirigeants du club, nous avons souhaité ouvrir une structure de ce type en France après en avoir lancé d’autres ailleurs (Amérique du Sud, Chine, Espagne…)
Etes-vous satisfait de la performance de vos joueurs ?
Sans exception, ils ont tous progressé ! Physiquement déjà, ce ne sont plus les mêmes. Ils ont une capacité à mettre de l’intensité qui est clairement différente par rapport au début. Techniquement, je les sens plus à l’aise : mon niveau d’exigence a dû augmenter.
Concernant les différences, oui il y en a, et c’est normal. Nous n’avons pas le même vécu, les mêmes ambitions, le même potentiel même… Mais, c’est bien ça l’objectif, s’entraîner, jouer, vivre ensemble malgré ces différences. Des différences auxquelles on ne porte même pas attention au final dès lors que le respect et la tolérance sont intégrées à notre cadre de fonctionnement.
Comment gérez vous la situation actuelle avec cette pandémie ?
Aujourd’hui, l’Academy est à l’arrêt. On s’organise en proposant des entraînements en direct sur nos réseaux sociaux tous les soirs de la semaine entre 18 h 30 et 19 h 15. On garde contact avec les académiciens par message, ou en visio pour continuer à travailler sur nos projets extra-sportifs. Maintenant, en tant que structure rattachée à un établissement scolaire, on espère pouvoir reprendre rapidement en respectant un protocole strict qui ne nous permettra pas de nous entraîner normalement (sans contact, ni opposition, etc...)
D'après le coach, les ressentis, après ces deux mois, sont très encourageants. En témoigne un groupe qui a pris ses marques et qui est à l'écoute. Concernant les événements, il est à craindre qu'ils soient potentiellement annulés en raison de la pandémie.
Dylan PELLOQUIN, seconde A et Evan ORSONNEAU, seconde C.
Ils ont participé à l'Ironman des Sables
Le dimanche 6 septembre, Lionel Berland, Bertrand Potier et Sean Morris ont participé à leur premier triathlon aux Sables-d'Olonne. Ils nous racontent leur course.
Pourquoi avoir décidé de
faire cette course ?
Sean Morris (pompier volontaire et professeur d'anglais) voulait nager dans le chenal des Sables-d'Olonne. Il n’y avait qu’une solution, faire l'Ironman. Il lui fallait, donc, construire une équipe. Lionel Berland, prof d'EPS, qui est cycliste, était partant également, mais il manquait un coureur. On a alors demandé à Bertrand Potier, directeur du lycée, qui a accepté la proposition. L'inscription s'est faite en juillet 2019 pour courir début juillet 2020, mais la course a été décalée à septembre.
Quel a été le parcours
exact ?
Le départ pour les nageurs était fixé à 7 h du matin. Il fallait, donc, que Sean Morris fasse 3,9 km en mer. Il passait dans le chenal puis à port Olona pour faire la transition avec le vélo. Ensuite, c’était au tour de Lionel Berland d'effectuer les 90 km à vélo. Je suis passé par Saint-Julien-des-Landes, Nieul-le-Dolent, puis il lui fallait revenir aux Sables pour enchaîner avec le semi marathon, c’est à dire 21,2 km autour des Sables pour Bertrand Potier.
Êtes vous contents de vos résultats ?
Globalement, notre objectif est atteint. On a fait une performance honorable. Il y avait des équipes professionnelles avec des Espagnols, des Anglais. Nous sommes arrivés 21 èmes en 5 heures 36 minutes, sachant que les premiers ont mis pratiquement deux heures de moins.
Avez-vous eu un temps de préparation ?
Nous pratiquions déjà notre activité sportive fréquemment. Donc, nous avons juste fait notre préparation sur notre distance durant juin, juillet et août mais le fait de le faire en équipe et de le faire à un niveau plus élevé nous a obligés à bien nous entraîner.
Lilian MORVAN et
Antonin DUPONT, terminale E.
Religieuse et enseignante
Soeur Hélène est une ancienne de Saint-Jo, où elle a été religieuse et enseignante.
Quand avez-vous commencé à enseigner à Saint-Jo ?
J'ai commencé à enseigner à l'âge de 19 ans, en 1952. C'était mon premier poste de professeur.
Qu'avez-vous enseigné ?
Étant la plus jeune de l'équipe, j'ai enseigné les matières dans lesquelles il manquait des professeurs. J'ai, donc, été à la fois prof de maths, de sciences et d'histoire-géo. Je n'aimais pas l'histoire mais, paradoxalement, après avoir revu des élèves, celles-ci m'ont dit que c'était les cours qu'elles préféraient avec moi !
Combien de temps êtes-vous restée à Saint-Jo ?
Mon parcours à Saint-Jo s'est fait en deux parties. Premièrement, de 1952 à 1969, j'ai enseigné et surveillé l'internat avant de continuer ma carrière ailleurs en France. Je suis, toutefois, revenue à la Roche en 1978, en tant que responsable de l'internat et des animations jusqu'en 1993, où j'ai pris ma retraite.
Quels sont vos meilleurs souvenirs de cette époque ?
Oh, j'en ai tellement ! J'ai particulièrement aimé les voyages scolaires. Nous avons fait des choses que l'on aurait jamais pu faire autrement . Je me souviens aussi de la chance que j'aie eue d'être entourée d'une équipe pédagogique chaleureuse, avec laquelle j'ai passé de bons moments. Je me sens gâtée par la vie et je suis heureuse de ce que j'ai fait durant celle-ci.
Léonie BOISSELEAU,
terminale C.
Gabriel, joueur d'e-sport
Gabriel Jeanne, en classe de seconde A, est un joueur d'e-sport sur "Hearthstone".
Tout d'abord qu'est ce que "Hearthstone" ? Hearthstone est un jeu de cartes en ligne developpé par Blizzard, qui consiste grâce à des cartes à réduire les points de vie de son adversaire (trente points de vie max). De plus, chaque carte possède des points de vie et d'attaque ainsi que des effets propres. Les cartes ont besoin de "manas" pour être utilisées (plus une carte est forte plus elle demande de "manas"). Des "manas" que l'on récupère à chaque début de tour. Le jeu, complexe, est stratégique.
Gabriel Jeanne joue à Hearthstone depuis six ans et il a commencé à faire des compétitions il y a deux ans. Il a pu accéder à ces compétitions grâce à ce qu'il appelle le "ladder". Le "ladder" est un système de classement défini par le jeu selon le nombre de victoires ou de défaites comptabilisées par un joueur.
Gabriel s'est donc placé premier d'Europe avec le "ladder". Cela lui a permis de se qualifier dans plusieurs grands tournois comme, le "master tour online" (grand tournoi international en ligne) où il a fini quatrième. Ces tournois lui ont permis de voyager dans beaucoup de pays comme aux États-Unis, par exemple au Texas. Virtuellement en tout cas.
Tom LEGEAIS, seconde A.
Sacha, transgenre, en quête de soi
Depuis tout petit, Sacha se sent différent. En troisième, il met enfin des mots sur son mal-être : il n'est pas né dans le bon corps, il est transgenre.
Qu'est ce que la transidentité ?
La transidentité, c’est être né dans le mauvais corps. C’est le fait pour un homme d’être né dans un corps de femme, ou pour une femme d’être née dans un corps d’homme.
« Je m'habillais
de manière masculine »
Quand as-tu commencé à ressentir du mal-être ?
A vrai dire, je n’ai jamais été très concordant avec mon genre surtout depuis le primaire. En effet, quand on me demandait ce que je voulais être plus tard, je répondais « un garçon » (rire).
J’ai toujours été labellisé comme tel. Je traînais avec des garçons et m'habillais sans cesse de manière « masculine ».
Quand as-tu réussi à mettre des mots dessus ?
En troisième, j'ai rencontré une personne transgenre, et à la vue de son parcours, je m'y retrouvais.
A partir de ce moment-là, j'ai compris qu'être un garçon me rendait bien plus à l'aise qu'être une fille.
« J'avais besoin de
me sentir moi-même »
Pourquoi as-tu voulu changer de genre ?
La seule et unique raison pour laquelle j'ai voulu changer de genre, c'est parce que j'avais besoin de me sentir moi-même.
Comment ta famille a-t-elle réagi quand tu lui as appris ?
Aucun membre de ma famille n'a été surpris d'apprendre ma transidentité, car j'ai toujours « semé des indices » durant mon enfance. Ils ont peut-être été un petit peu surpris, mais c’est légitime.
Certains parents disent qu’ils « perdent » leur enfant ; mais ce n'est pas vrai. Cet enfant reste le même, il est seulement plus épanoui.
« Très peu de remarques transphobes »
Quelle a été la réaction de tes camarades ?
En ce qui me concerne, je n'ai reçu que très peu de remarques transphobes.
En seconde, je me suis peut être fait légèrement remarquer ou moquer. En revanche, je suis passé au-dessus et je me suis entouré de personnes compréhensives.
J'ai même rencontré beaucoup d'écoute non seulement de la part du lycée, des professeurs, de mes amis, mais aussi du service public ou encore d'inconnus dans la rue et sur les réseaux sociaux.
« Les gens osent enfin
en parler »
D’après toi, est-ce que les mentalités évoluent ?
Bien sûr ! Surtout qu'aujourd'hui, la parole est bien plus libre et les gens osent enfin en parler
Ainsi, la transidentité devient de plus en plus médiatisée et dédramatisée. Seulement, ce n'est possible que si les personnes sont ouvertes aux changements et aux différences.
C'est, donc, à force d’en parler et d'agir qu'on arrivera à faire changer ne serait-ce qu’un petit peu l’opinion publique !
Léonie BOISSELEAU et Andréa LALONNIER, terminale C.
Louise est Jeune sapeur pompier
Des élèves de Saint-François-d'Assise sont aussi des jeunes engagés. Ainsi Louise Deruyter, élève de seconde, qui suit une formation de Jeune sapeur pompier. Entretien.
Depuis quand t'es-tu engagée comme Jeune sapeur pompier ?
Je suis Jeune sapeur pompier depuis 2 ans. J'ai donc commencé en quatrième, à Grenoble. J'ai découvert l'existence de ce parcours à un forum des associations. En Vendée, on peut commencer à partir de 14 ans. Les places sont limitées, j'ai donc passé le test de rentrée. C'est un test sportif pour déterminer qui fera partie des Jeunes sapeurs pompiers.
En quoi consiste cette formation ?
La formation de JSP est une activité durant laquelle on apprend à secourir une personne en danger et à protéger les autres. Pour ma part, elle se déroule le samedi matin, dans la caserne des sapeurs pompiers de Moutiers-les-Mauxfaits (la plus proche de chez moi). On peut l'effectuer dans la plupart des casernes. Elle se déroule sur quatre années scolaires.
Comment se déroule-t-elle ?
Cette formation se déroule en deux parties, une partie théorique, et une partie pratique, souvent en extérieur. On y apprend les différentes techniques contre les incendies, les gestes de premiers secours, l’entretien du matériel (lances, véhicules,...). On y apprend aussi différents sports, le dépassement de soi, l’esprit d'équipe.
Qu'est ce que cette formation va t'apporter ?
A la fin de ce parcours j'obtiendrai mon brevet de Jeune sapeur pompier. Celui-ci me permettra d'être pompier volontaire sur mon temps personnel à mes 18 ans.
Entraide, respect et confiance
Pourquoi t'es-tu engagée en tant que Jeune sapeur pompier ?
Je suis JSP pour pouvoir être pompier bénévole à mes 18 ans. Pour ma part, je ne souhaite pas devenir pompier professionnel. Mais, j’avais envie de découvrir ce métier et de pouvoir être en capacité d’aider les autres.
Dans cette formation qu'est ce qui te plaît le plus ?
Ce que je préfère, c'est l'entraide entre les JSP et le respect qu'il y a entre nous. Peu importe le grade (nombre d'années). Ça nous permet de créer des liens importants entre nous, comme la confiance.
Héloïse HERAUD, seconde D.
Un professeur passionné par la généalogie
Julien Remaud, professeur d'histoire-géo, est à la recherche de ses ancêtres.
En quoi consiste la généalogie ?
La généalogie est une enquête durant laquelle on cherche à se renseigner sur ses ancêtres, leur nom, leur cadre de vie.
Chercher, stocker, classer, archiver
Comment procédez-vous ?
D'abord, on va à la recherche d'informations, qui se trouvent sur les actes de naissance dans les archives des Conseils départementaux, dans certaines mairies, chez des notaires, dans des presbytères (avant la Révolution française) et sur Internet. Il existe de nombreux sites sur la généalogie.
Ensuite, ces informations je les rentre dans un logiciel, qui me permet de les stocker, de les classer, et de les conserver. Car, au fur et à mesure, on se retrouve avec un grand nombre de données. Moi par exemple, j'ai recensé des informations sur plus de 2 500 personnes différentes.
Quels sont les différents aspects de la généalogie ?
La généalogie, en tant que loisir, va plus loin que la recherche de noms. On cherche à savoir qui sont ses ancêtres, ses cousins, à connaître qui, de sa famille,a fait la guerre, à connaître leurs métiers, leurs occupations, leur lieu de vie. Par exemple, grâce à ça, je sais qu'une grande partie de ma famille vit en Vendée, mais pas forcément dans la même ville. Retrouver des photos de famille est un complément.
Deux heures par jour
La généalogie est-elle une passion qui vous prend du temps ?
En semaine, cela m'est compliqué d'y consacrer beaucoup de temps, mais le week-end et pendant les vacances, deux heures facilement par jour.
Pourquoi la généalogie ?
Depuis que je suis petit, je suis un passionné d'histoire, et c'est l'histoire qui m'a amené à la généalogie. Je dois en faire depuis environ mes douze ans. J'aime beaucoup cette idée de remonter dans le temps. J'aime la généalogie dans son ensemble, la recherche, la joie de remonter toujours plus en arrière, l'aspect technique, et il y a cette envie de résoudre cette grande énigme, mes origines.
Aujourd'hui, je suis remonté jusqu'à la fin du XVIe siècle, et je connais environ 6 500 de mes ancêtres.
Héloïse HERAUD,
seconde D.

The roads not taken
The roads not taken est le nouveau film de Sally Potter. Ce long-métrage saisissant nous immisce dans une relation père-fille où les rôles s’inversent. Le présent se confond avec le passé dans la tête du père interprété par Javier Bardem, atteint de démence, qui au cours d’une journée avec sa fille, jouée par Elle Fanning, se perd dans les rues de New York, comme dans ses lointains souvenirs.
C’est un psychodrame bouleversant qui retrace la vie d’un homme, tout en proposant une réflexion pertinente sur la responsabilité des enfants à l’égard de leurs parents, ainsi que sur la représentation des maladies mentales au cinéma.
Sam BELBEOCH,
terminale B.
L'Odyssée d'Hakim
Hakim est un jeune Syrien propriétaire d'une pépinière. En 2011, la guerre éclate et Hakim se retrouve sur les chemins de l'exil. Hakim se lance avec son fils dans un voyage périlleux et dangereux à la recherche d'une vie meilleure. En trois tomes, le nouveau roman graphique de Fabien Toulmé raconte l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui sont prêts à tout quitter pour survivre.
Léonie BOISSELEAU,
terminale C.
Jeu : Tapestry
Tapestry est un jeu de société distribué par la société Matagot et sorti en 2019. On peut y jouer de 1 à 5 joueurs. L''objectif est de construire une civilisation en progressant sur des frises de développement permettant d'améliorer les civilisations. Ce jeu est très agréable en famille ou entre amis et contrairement au Monopoly ou autre Risk, ne crée pas de tension entre les joueurs puisque chacun progresse indépendamment des autres. Attention, par contre, les parties sont longues (environ 3-4 heures).
Léonie BOISSELEAU,
terminale C.
Appli : Radio Garden
Radio Garden est une application qui permet d'écouter par satellite toutes les radios du monde. France Inter, la BBC, ou encore les radios kazakhs ou congolaises, elles sont toutes gratuites et accessibles en direct. De plus, elles offrent un point de vue imprenable sur l'actualité internationale. Cette application peut aussi être connectée au Bluetooth pour pouvoir en profiter partout, même dans les zones blanches.
Léonie BOISSELEAU,
terminale C.
Le festival international du film
Du 12 au 18 Octobre, se tenait la 11e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon.
My Salinger Year
Parmi près de 80 films projetés se trouvait My Salinger Year, de Philippe Falardeau qui concourait dans la compétition internationale.
Basé sur une histoire vraie et adapté d'un roman du même nom, My Salinger Year nous plonge dans l’histoire d’une écrivaine en devenir, Joanna, campée par l’actrice Margaret Qualley.
Joanna quitte son université pour poursuivre ses rêves dans le New York intellectuel des années 90, propice à l’inspiration et au travail. Par volonté d’entrer dans le monde intimiste de la littérature, elle est embauchée dans une agence littéraire, dirigée de main de fer par une directrice aussi intransigeante que privée, interprétée par Sigourney Weaver.
Le mystérieux M. Salinger
Le film tourne principalement autour de la figure mystérieuse d’un célèbre auteur reclus, M.Salinger, toujours montré de dos, qui va intriguer Joanna et l'accompagner via des appels téléphoniques tout au long du film dans sa quête identitaire en tant que jeune écrivaine.
Dans un même temps, ce film, également adapté du livre du même nom de l’auteure Joanna Rakoff, va mettre en avant l’expérience et la réussite d’une jeune femme, tant dans le monde professionnel que sur le plan personnel.
Sam BELBEOCH, terminale B.
Chaîne Youtube : Le Vortex
Le Vortex est une émission web culturelle et de vulgarisation scientifique créée en 2019 sur une idée de Léo Grasset, de la chaîne DirtyBiology et de Ronan Letoqueux, de la chaîne RealMyop. Elle est diffusée sur Youtube depuis le 13 mars 2019 et en est à sa troisième saison. Elle réunit dans une co-location fictive des vidéastes scientifiques spécialisés dans des domaines aussi variés que l'histoire, le droit, la physique, la biologie ou la linguistique.
Une complémentarité
des informations
Le but de cette série est d'apporter une complémentarité des informations scientifiques, par la réunion des différents vulgarisateurs. En plus de cela, la qualité des informations est certifiée par des chercheurs du CNRS.
Donner le goût des sciences aux jeunes
Arte, la chaîne partenaire du projet, est ravie de diffuser cette série puisqu'elle est directement reliée à son ADN : transmettre du savoir scientifique. Le public visé par le Vortex est, bien sûr, les jeunes et les moyens utilisés pour les intéresser sont nombreux. L'humour, tout d'abord, mais aussi l'originalité des sujets. Ainsi, au bout de trois saisons, le Vortex aura traité, entre autres, les serial killers, la mythologie grecque, ou encore la publicité mensongère. En bref, une très bonne série pour apprendre des choses et, accessoirement, se faire entendre en société !
Léonie BOISSELEAU,
terminale C.