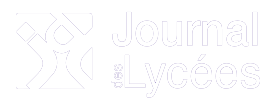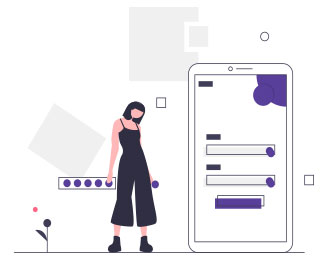Journal des Lycées > L'actualité des lycées
> Calvados > Lycée Alain Chartier > Les articles > Eliott Brachet, la passion dangereuse de journaliste de guerre
Eliott Brachet, la passion dangereuse de journaliste de guerre
Il a couvert les zones de conflit comme le Darfour ou la bande de Gaza, Eliott Brachet est reporter de guerre.
Journaliste indépendant pour Le Monde, il est venu à la rencontre des élèves de 2nde du lycée Alain Chartier dans le cadre du Prix Bayeux des correspondants de guerre. Il est venu présenter sa profession aux élèves de 2nde. Ils ont posé un grand nombre de questions, et ont appris beaucoup de choses sur cette profession et sur ses risques "Nous avons particulièrement apprécié sa sincérité et d’avoir pu découvrir la vie d'un journaliste de guerre" ont remercié les élèves impressionnés par l'échange. A l'issue de la rencontre, Eliott Brachet a lui aussi posé une question : « J’aimerais savoir comment vous faites pour vous tenir informés ? » Sans surprise, les lycéens ont répondu dans leur grande majorité : les réseaux sociaux, et, bien sûr, Tik Tok. Réponse qui interroge sa pratique actuelle de journaliste de presse écrite. Il se sait éloigné des plus jeunes lecteurs. Or il refuse de communiquer via TikTok, car pour lui la plateforme véhicule trop de fausses nouvelles, elle n’est pas digne de ses informations.
Une passion née au collège Eliott Brachet, né lors de l’année de la création du premier Prix Bayeux des reporters de guerre (en 1994), a dès le collège, découvert une passion pour le journalisme.
Il a commencé très jeune à se soucier du monde qui l'entourait en se documentant par exemple sur le Printemps arabe. Ce sujet inconnu pour lui a engendré une curiosité inarrêtable qui l'a poussé à se renseigner davantage. Au fur et à mesure, Eliott Brachet a tracé sa voie dans le journalisme jusqu'à l'obtention d'un master.
Aujourd’hui, journaliste indépendant, il travaille pour différents médias, et notamment Le Monde. Comme journaliste indépendant et reporter de guerre, il a choisi d’exercer son métier dans la capitale du Soudan, Khartoum.
Sa volonté : informer sur les atrocités de la guerre tout en restant, dans la mesure du possible, hors des zones de conflit direct. Quand la guerre civile éclate en 2023, après trois années passées dans le pays, il est évacué en France. Son désir d’informer reste intact, il choisit l’Egypte pays voisin du Soudan, pour continuer d’écrire sur les atrocités de la guerre au Darfour. La situation géographique de l'Egypte lui permet également de couvrir le conflit actuel israélo-palestinien.
Un danger permanent Journaliste indépendant, Eliott Brachet a la volonté de prendre connaissance par lui-même de certains événements. Montrer, dire ce qu’il voit au plus près de la réalité, celle du Dafour. Une fois sa mission terminée, et parce qu’il n'a pas eu le temps d’anticiper son retour, les événements étant très imprévisibles en temps de guerre, quitter le pays s’avère compliqué. Pris de court, il peut alors faire appel à des passeurs pour son exfiltration. Mais les passeurs peuvent demander des sommes exorbitantes, "2000 à 5000 euros" comme cela a pu être le cas à Gaza. Il ne peut concevoir de rester là à attendre un renfort durement négocié, au risque de sa vie. Il lui faut sortir au plus vite de cette impasse. Livré à lui-même, il prend une option encore plus risquée : traverser les lignes de tirs pour se réfugier dans une zone sans danger. Elliot Brachet est sain et sauf. Trois jours plus tard, “d’autres se sont faits cribler de balles”, se remémore t-il, la voix encore empreinte d’émotion. Il a bien conscience d’avoir échappé de peu à la mort.
Prendre des risques avec raison En reprenant ses termes, le "risque zéro" n’existe pas, mais il faut savoir évaluer le risque et la qualité de l’information recueillie. Il ne s’agit pas pour Eliott Brachet de prendre des risques inconsidérés. Le travail sur le terrain est préparé à l’avance avec des fixeurs. Un fixeur est une personne locale qui renseigne le pigiste sur les événements et sur l’environnement. Il sécurise dans la mesure du possible, les zones où le journaliste va intervenir. Le contact avec les populations locales est indispensable pour faire le métier correctement. C’est d’ailleurs une des choses qui le pousse à continuer dans ce métier, il aime le contact humain. Des hommes et des femmes qui vont lui raconter “leur” histoire, “leur” vérité qu’elles soient justes ou pas. Le journaliste à force d’écoute, et d’expériences, sera plus à même de comprendre les caractères humains, et déceler la réalité des faits.
Un métier difficile financièrement "C’est un beau métier ; on voyage dans beaucoup de pays, on se fait des amis aux quatre coins du monde", s’enthousiasme Eliott Brachet qui reconnaît que "l’adrénaline du risque” (avec modération) est aussi une des facettes du métier qu’il apprécie.
Journaliste indépendant comme son nom l’indique, n’est pas salarié mensuel d’un journal, il est payé à l’article parfois commandé, parfois proposé sans être commandé.
Cela signifie des revenus qui fluctuent et des dépenses sur le terrain, souvent assumées par le journaliste lui-même. Frais d’hébergement, voyage, mais aussi frais hospitaliers ou de soins (la sécurité sociale n’existe pas dans tous les pays) sont souvent à la charge du journaliste indépendant. Une précarité synonyme également de salaire peu élevé en comparaison des risques encourus. “Entre 2 000 et 3 000 euros pour aller risquer sa vie”, explique Eliott Brachet. Outre le salaire, c’est le rythme de travail qui lui aussi laisse peu de place à la vie personnelle "Les périodes de travail suivent naturellement l'importance des évènements. On peut être amené à ne rien faire un jour ou deux, puis faire une nuit blanche pour 3 jours de travail ou plus, presque non-stop".
Sur place, là encore, souvent isolé, le journaliste indépendant, n’a pas de contacts préalablement établis par la direction d'un journal.
Il doit faire face, seul, aux différents évènements. Quand le journaliste est envoyé par un journal, celui-ci prendra en charge son rapatriement si nécessaire, mettra tout en œuvre dans la mesure de ses possibilités, pour l’aider à se sortir d’un mauvais pas.
Ce n'est pas le cas du journaliste indépendant. Au mieux, ce dernier a un contact téléphonique au quotidien pour faire le point sur l’avancée de son travail et quand il lui sera possible de livrer l’article.
Au plus près de la vérité Mais alors, pourquoi devenir journaliste de guerre ?
Eliott Brachet justifie son choix par le devoir de vérité sur les événements et la vie des habitants. « Même à travers la guerre, le quotidien des gens doit être connu ».
Témoigner le plus honnêtement possible de ce que vivent les gens pour alerter l’opinion publique sur la réalité de la guerre, de la misère. Informer sur : comment l’homme vit dans ce monde pour aider à la prise de conscience de chacun de nous ? Pour un monde qui puisse réagir, pour un monde qui puisse se parfaire et même si cela peut souvent paraître utopique et toujours frustrant comme le dit parfaitement Eliott Brachet.
« Je partage les informations aussi bien que je le peux, pourtant rien ne change, c’est comme si je servais à rien. Mais en même temps, si je ne le fais pas, qui le fera ? […] C’est cela qui me motive, permettre aux gens de savoir ce qui se passe et de réagir […] Toutes ces guerres qui se passent en Ukraine, à Gaza, et au Soudan sont absurdes […] Tout cela est déprimant, on est tous dans le même camp […] Les qualités humaines sont partout ».
Edouard CRETU
Journaliste indépendant pour Le Monde, il est venu à la rencontre des élèves de 2nde du lycée Alain Chartier dans le cadre du Prix Bayeux des correspondants de guerre. Il est venu présenter sa profession aux élèves de 2nde. Ils ont posé un grand nombre de questions, et ont appris beaucoup de choses sur cette profession et sur ses risques "Nous avons particulièrement apprécié sa sincérité et d’avoir pu découvrir la vie d'un journaliste de guerre" ont remercié les élèves impressionnés par l'échange. A l'issue de la rencontre, Eliott Brachet a lui aussi posé une question : « J’aimerais savoir comment vous faites pour vous tenir informés ? » Sans surprise, les lycéens ont répondu dans leur grande majorité : les réseaux sociaux, et, bien sûr, Tik Tok. Réponse qui interroge sa pratique actuelle de journaliste de presse écrite. Il se sait éloigné des plus jeunes lecteurs. Or il refuse de communiquer via TikTok, car pour lui la plateforme véhicule trop de fausses nouvelles, elle n’est pas digne de ses informations.
Une passion née au collège Eliott Brachet, né lors de l’année de la création du premier Prix Bayeux des reporters de guerre (en 1994), a dès le collège, découvert une passion pour le journalisme.
Il a commencé très jeune à se soucier du monde qui l'entourait en se documentant par exemple sur le Printemps arabe. Ce sujet inconnu pour lui a engendré une curiosité inarrêtable qui l'a poussé à se renseigner davantage. Au fur et à mesure, Eliott Brachet a tracé sa voie dans le journalisme jusqu'à l'obtention d'un master.
Aujourd’hui, journaliste indépendant, il travaille pour différents médias, et notamment Le Monde. Comme journaliste indépendant et reporter de guerre, il a choisi d’exercer son métier dans la capitale du Soudan, Khartoum.
Sa volonté : informer sur les atrocités de la guerre tout en restant, dans la mesure du possible, hors des zones de conflit direct. Quand la guerre civile éclate en 2023, après trois années passées dans le pays, il est évacué en France. Son désir d’informer reste intact, il choisit l’Egypte pays voisin du Soudan, pour continuer d’écrire sur les atrocités de la guerre au Darfour. La situation géographique de l'Egypte lui permet également de couvrir le conflit actuel israélo-palestinien.
Un danger permanent Journaliste indépendant, Eliott Brachet a la volonté de prendre connaissance par lui-même de certains événements. Montrer, dire ce qu’il voit au plus près de la réalité, celle du Dafour. Une fois sa mission terminée, et parce qu’il n'a pas eu le temps d’anticiper son retour, les événements étant très imprévisibles en temps de guerre, quitter le pays s’avère compliqué. Pris de court, il peut alors faire appel à des passeurs pour son exfiltration. Mais les passeurs peuvent demander des sommes exorbitantes, "2000 à 5000 euros" comme cela a pu être le cas à Gaza. Il ne peut concevoir de rester là à attendre un renfort durement négocié, au risque de sa vie. Il lui faut sortir au plus vite de cette impasse. Livré à lui-même, il prend une option encore plus risquée : traverser les lignes de tirs pour se réfugier dans une zone sans danger. Elliot Brachet est sain et sauf. Trois jours plus tard, “d’autres se sont faits cribler de balles”, se remémore t-il, la voix encore empreinte d’émotion. Il a bien conscience d’avoir échappé de peu à la mort.
Prendre des risques avec raison En reprenant ses termes, le "risque zéro" n’existe pas, mais il faut savoir évaluer le risque et la qualité de l’information recueillie. Il ne s’agit pas pour Eliott Brachet de prendre des risques inconsidérés. Le travail sur le terrain est préparé à l’avance avec des fixeurs. Un fixeur est une personne locale qui renseigne le pigiste sur les événements et sur l’environnement. Il sécurise dans la mesure du possible, les zones où le journaliste va intervenir. Le contact avec les populations locales est indispensable pour faire le métier correctement. C’est d’ailleurs une des choses qui le pousse à continuer dans ce métier, il aime le contact humain. Des hommes et des femmes qui vont lui raconter “leur” histoire, “leur” vérité qu’elles soient justes ou pas. Le journaliste à force d’écoute, et d’expériences, sera plus à même de comprendre les caractères humains, et déceler la réalité des faits.
Un métier difficile financièrement "C’est un beau métier ; on voyage dans beaucoup de pays, on se fait des amis aux quatre coins du monde", s’enthousiasme Eliott Brachet qui reconnaît que "l’adrénaline du risque” (avec modération) est aussi une des facettes du métier qu’il apprécie.
Journaliste indépendant comme son nom l’indique, n’est pas salarié mensuel d’un journal, il est payé à l’article parfois commandé, parfois proposé sans être commandé.
Cela signifie des revenus qui fluctuent et des dépenses sur le terrain, souvent assumées par le journaliste lui-même. Frais d’hébergement, voyage, mais aussi frais hospitaliers ou de soins (la sécurité sociale n’existe pas dans tous les pays) sont souvent à la charge du journaliste indépendant. Une précarité synonyme également de salaire peu élevé en comparaison des risques encourus. “Entre 2 000 et 3 000 euros pour aller risquer sa vie”, explique Eliott Brachet. Outre le salaire, c’est le rythme de travail qui lui aussi laisse peu de place à la vie personnelle "Les périodes de travail suivent naturellement l'importance des évènements. On peut être amené à ne rien faire un jour ou deux, puis faire une nuit blanche pour 3 jours de travail ou plus, presque non-stop".
Sur place, là encore, souvent isolé, le journaliste indépendant, n’a pas de contacts préalablement établis par la direction d'un journal.
Il doit faire face, seul, aux différents évènements. Quand le journaliste est envoyé par un journal, celui-ci prendra en charge son rapatriement si nécessaire, mettra tout en œuvre dans la mesure de ses possibilités, pour l’aider à se sortir d’un mauvais pas.
Ce n'est pas le cas du journaliste indépendant. Au mieux, ce dernier a un contact téléphonique au quotidien pour faire le point sur l’avancée de son travail et quand il lui sera possible de livrer l’article.
Au plus près de la vérité Mais alors, pourquoi devenir journaliste de guerre ?
Eliott Brachet justifie son choix par le devoir de vérité sur les événements et la vie des habitants. « Même à travers la guerre, le quotidien des gens doit être connu ».
Témoigner le plus honnêtement possible de ce que vivent les gens pour alerter l’opinion publique sur la réalité de la guerre, de la misère. Informer sur : comment l’homme vit dans ce monde pour aider à la prise de conscience de chacun de nous ? Pour un monde qui puisse réagir, pour un monde qui puisse se parfaire et même si cela peut souvent paraître utopique et toujours frustrant comme le dit parfaitement Eliott Brachet.
« Je partage les informations aussi bien que je le peux, pourtant rien ne change, c’est comme si je servais à rien. Mais en même temps, si je ne le fais pas, qui le fera ? […] C’est cela qui me motive, permettre aux gens de savoir ce qui se passe et de réagir […] Toutes ces guerres qui se passent en Ukraine, à Gaza, et au Soudan sont absurdes […] Tout cela est déprimant, on est tous dans le même camp […] Les qualités humaines sont partout ».
Edouard CRETU