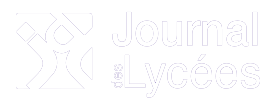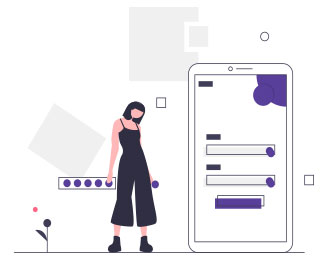Journal des Lycées > L'actualité des lycées
> Morbihan > Lycée Benjamin Franklin > Les articles >
Fin de la censure sur
Meta : origine et enjeux
Fin de la censure sur Meta : origine et enjeux
Début janvier, Mark Zuckerberg annonce publiquement qu’il met fin
au « fact-checking » sur la plateforme Meta aux
Etats-unis. Fin janvier, Donald Trump est investi à la Maison blanche.
Choix de business ou allégeance politique ?
« Fact-checking ? »
Si vous utilisez Instagram ou Facebook, vous savez sans doute que le contenu qui vous est proposé est modéré. Violence, contenu profane, sexisme, racisme… tout cela est filtré par Meta. Mais il existe derrière cela tout un corps de métiers, le « fact-checking » : ce sont des modérateurs, appartenant à des groupes externes à Meta, regroupés sous la bannière de l’IFCN, réseau international de modération des réseaux. Ceux-ci peuvent être des journalistes ou des chercheurs mais dans tous les cas, ce sont des professionnels non-partisans de Meta. Ainsi, le patron de Meta a décidé de rompre les liens avec cette organisation. Auparavant, lorsque du contenu provocateur, violent ou tout simplement faux était publié, une note était rajoutée par un modérateur, le certifiant de « faux », « hors-contexte », « satirique », ce qui permettait une prise de recul avec le contenu proposé. C'est donc vers un fonctionnement comme la plateforme X que se dirige Meta, c'est-à-dire une modération faite par des "community notes". Au lieu de s'appuyer sur des chercheurs indépendants, la plateforme s'appuie uniquement sur ses utilisateurs, qui rédigent des "notes de contexte", et les autres, qui votent. C'est donc la "note de contexte" ayant le plus de votes qui a le dernier mot, qu'importe le contexte. Désormais, Meta affirme : c’est vous, le modérateur.
Pourquoi ? Des vérificateurs « trop orientés politiquement », une « institutionnalisation de la censure », la vidéo publiée par Zuckerberg le 7 janvier crie Trump. D'abord, le plus évident : délocalisation des locaux de Meta au Texas, terre très républicaine, la mention explicite des thèmes taclés par Trump (immigration, genre), mention du "biais politique" des journalistes... Autrement, le créateur de Facebook évoque « un retour aux sources » et la vision simpliste de prioriser à tout prix le contenu et la parole au détriment des dangers des réseaux sociaux (simplement euphémisé en « the bad stuff ») s’aligne parfaitement sur la politique du nouveau président. Politiquement, c'est aussi un choix qui s'aligne sur le programme trumpiste. Zuckerberg, comme Trump, considère les journalistes comme des "idéologues, [ce qui relève de la] rhétorique de l'extrême-droite" (Anne Cordier, chercheuse à l'université de la Lorraine, le Télégramme). Cette idéologie présente les journalistes et les mouvements intellectuels comme un seul et unique organe de gauche, donc lorsque le patron de Meta affirme que le problème des réseaux sociaux est "l'institutionalisation de la censure" (donc sous le démocrate Biden), c'est bien à Trump qu'il prête allégeance. La devise de cette révision de politique « more speech, fewer mistakes », autrement dit : plus de parole, moins de fautes, paraît trompeuse, et la « faute » rejetée non pas sur le mauvais usage de la plateforme par les internautes, mais plutôt sur les acteurs tiers régulant le contenu potentiellement nocif. Utilisant une sorte de faux dilemme, Zuckerberg souligne les erreurs dans le filtrage, et au lieu de régler ces filtres, les supprime complètement, laissant un espace complètement à la merci des informations délibérément fausses et de la manipulation.
Quelles réactions ? Derrière ce choix politique se cachent de véritables conséquences, hors du monde virtuel. Hormis bien sur le mécontentement des modérateurs payés par Meta, ce choix provoque de véritables questionnements moraux. Cette volonté de mettre la régulation des réseaux aux mains des utilisateurs n’est autre qu’une déresponsabilisation des grandes entreprises de la tech, bras droit de la campagne de Trump. Une stratégie qui “leur épargne les coûts financiers et politiques associés à ces tâches” (Courrier International). Tout cela est d’autant plus inquiétant puisque les réseaux de Zuckerberg ont déjà un antécédent judiciaire. Nous pouvons citer par exemple le scandale de Cambridge Analytica ayant débuté en 2014 : les données de 87 millions d’utilisateurs ont fuité de la société d’analyse anglaise et ont servi de point d’appui pour la campagne de Trump, utilisés pour convaincre les voteurs indécis. Sinon en 2024, il s’était excusé devant la cour de justice étasunienne, humilié, dans un procès concernant le contenu abusif sur Instagram et les conséquences mortelles des réseaux sociaux. Avec des risques pareils, comment ne pas se questionner sur la légitimité d’un réseau modéré par ses utilisateurs ?
Sommes-nous concernés ? L’Europe n’est pas encore concernée par cette politique et possède les cartes à jouer pour ne pas l’être à l’avenir. Le Digital Services Act (DSA), règlement sur le numérique proposé par l’UE en 2023, empêche la plateforme étasunienne d’acter sa politique dans l’UE. Ce règlement devrait « préserver le respect des droits fondamentaux garantis par Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » et « agir contre les contenus pouvant avoir des effets négatifs réels ou prévisibles sur la sécurité publique et les processus démocratiques et électoraux”. Donc les réseaux, bien qu’imprévisibles, agiront dans la limite de la loi européenne. Avant tout, les réseaux sont certes des espaces de société, où est mise en avant la parole. Mais à trop vouloir mettre en avant la liberté d’expression, ces entreprises en oublient ses limites : la loi. Il ne faut oublier qu’avant tout, ce qui est important dans le milieu social, c’est le respect des autres et du droit humain, plus que le contenu et l’idéologie politique. Ou alors, comme dit le proverbe, « la liberté s’arrête là où commence celle des autres ».
Cillian BUCKLEY, T02
Pourquoi ? Des vérificateurs « trop orientés politiquement », une « institutionnalisation de la censure », la vidéo publiée par Zuckerberg le 7 janvier crie Trump. D'abord, le plus évident : délocalisation des locaux de Meta au Texas, terre très républicaine, la mention explicite des thèmes taclés par Trump (immigration, genre), mention du "biais politique" des journalistes... Autrement, le créateur de Facebook évoque « un retour aux sources » et la vision simpliste de prioriser à tout prix le contenu et la parole au détriment des dangers des réseaux sociaux (simplement euphémisé en « the bad stuff ») s’aligne parfaitement sur la politique du nouveau président. Politiquement, c'est aussi un choix qui s'aligne sur le programme trumpiste. Zuckerberg, comme Trump, considère les journalistes comme des "idéologues, [ce qui relève de la] rhétorique de l'extrême-droite" (Anne Cordier, chercheuse à l'université de la Lorraine, le Télégramme). Cette idéologie présente les journalistes et les mouvements intellectuels comme un seul et unique organe de gauche, donc lorsque le patron de Meta affirme que le problème des réseaux sociaux est "l'institutionalisation de la censure" (donc sous le démocrate Biden), c'est bien à Trump qu'il prête allégeance. La devise de cette révision de politique « more speech, fewer mistakes », autrement dit : plus de parole, moins de fautes, paraît trompeuse, et la « faute » rejetée non pas sur le mauvais usage de la plateforme par les internautes, mais plutôt sur les acteurs tiers régulant le contenu potentiellement nocif. Utilisant une sorte de faux dilemme, Zuckerberg souligne les erreurs dans le filtrage, et au lieu de régler ces filtres, les supprime complètement, laissant un espace complètement à la merci des informations délibérément fausses et de la manipulation.
Quelles réactions ? Derrière ce choix politique se cachent de véritables conséquences, hors du monde virtuel. Hormis bien sur le mécontentement des modérateurs payés par Meta, ce choix provoque de véritables questionnements moraux. Cette volonté de mettre la régulation des réseaux aux mains des utilisateurs n’est autre qu’une déresponsabilisation des grandes entreprises de la tech, bras droit de la campagne de Trump. Une stratégie qui “leur épargne les coûts financiers et politiques associés à ces tâches” (Courrier International). Tout cela est d’autant plus inquiétant puisque les réseaux de Zuckerberg ont déjà un antécédent judiciaire. Nous pouvons citer par exemple le scandale de Cambridge Analytica ayant débuté en 2014 : les données de 87 millions d’utilisateurs ont fuité de la société d’analyse anglaise et ont servi de point d’appui pour la campagne de Trump, utilisés pour convaincre les voteurs indécis. Sinon en 2024, il s’était excusé devant la cour de justice étasunienne, humilié, dans un procès concernant le contenu abusif sur Instagram et les conséquences mortelles des réseaux sociaux. Avec des risques pareils, comment ne pas se questionner sur la légitimité d’un réseau modéré par ses utilisateurs ?
Sommes-nous concernés ? L’Europe n’est pas encore concernée par cette politique et possède les cartes à jouer pour ne pas l’être à l’avenir. Le Digital Services Act (DSA), règlement sur le numérique proposé par l’UE en 2023, empêche la plateforme étasunienne d’acter sa politique dans l’UE. Ce règlement devrait « préserver le respect des droits fondamentaux garantis par Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » et « agir contre les contenus pouvant avoir des effets négatifs réels ou prévisibles sur la sécurité publique et les processus démocratiques et électoraux”. Donc les réseaux, bien qu’imprévisibles, agiront dans la limite de la loi européenne. Avant tout, les réseaux sont certes des espaces de société, où est mise en avant la parole. Mais à trop vouloir mettre en avant la liberté d’expression, ces entreprises en oublient ses limites : la loi. Il ne faut oublier qu’avant tout, ce qui est important dans le milieu social, c’est le respect des autres et du droit humain, plus que le contenu et l’idéologie politique. Ou alors, comme dit le proverbe, « la liberté s’arrête là où commence celle des autres ».
Cillian BUCKLEY, T02