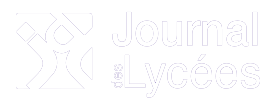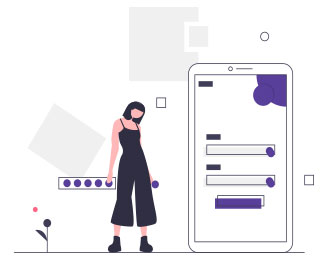Journal des Lycées > L'actualité des lycées
> Calvados > Direction territoriale Canopé Normandie > Les articles > Violences en Équateur et au Vénézuela
Direction territoriale Canopé Normandie, Caen, le 22/11/2024.
Violences en Équateur et au Vénézuela
Entre taux record d’homicide, emprise des narco-trafiquants et guerre civile.

AFP / Gabriela Perez
Homme libéré de prison après une incarcération pour les manifestations contre Maduro
L'état d'urgence comme solution face aux violences en Equateur ?
L'Equateur autrefois considéré comme l’un des pays les plus stables d’Amérique du Sud, fait aujourd’hui face à une augmentation de la criminalité. Cette vague de violence est en grande partie alimentée par les narco-trafiquants. Les gangs de drogue, venus de pays voisins utilisent le territoire équatorien comme point de passage pour acheminer la drogue vers les États-Unis et l’Europe. Les conflits entre gangs se sont intensifiés, transformant certaines villes en zones de guerre, avec des assassinats et des enlèvements.
Pour tenter de lutter contre cette insécurité, le gouvernement équatorien a pris des mesures drastiques. Il a déclaré plusieurs états d’urgence dans les régions les plus touchées, comme Guayaquil et Esmeraldas. Ces mesures permettent au gouvernement de restreindre certaines libertés individuelles, notamment la liberté de circulation, et de mobiliser l’armée pour aider la police. L’Équateur a signé des accords avec des pays comme les États-Unis pour obtenir du matériel, de la formation et du renseignement afin d’optimiser les actions contre le crime organisé. Le pays essaie de se relever des violences et n'abandonne pas.
Le Vénézuela s'enfonce dans la violence ? Le Vénézuela, lui aussi, est frappé par une montée de la violence. Cependant, son contexte est différent de celui de l’Équateur. Depuis plusieurs années, le Vénézuela traverse une crise politique et économique profonde, entraînant l’effondrement de nombreuses institutions publiques. La violence y est alimentée non seulement par le crime organisé, mais aussi par les carences de l’État et l’extrême pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. S'ajoutent à ces violences les arrestations arbitraires du régime de Nicolàs Maduro qui refuse la contestation politique de son régime, comme lors des élections présidentielles de juillet 2024.
Une coopération "douteuse" Face à cette situation, le gouvernement a parfois choisi de coopérer avec certaines factions criminelles. Ces dernières, notamment dans les quartiers pauvres de Caracas, agissent comme des milices et entretiennent une forme de contrôle social. En échange de ce contrôle, ces groupes ont une certaine impunité.
Par ailleurs, les forces de sécurité vénézuéliennes sont souvent accusées de corruption, et des fonctionnaires sont soupçonnés de fermer les yeux sur les trafics illégaux en échange de pots-de-vin. La violence policière envers les civils et les opposants politiques crée un climat de peur et de méfiance vis-à-vis des autorités.
Les deux pays, bien que confrontés à des violences similaires, adoptent des stratégies fondamentalement opposées et aucun modèle de réponse n’a encore fait ses preuves pour inverser cette tendance.
Viviane MENTAI,Terminale Générale
Pour tenter de lutter contre cette insécurité, le gouvernement équatorien a pris des mesures drastiques. Il a déclaré plusieurs états d’urgence dans les régions les plus touchées, comme Guayaquil et Esmeraldas. Ces mesures permettent au gouvernement de restreindre certaines libertés individuelles, notamment la liberté de circulation, et de mobiliser l’armée pour aider la police. L’Équateur a signé des accords avec des pays comme les États-Unis pour obtenir du matériel, de la formation et du renseignement afin d’optimiser les actions contre le crime organisé. Le pays essaie de se relever des violences et n'abandonne pas.
Le Vénézuela s'enfonce dans la violence ? Le Vénézuela, lui aussi, est frappé par une montée de la violence. Cependant, son contexte est différent de celui de l’Équateur. Depuis plusieurs années, le Vénézuela traverse une crise politique et économique profonde, entraînant l’effondrement de nombreuses institutions publiques. La violence y est alimentée non seulement par le crime organisé, mais aussi par les carences de l’État et l’extrême pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. S'ajoutent à ces violences les arrestations arbitraires du régime de Nicolàs Maduro qui refuse la contestation politique de son régime, comme lors des élections présidentielles de juillet 2024.
Une coopération "douteuse" Face à cette situation, le gouvernement a parfois choisi de coopérer avec certaines factions criminelles. Ces dernières, notamment dans les quartiers pauvres de Caracas, agissent comme des milices et entretiennent une forme de contrôle social. En échange de ce contrôle, ces groupes ont une certaine impunité.
Par ailleurs, les forces de sécurité vénézuéliennes sont souvent accusées de corruption, et des fonctionnaires sont soupçonnés de fermer les yeux sur les trafics illégaux en échange de pots-de-vin. La violence policière envers les civils et les opposants politiques crée un climat de peur et de méfiance vis-à-vis des autorités.
Les deux pays, bien que confrontés à des violences similaires, adoptent des stratégies fondamentalement opposées et aucun modèle de réponse n’a encore fait ses preuves pour inverser cette tendance.
Viviane MENTAI,Terminale Générale